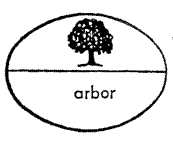|
PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT
APHORISMES
ETRE ET EXISTER
ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE
ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
I- Orientation
II- Théorie de la connaissance esthétique
III- Théorie de la rencontre
IV- Théorie de la signification
V- Théorie des échanges et Conclusion
LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR
LES FANTOMES DE L'OPERA
ON DEVRAIT DIRE...
QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?
LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI
ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)
LE REALISME SELON CEZANNE
NOTE SUR WITTGENSTEIN
ENTRETIEN
CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES
MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES
LE TABLEAU ET LE MIROIR
LE JARDIN A LA FRANCAISE
REMBRANDT, BETHSABEE
PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE
LES RELIGIONS DU LIVRE
DU CARACTERE A LA CARICATURE
QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...
LES GROTESQUES
LE ROSSIGNOL ET LA DIVA
LA STATUE AMOUREUSE
L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART
DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE
CARAVAGE ET L'OPERA
|
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE
IV- THEORIE DE LA SIGNIFICATION
La saisie esthétique est un acte de la sensibilité. C’est dans la vérité d’une chair vivante, possédée par la transe du phénomène, que s’enracinent, indépassablement, l’image et le son. L’élan du sublime n’est pas l’essor d’un pur esprit, mais le saut d’une volonté qui prend appui sur le corps sensible, et l’enivre par surprise. La beauté est incarnée. Mais la théorie poétique dépasse les limites d’une simple théorie de la sensation. Les travaux de Helmholtz sur la vision ont commencé une recherche qui n’est pas encore achevée (1). Ils sont fondamentaux ; ils ne sont pas suffisants. La peinture ni la musique ne sauraient se réduire aux seules lois de l’optique et de l’acoustique physiologique. Il faut un acte de liberté pour que se dénoue la crise, il faut l’intervention d’une volonté pour que soient instituées les valeurs nouvelles. Sur la scène tragique, l’homme seul est acteur. Seul, il provoque l’événement qui engendre le sens. L’œil de l’animal subit l’impression de la lumière ; l’homme dessine le contour et compose le tableau. Ce n’est pas par pure réceptivité, mais par un acte d’interprétation que la saisie s’empare de la forme. La rencontre est signifiante. La sensation reçoit l’onde du choc, l’activité esthétique la réfléchit dans le déploiement de la parole. La danse de Dionysos possède toute vie, mais c’est en l’homme seulement qu’elle fait naître aussi le chant. La physiologie de la sensation mesure la force de l’empreinte ; la philosophie de l’art pense l’accomplissement de l’œuvre. A l’époque où il achevait Le Gai Savoir, Nietzsche formait le projet de suivre, en faculté, des études de biologie : il tombait alors victime de l’illusion d’objectivité qu’il avait lui-même si souvent dénoncée (2). L’étude physiologique de la sensation fait de l’acte de la saisie un objet du « monde en soi ». Elle analyse les mécanismes physiologiques à la façon du physicien qui projette sur le monde extérieur la fiction de la causalité et reconstruit, abstraitement, l’enchaînement des phénomènes. Les sciences de la nature font de désintéressement vertu. A l’inverse de l’acteur tragique qui s’engage résolument, l’expérimentateur prend garde à ne pas s’impliquer lui-même dans le champ de l’expérience. Il se tient en retrait et compte ce retrait pour la plus sûre garantie du sérieux de son travail. L’objectivité scientifique, qui feint l’inexistence de l’observateur, n’est qu’un mensonge pieux. Elle suppose un peu vite dénoué le nœud de la situation. C’est ainsi que le neurologue observe les pigments photosensibles sur la rétine, mais oublie en même temps que c’est à l’aide de ces mêmes pigments que son observation est possible. La physiologie de la vision croit pouvoir tout expliquer, de la réception de l’image jusqu’à sa réception sur le cortex visuel, en passant par le traitement de l’information dans le cerveau. Elle ne dit pourtant pas qui est là pour assister au spectacle sur l’écran (3). De l’œil, elle comprend tout, si ce n’est qu’il voit. Il faudrait un œil encore pour voir l’image au fond de l’œil, et ainsi infiniment. En croyant pouvoir dessaisir l’objet du sujet qui le saisit, l’optique physiologique se rend incompréhensible l’acte de la vision. Elle occulte la source d’où procède le jaillissement du sens. La philosophie esthétique pense au contraire l’image en la rapportant à la volonté qui s’interprète en elle. Elle réfléchit les conditions subjectives de l’expérience, et sait l’impossibilité d’un langage qui serait à lui-même son métalangage. L’organe sensible s’invagine dans l’infinité inclusive de la réflexion : il se connaît lui-même en connaissant le monde, en co-naissant au monde, sustenté par la pulsation du rythme fondamental, soulevé par la danse de la vie, par l’élan de la volonté qui décoche la flèche du sens. La sensibilité n’est pas un donné objectif, objectivable, mais le point d’appui de l’activité herméneutique et l’origine ponctuelle de la visée sémantique. Il faut rapporter la saisie esthétique à l’ïambe fondamental qui lui donne sa mesure, à la pulsation rythmique qui devance le temps et ranime la fièvre. Il faut penser la vision non par relais mécaniques, mais par saccades désirantes.
Parmi les vivants, l’homme est le meilleur danseur. Il est l’animal de la plus haute ivresse. La bête obéit au signal. L’homme répond au signe. De l’un à l’autre se développent, par degrés repérables, le mouvement du lancer et le surgissement du sens. La fonction signifiante s’élève par paliers de la fixation du réel – le point-origine – jusqu’au déploiement de la parole – l’asymptote vertical. La vie accroît son ivresse par métaphores distinctes, par crises successives, sur la pente ascendante qui va du sommeil hibernal à l’extase passionnée. Par signal, par symbole et par signe, le marteau sonne chaque fois plus clair et rebondit plus haut. Le désir, en trois coups frappés sur l’enclume du temps, forge le métal du sens.
Le signal
Le réel occulte le sujet, il fait acte de présence par impulsions signalétiques. Le signal imprime sa marque en creux, par frappes phénoménales, sur la chair sensible, comme le cachet sur la tablette de cire. La sensation reçoit le coup de poing du réel, elle titube et cède sous la cognée des choses, l’avènement de l’omniprésence phénoménale qui réduit au silence le témoin médusé. L’objet assujetti le sujet, il le fait tomber sous la sujétion de la chose, il objecte la parole par décrets impératifs. Le signal met la vie aux ordres. Il forclôt l’activité herméneutique en obstruant la source de la volonté jaillissante sous le bloc de la présence dense et massive. Pour l’animal effaré par les signaux qui l’assaillent, toute présence est écrasante. Un signal ne fait pas signe vers un sens : il réalise, par impulsions brusques, un contact irrémédiable, il scelle une sensibilité pétrifiée à l’immobilité du phénomène. Le sujet s’annule sous la violence du choc. Un signal – « impulse », disent les Anglais – établit une connexion entre un réel et un autre réel. Le rouge ne signifie pas à l’automobiliste qu’il serait bon, ici, de s’arrêter. Il est un stimulus qui tend à provoquer la réponse inconditionnée d’un réflexe conforme, un « stop » brutal qui vise à casser le mouvement par blocage immédiat. On ne discute pas avec les feux de signalisation. Le règlement est le règlement. Il est vrai que l’homme se résout mal à l’obéissance : le procès-verbal est l’objet d’une controverse, l’ordre signalétique vient buter contre les chicanes de la défense. Mais l’animal, englué dans le piège du réel, cède au choc traumatique. On sait que le poussin à peine éclos, pendant une brève période critique – entre treize et seize heures après la naissance – est marqué du sceau infrangible des formes qui l’environnent. Il leur reste, par la suite, irréversiblement attaché (4). L’animal est la victime fascinée de l’agression du réel. La prégnance de l’empreinte est le degré zéro de la sensation. Le saisissement est univoque. Le coup de la rencontre inhibe les réactions du vivant. Le sujet devient chose. Le court-circuit de l’impulsion signalétique n’aliène pas un sujet animé à un objet inanimé, mais greffe un réel sur un autre réel. La frappe du signal détermine le point de la fixation. Elle établit une corrélation automatique, elle résout la turbulence de la vie dans les équations qui commandent le système de la nature, dans le réseau des automata, des automatismes. L’automatisme du signal fait du corps vivant un automate halluciné. La fulgurance de l’impact percute le désir et fige la danse. L’organe sensible est subjugué. La volonté est anesthésiée.
Le réel est inconscient. Par un acte de conscience, je mets la représentation en scène, je distancie le point de visée de l’image appréhendée, je creuse la profondeur d’une perspective. Mais la capture hallucinaire accole le sujet à l’objet, elle supprime la distance et fait bloc comme, pour la frappe de la monnaie, le poinçon fait bloc avec l’incuse. Le réel est l’hallucination d’une présence et, simultanément, la forclusion d’une activité esthétique. L’inconscience est un effet d’adhérence de la sensibilité au réel. La vie animale est comme tétanisée par l’électrochoc de la rencontre. Elle tombe en état de catalepsie. La saisie anesthétique met le rythme fondamental aux arrêts, elle commotionne, mortellement, le processus poétique de la vie. C’est ainsi que l’animal, en situation de danger, demeure prostré, incapable de développer un réflexe de fuite, et fait le mort. La dualité du schéma stimulus-réponse est une illusion de l’analyse logique : la réponse est impliquée dans l’injonction stimulatrice, elle se dessine en creux dans l’ultimatum qui l’assigne. Il n’y a pas ici deux temps pour faire un rythme, mais l’impact d’un unique instant fatal qui totalise le sujet et le monde par pétrification instantanée. La détermination signalétique annule l’écart qui fait le jeu de la variable. Le signal est substance et non fonction, il a une valeur intrinsèque et non une valeur différentielle. Il forme un tout qui se suffit à lui-même, et ne se réfère à aucun signifié. Le signal est un événement atomique. Il est un absolu sensible.
Il était peut-être nécessaire que la découverte de l’inconscient commence par l’expérience de l’hypnose. L’animal, plus que l’homme, est sujet à l’hypnose. Il est assujetti, plus que l’homme, à la prégnance de l’empreinte. Le rire, on le sait, est le propre de l’homme, il est l’explosion de la joie qui brise l’idole fascinante et découvre au regard de l’esprit la perspective infinie du sens. Ce n’est pas l’homme, ce transgresseur définitif, mais l’animal qui succombe à l’effroi du sacré. L’hypnose prend appui sur la syncope rythmique, l’arrêt momentané qui fait défaillir par intermittences la danse de la vie. La puissance du rebond, le jaillissement de la volonté dionysiaque s’arrache chaque fois au comma de la mort. De l’homme à l’animal, la vie décroît en intensité et s’expose par degrés au risque de l’hypnose. Elle s’éclipse progressivement selon que le réel fait plus fortement acte de présence. A la limite de cette pente, s’annule le sursaut différentiel du désir, et la vie s’absorbe dans l’inertie de la matière. Par fixation hypnotique, elle s’abîme dans l’immobilité contractée de la catatonie. L’avènement du réel est l’érection de la loi qui censure le désir et frappe de terreur le sujet halluciné. Le principe de réalité fait échec au principe de plaisir. Face au regard médusant qui la fixe, l’hypnose s’abandonne à la stratégie de l’évanouissement. La force de la frappe signalétique définit le point du regard, le pôle oblitérant de la fixation hypnotique. Le point du regard est aussi le point de fixation qui rive la subjectivité au réel et la fait chose parmi les choses. Un « œil » : c’est, pour le langage typographique, le relief du caractère qui s’imprime sur le papier. Le signal, par rencontres, fait surgir dans le monde un regard, un mauvais œil qui fait face. Un signal est un voyant lumineux qui déclenche, sur les appareils de contrôle, le mécanisme de l’avertisseur. L’apparence est un maquis où la mort est embusquée. En chaque point du réel, le mauvais œil est à l’affût. Le surgissement de l’innommable est imminent.
Le signal jette un sort : le sujet est envoûté par le regard qui le saisi. Comme sur les toiles de Rousseau – le Douanier – le monde est une jungle où luisent par intermittences les yeux cruels des fauves. L’humanité vient à peine de naître. La victoire qui enivre l’élan de la volonté est encore bien fragile. Nous venons tout juste de nous arracher à l’atonie de la vie animale : cent mille ans, un éclair dans la formation des mondes. Le sommeil est le tribut nécessaire que l’homme doit payer à la persistante léthargie de l’origine. Le sommeil est un état auto-hypnotique qui livre la volonté au point de fixation du regard. Les yeux clos, le corps replié sur lui-même, le dormeur s’abîme dans les ténèbres intérieures où pulsent, fugitifs, des centres d’incandescence, des effervescences lumineuses qui font effet de regard et figent par suggestion hypnotique la danse du désir, le bond qui distancie la représentation sous les yeux de la conscience. Rimbaud se souvient comment le poète de sept ans « dans ses yeux fermés, voyait des points », les points de regard qui donnent le signal du rêve et subjuguent la vie par illumination fascinante. Alors la distance de la représentation s’annule et le sujet adhère au réel halluciné, il s’absente dans l’image désormais irréfutable, il disparaît dans le tableau. En l’homme, le rythme de la vie cède, par l’alternance régulière de la veille et du sommeil, aux exigences de l’hypnose. Mais chez l’animal la sujétion est constante. C’est pour les bêtes seulement que la vie est un songe, non pas une vaine et inconsistante chimère, mais la terreur fascinée qui tressaille, à chaque instant, sous les coups du réel. L’animal est en permanence exposé au risque de la forclusion hallucinaire. L’œil humain est l’un des plus finement centré sur le point de la fovea, où se serrent les cellules visuelles qui ont le plus grand pouvoir discriminateur. L’œil animal n’est pas aussi précis : la vision s’étale sur une rétine moins différenciée, elle diffuse dans le flou. On a remarqué que les yeux des vertébrés, quand on les compare à ceux des invertébrés, sont hyperpolarisés (5). Plus la vie se fortifie et s’organise, plus elle se hasarde à fixer du regard l’inconnu qui apparaît devant elle. La vision animale est comme effarouchée par l’angoisse que surgisse, au point de la fixation, un œil contraire qui occulte le sien. Elle choisit de voir un peu de tout plutôt que tout de peu. Mais l’homme est l’animal de la plus haute curiosité : lui seul surmonte la terreur de l’hallucination et tient bon sa partie dans le duel qui oppose le regard désirant au regard sidérant. L’homme seul crève l’écran du réel. Il se soustrait au pouvoir de l’hypnose, quand l’animal fasciné demeure marqué par le sceau de l’empreinte.
Nous savons aujourd’hui que la stratégie du mimétisme animal, le jeu alterné du camouflage et de l’intimidation, n’est pas un mécanisme d’adaptation qui permet au plus faible de se dérober aux regards du plus fort, mais un phénomène imaginaire qui captive la vie par fixation sur le point de regard (6). Ainsi le papillon se pose, ailes closes, sur l’écorce de l’arbre, il disparaît dans le décor. Si l’oiseau prédateur s’approche de trop près, l’insecte ouvre brusquement ses ailes et montre la symétrie rigoureuse de ses ocelles noirs que met en valeur un cerne de couleur phosphorescente. L’ocelle est un œil fascinant, surgi soudain du néant, il est le point d’ancrage de la fixation hypnotique. La parade terrifiante du papillon à tête de mort suffit pour que l’agresseur batte en retraite. L’ocelle occulte le regard. Il est le signal de l’épouvante. La vie animale se trouve ainsi à chaque instant exposée à la violence hallucinante d’un œil qui fait tache. Elle est nécessairement soumise à la discipline rigoureuse de l’occlusion signalétique. Elle souffre le martyre de la présence, elle subit la constante pression des choses. Elle rencontre le monde, mais ne sait pas encore le nommer. Le traumatisme, pour elle, est inévitable. L’empreinte est irréversible.
L’organisme animal est un système mis au point par fixations signalétiques. A chaque espèce correspond un signal spécifique qui déclenche, par automatisme, une conduite de crise, réflexe de peur, d’agressivité ou comportement sexuel. Le chasseur humain triomphe de la force animale en détournant à son profit la fascination mimétique. Chasse à l’appeau, chasse à la pipée, la bête cède à l’attraction irrésistible du simulacre et tombe dans le piège. Dès le commencement, l’homme fut chasseur : expert en ruses diverses, il a su nouer les mailles du filet et dissimuler adroitement les trappes. Lui seul échappe à la prise fatale du réel, lui seul résiste au leurre fascinant et déjoue l’illusion par un acte de liberté. L’homme déchire la trame serrée des automatismes, il ajoure le mur du réel et, par cette ouverture, rend possible l’élargissement de la parole poétique. Mais l’animal, soumis à l’instance du signal, ne trouve jamais la voie d’accès qui conduit au sens, l’issue qui donnerait son essor au lancer de la signification. La bête demeure prisonnière du système des apparences. Le langage animal n’est qu’une liste de signaux – c'est-à-dire un code – qui ajustent rigoureusement le comportement aux stimulations du milieu (7). La parole humaine ouvre la voie d’une recherche, trace la piste d’une chasse. La communication animale déclenche un comportement-type et établit un ordre invariable. La ruche est un système totalitaire qui fonctionne par injonctions automatiques, génétiquement déterminées. Le signal s’imprime directement sur l’animal qu’il commande ; il fait bloc avec lui. Le signal est un événement séparé, une unité close. Le code animal n’est qu’une collection d’éléments atomiques qu’aucune syntaxe n’articule, le répertoire facticiel des émissions signifiantes pour l’espèce. La dissociation signalétique assure la permanence du code : chacune des impulsions déterminantes, isolée des autres, demeure identique à elle-même et ne peut se renouveler que par répétitions monotones. L’isolement du signal assure son invariance. Tout automatisme est un automatisme de répétition. L’animalité demeure captive de la fixation hypnotisante. Le désir en elle est oblitéré par le timbre du réel. Elle reste fascinée sous le coup de l’empreinte.
Le symbole
C’est avec l’esthétique romantique que la représentation symbolique acquiert ses lettres de noblesse. A l’inverse de l’allégorie, qui n’est que l’illustration fastidieuse d’un concept qui se connaît lui-même, le symbole est une image sensible qui fait signe vers un sens non encore formulé, il est l’intuition première par laquelle l’idée se signifie et s’annonce auprès de la conscience. Il est le prodigieux commencement de la pensée par l’illumination poétique d’une figure. Le symbole est la parole universelle, la matrice originaire dont est issue, depuis Babel, la diversité des langues humaines. L’allégorie est le concept qui se fige et se glace dans l’abstraction. Le symbole est la source mystérieuse, ineffable du sens : « L’allégorie, écrit Goethe, transforme le phénomène en concept, le concept en image, mais de telle sorte que le concept reste néanmoins toujours contenu dans l’image et qu’on puisse le tenir entièrement et l’avoir et l’exprimer en elle. La symbolique transforme le phénomène en idée, l’idée en image, et de telle sorte que l’idée reste toujours infiniment active et inaccessible dans l’image et que, même dite dans toutes les langues, elle reste indicible » (8). Le concept est contenu dans l’allégorie ; mais il dépasse magiquement l’image symbolique qui rayonne, comme auréolée par la transcendance du sens. Déjà Kant, pour qui « le beau est le symbole du bien moral » (9), considérait la représentation symbolique comme la présentation indirecte – par la médiation de l’analogie – à l’intuition sensible, d’une idée de la raison (10). L’imagination soumet par schématisme l’apparence phénoménale au regard de l’entendement. Mais la représentation symbolique rend sensible le supra-sensible dont la raison éprouve l’irrésistible besoin. Elle réfléchit analogiquement l’infinité surhumaine d’une volonté sainte : « Notre connaissance de Dieu tout entière n’est que symbolique » (11), écrit Kant. Dès lors le symbole est, pour le philosophe romantique, le signe de la grandeur de l’homme et la manifestation inaugurale de l’essor poétique. Dans le symbolisme, Schelling croit apercevoir l’essence de la mythologie, qui est le matin de la pensée et le premier soulèvement de la signification dans le monde (12). L’esthétique hégélienne développe phénoménologiquement l’accomplissement symbolique de l’esprit dans la matière et du rationnel dans le réel (13). Le symbole, lumineusement, s’ouvre sur un sens avenir.
Sur ce problème comme sur tant d’autres, nous sommes encore tributaires de la philosophie romantique (14). Pour Saussure, et l’on sait l’influence que le linguiste genevois a exercée sur la linguistique moderne, le symbole a pouvoir de surmonter l’arbitraire du signe et de réaliser la fusion énigmatique du signifiant et du signifié. Le symbole est un concept appréhendé dans l’immédiateté de la saisie intuitive. De même que le squelette tenant une faux ne signifie pas la Mort, mais est la Mort présente, aperçue dans l’évidence de sa forme manifestée, de même, écrivait autrefois Schelling, « Marie-Madeleine ne signifie pas seulement le repentir, mais est le repentir lui-même » (15). C’est ainsi, écrit Saussure, que « le symbole a pour caractère de n’être jamais tout fait arbitraire ; il n’est pas vide, il y a un rudiment de lien naturel entre le signifiant et le signifié. Le symbole de la Justice, la balance, ne pourrait pas être remplacé par n’importe quoi, un char, par exemple » (16). La nécessité symbolique se fonde sur la connexion du sensible avec l’intelligible, de l’image perçue par les sens avec le sens conceptualisé par la pensée. La balance ne signifie pas la Justice, elle est la Justice elle-même. Le symbole est l’incarnation de la transcendance dans l’immanence, du Verbe dans la matière. Avec la représentation symbolique, nous touchons la chair de l’esprit. C’est pourquoi Rousseau, et tout le dix-huitième siècle avec lui, cherchait dans l’onomatopée – qui fait entendre le sens dans la musique du mot – la source vive du langage et le premier chant de la parole (17). Il est toutefois paradoxal de reconnaître dans le ronronnement du chat, dans l’ululement de la chouette ou dans le bêlement de la chèvre le premier bruissement de l’intelligence humaine. L’onomatopée – on ne le remarque pas assez – nomme presque exclusivement le cri animal. Loin de qualifier la miraculeuse nativité du sens, elle désigne au contraire l’ânonnement de l’âne et le bafouillage lamentable de la bête qui ne sait pas signifier. De hennissement en mugissement, de coassement en gazouillement, l’onomatopée énumère les mimiques grotesques du bruit que n’a pas encore touché la grâce du son. L’illusion de la présence réelle du corps du signifié dans l’hostie symbolique s’évanouit tandis que se contorsionnent les grimaces bredouillantes d’une bestialité à jamais exclue de la lumière du sens (18). Le romantisme confond le sourire de l’ange – qui est la forme naissante – avec la simagrée du singe – qui est la convulsion qui défigure. Le sublime s’achève en ridicule. La théorie du symbolisme est encore à construire.
L’herméneutique romantique choisit d’ignorer un sens pourtant courant du mot symbole, utilisé par tous les textes avant 1790, mais qui, après cette date, est mystérieusement escamoté (19). A côté du symbole poétique – l’incarnation du sens, l’intuition suggestive de l’idée – il y a le symbole abstrait, le signe conventionnel d’un langage rigoureusement formalisé : symbole algébrique, symbole chimique. Kant, déjà, s’élève contre l’utilisation logique du « symbolisme », puisque, selon lui, on ne saurait rigoureusement parler de symbolisme qu’à propos de la représentation intuitive : « Les nouveaux logiciens admettent un usage du mot symbolique qui est absurde et inexact, lorsqu’on l’oppose au mode de représentation intuitif ; la représentation symbolique n’est en effet qu’un mode de la représentation intuitive » (20). L’analyse du symbole se trouve alors partagée entre deux interprétations inconciliables : les formes symboliques de l’art et la logique symbolique de la science. Comment le symbole peut-il être à la fois l’alliage « indicible » du signifié et du signifiant, et le signe purement arbitraire que définit, non pas sa valeur intrinsèque, mais sa fonction strictement relationnelle au sein de l’équation ? Quel rapport entre la beauté signifiante du tableau et les termes de la notation mathématique ? Incapable de dépasser cette antinomie, le romantisme creusera toujours davantage l’abîme qui sépare l’énigmatique richesse du langage poétique de la froide abstraction de la science. Pour sortir de cette impasse, il faut méditer la contradiction qui travaille la notion de symbole, et non l’écarter arbitrairement, comme si elle n’était qu’un accident du langage. L’antinomie symbolique est en effet le symptôme de son essence invariante.
Sumbolon : chacun des deux morceaux de la tessère dessine en creux l’absence de l’autre. Chacun, par sa présence réelle, fait sentir la présence possible de son double. Sumballein, c’est jeter l’un contre l’autre, mettre aux prises, c'est-à-dire établir une relation polémique entre l’un et l’autre côté d’un même objet, de telle façon que la position de l’un entraîne l’annulation de l’autre. Ainsi, pour le parieur pascalien, c’est croix ou pile, la folie du sacrifice qui est sagesse pour Dieu, ou la sagesse du riche qui est folie pour Dieu (21). Pile : les puissants de ce monde jettent – ballein – leur or à la face du Christ, ils suppriment le scandale de la croix. Face, Sainte Face : le Fils de l’homme, qui n’a pas où reposer sa tête, jette bas l’orgueil des nantis. Le symbole se détermine au point d’articulation du double sens : le signifiant symbolique fait jouer l’ambivalence du sens, il oscille dans le centre instable de la bascule sémantique, il rend sensible le jeu de la permutation signifiante. Le signal est univoque, par blocage et fixation ; il se cristallise sur le point de regard, il est asservi – impérieusement – au monopole de l’empreinte hallucinaire. Mais le symbole est un dipôle qui déstabilise la définition d’un terme par l’opération réitérée du renversement et de l’inversion. Le signal annule l’écart ; le symbole l’ouvre juste ce qu’il faut pour que permute la mécanique du sens. Le signal est catatonique. Le symbole est dyslexique : il donne du jeu au signifiant, il fait jouer le sens par l’interversion des contraires, par la réciprocité intercurrente du sujet et de son double, de l’endroit et de l’envers. Il confronte l’objet à son image, symétrique et inversée, dans le miroir. L’activité symbolique met le sens sens dessus dessous. La balance, selon Saussure, suscite en nous, par une association naturelle et non pas arbitraire, l’idée de la Justice. C’est n’apercevoir que l’endroit de la médaille, le côté face, celui de l’ordre et de l’équilibre pacifié, le visage auguste de l’institution vénérable. Côté pile, il y a le glaive, le fléau redoutable sur lequel prend appui la balance, la violence armée qui se tient embusquée derrière le juge solennel. « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, remarquait déjà Pascal, on a fait que ce qui est fort fût juste » (22). C’est là ce que le solitaire de Port-Royal appelait le renversement continuel du pour au contre (23). Le glaive renverse la légitimité que la balance institue, la force contre et refoule la majesté de la Justice. L’activité symbolique est un renversement du pour au contre. Il y a représentation symbolique chaque fois que, de deux représentations qui s’impliquent réciproquement, l’une ne peut être affirmée sans occulter l’autre. Le symbole correspond, dans l’ordre du signifiant, à la rupture dramatique qui détermine sur la scène tragique, selon Aristote, le scandale de l’événement. Comme le coup de théâtre – peripeteia – le symbole est « le renversement qui inverse les effets de l’action » (24). Le crâne aux orbites creuses qui fait, auprès du bouquet de fleurs, effet de Vanité, est, pense-t-on, un symbole de la Mort. Mais il est encore l’image en négatif du visage qui souriait quand la vie, autrefois, illuminait le regard. Cette mâchoire ossifiée qui montre les dents est le double inversé des lèvres désirables où naissait, naguère, le baiser de la parole. Sur de nombreux panneaux, dans la seconde moitié du quinzième siècle, les artistes flamands peignent, côté face, le portrait du saint patron ou celui du donateur ; mais côté pile, c’est un crâne qui apparaît dans les ténèbres (25). La tête de mort vient frapper la vie en plein visage, elle décompose les traits, elle défait la mine, elle masque la bonne figure qu’une pensée attentive éclaire. La leçon du crâne est ambigüe. La rhétorique de la Vanité est ambivalente. Comment faut-il l’entendre ? Memento mori ou Carpe diem ? Dans la cellule de l’ascète, le crâne enseigne le renoncement et l’humiliation du désir. Mais entre les mains du libertin, il rappelle qu’il faut se hâter de vivre, qu’il faut cueillir la rose avant qu’elle ne se fane. Le symbole oscille entre jouissance et résignation, entre convoitise et sacrifice, entre la chair ardente et l’épouvante qui glace le cœur. Le symbole inquiète le sens en culbutant la thèse par l’affirmation simultanée de l’antithèse. Il piège l’interprétation entre les deux membres, également nécessaires, d’une aporie indécidable. Il déplace l’accent sur le partenaire antagonique. Chacun des deux termes se trouve alors renforcé par la tension de la polarité symbolique : le rayonnement du visage, en qui je reconnais mon semblable, serait moins désirable si ne se dissimulait, sous la lumière, le ricanement de la mort fatale. Le corps précieux de la jeune fille qui s’admire au miroir serait moins délicieux si le cadavre immonde ne posait, sur son épaule nue, une patte osseuse. Le désir s’investit d’autant plus sur la forme manifeste qu’il pressent imminent le renversement de la trappe symbolique (26). La philosophie, romantique, cédait, fascinée, à la sensualité de la présence. Elle succombait, amoureuse, au charme de l’image naissante. Eprise d’une beauté en voie de manifestation, elle ne savait reconnaître le corrélat nécessaire d’un sens latent, symétrique et opposé. Amoureuse du phénomène, elle croyait à l’unité de l’image et méconnaissait la structure logique du doublet symbolique. Le symbole n’est pas la présentation sensible de l’idée. Il est un signifiant associé à son contraire, une représentation positive qui fait corps et s’embellit par la tension qu’exerce sur elle la proximité de son équivalent négatif. Le signal établit une connexion entre un réel et un autre réel. Le symbole associe un signifiant à un autre signifiant, par relation commutative. L’intensité de la représentation provient, non de l’incarnation du sens, mais du retournement possible de l’apparence. C’est ainsi que le soleil n’est jamais si beau qu’à l’heure du couchant, quand menace insidieusement la tombée de la nuit. L’ambivalence du symbole est seule responsable de sa magnitude apparente. Le symbole n’est pas un phénomène esthétique. Il est une articulation logique.
Le chiasme symbolique dissocie l’unité de la signification manifeste. Le réel – qui est l’empreinte signalétique – est un absolu sensible. Il ne renvoie qu’à lui-même. Sous le coup du réel, le sujet adhère à l’objet, il s’annule, forclos par la frappe du regard. Le symbole au contraire est un terme lié, corrélé par le jeu de l’inversion. Le réel colle à lui-même, mais le signifiant symbolique se voit par redoublement et opposition, il se réfléchit en un autre signifiant, il s’aperçoit par son contraire. Le réel isole l’unité du signal halluciné. La symbolique établit, entre les opposés, une relation binaire, une ambivalence instable. Il correspond à cette figure qu’en rhétorique qu’on nomme chiasme. Le chiasme naît au croisement du sens, il retourne la signification en sens contraire. C’est un chiasme, par exemple, qu’on déchiffre sur La Trinité par Masaccio, à Santa Maria Novella : « io. fu. gia. quel. che. voi. sete : e quel chi son voi. ancor. sarete » : je fus autrefois ce que vous êtes et vous serez plus tard ce que je suis. C’est la Mort qui parle, ou du moins ces ossements blanchis étendus sur le sarcophage, ce squelette qu’on dit être, précisément, le « symbole » de la Mort. Mais au-dessus de cette horizontale fatidique, le Père soutient le Crucifié et l’arrache à la profondeur d’une perspective qui, disait Vasari, « semble trouer le mur » (27). La promesse de la résurrection rétablit sur la verticalité de cette croix cette même volonté que la mort fait se coucher sur la terre. Comme le crâne, qui est l’image en négatif du visage, le squelette inverse la promesse du Salut et rend sensible, par l’alternance des extrêmes, ce que le chiasme énonce en termes clairs sur la pierre tombale. Le sens oscille entre la mort irrémédiable et le sacrifice que Dieu agrée. La composition de La Trinité est moins une perspective géométrique qu’une représentation symbolique. L’interprétation est piégée par l’affirmation simultanée des contraires, l’un occultant l’autre en un mouvement de bascule qui ne trouve jamais son repos. C’est ainsi que le discours tragique est frappé d’une constante ambivalence qui donne à chaque mot son poids et rend possible, dans l’instant du geste suspendu, dans le « suspense » de l’action, la terreur de la parole irrémédiable, irrécusable (28). Œdipe, ivre de fureur et de justice, chasse de la cité le meurtrier de Laïos ; il ignore que par ces mots c’est son sort qu’il arrête et qu’il sera, victime du chiasme tragique, renversé par le coup qu’il porte lui-même. Le double fouet qui, au carrefour de Corinthe et de Thèbes, offensa le père, reviendra sur sa lancée quand tout sera consommé et, comme un fléau divin qui oscille terriblement, terrassera le fils (29). C’est à la croisée des chemins, dans le centre critique du chiasme, à la pointe du glaive, sur le couteau de la balance, que s’accomplit l’événement. Dans l’instant de la rencontre, le héros est capturé par le trébuchet du drame. L’écoute de la psychanalyse sait être attentive à l’ambivalence symbolique qui, de signifiant en signifiant, tisse la trame des associations. Elle analyse ce que le renversement tragique met en action et représente sur la scène du drame. C’est ainsi qu’il n’y a pas si longtemps, devant la fresque de la résurrection des morts, par Signorelli, dans la cathédrale d’Orvieto, Freud entendit résonner le double sens du mot « Seigneur » (30). Dans la bouche du semblable, il signifie hommage et respect, et flatte dans l’esprit du médecin le sentiment de sa toute-puissance. Mais quand il provient de l’autre scène, il met à bas la souveraineté que le sens premier avait exaltée, il fait paraître soudaine le maître absolu – le suicidé de Trafoi – qui annule la conscience illusoire que le sujet entretient avec lui-même. Sur la fresque de Signorelli, les corps des appelés arrachent à la terre leurs maigres ossements et se recouvrent progressivement de chair vivante. Enter Christ et Antéchrist, entre vie et mort, entre désir et forclusion, entre conscience et inconscience, le mot fait valoir son ambivalence et l’image son éclat. Tracé en lettes ineffaçables sur l’écran du rêve, le nom de Signorelli a force de symbole (31). Comme Œdipe, le pied-bot qui claudique à la frontière des mondes, ainsi le Seigneur des vivants et des morts fait boiter le destin par l’alternance des contraires.
Les sages qui font profession d’interpréter les symboles exposent le sens au risque du contresens. Ils sont victimes de l’illusion romantique et supposent l’autonomie de la représentation symbolique. Les dictionnaires des symboles sont toujours décevants (32). Ils prétendent délivrer le sens de l’intuition sensible où « la pensée primitive », croit-on, le retient prisonnier. Ils dénombrent les images, ils classent – alphabétiquement, arbitrairement donc – les figures historiques où le sens n’attend, semble-t-il, qu’une formule pour s’énoncer, explicite. Mais l’image présente n’est que la vaine apparence de l’articulation symbolique, elle se fragmente aussitôt en interprétations contraires et laisse sur sa faim le désir du déchiffrement essentiel. C’est ainsi que le chien, remarque Panofsky, est tantôt le symbole de la fidélité, tantôt de la luxure, que le serpent signifie tantôt le mal et tantôt la prudence, que les sandales d’or sont tantôt l’attribut de la volupté, tantôt celui de la générosité (33). C’est ainsi encore, pourrait-on ajouter, que la perdrix est, dans la symbolique chrétienne, l’emblème de la charité ou celui du démon, la licorne l’image de la chasteté ou de la sensualité, et que le miroir signifie quelquefois la sagesse, et quelquefois l’orgueil (34). On sait que Bachelard entreprit la psychanalyse poétique des quatre éléments de la matière alchimique. Pour le feu (1938, pour l’eau (1942) et pour l’air (1943), un seul livre chaque fois lui suffit. Mais la rigueur de la logique symbolique fit exploser en deux tomes, au dernier acte de la tétralogie, la cohésion apparente de l’imagination terrestre (1948). Selon qu’elle se décline sur le mode de la volonté ou sur celui du repos, la terre engendre des images inconciliables. Il aurait donc fallu revoir le classement et répartir la richesse des symboles en distinguant ce qui revient à l’énergie qui veut dominer ou bien à la rêverie qui trouve refuge dans l’intimité matérielle. Cette nouvelle tentative n’aurait pas davantage abouti. Il n’existe pas de clé pour le langage symbolique puisque ce n’est pas dans les images, si séduisantes soient-elles, que ce langage trouve sa vérité, mais dans l’articulation logique qui les sous-tend.
La fascination romantique, passionnément attachée à la représentation sensible, refoule la définition pourtant exacte du symbole mathématique. En quête d’un sens perdu, qu’elle croit inestimable, elle manque la relation invariante qui détermine la syntaxe symbolique. Un symbole algébrique est un élément au sein d’une équation qui se compose invariablement de deux membres répartis symétriquement de part et d’autre du signe de l’égalité. Chaque membre est pour l’autre son image inversée. C’est ainsi qu’à chaque fonction y = f(x) correspond une fonction inverse x = φ(y). Il ne faut pas voir en cette opération l’arbitraire d’un esprit abstrait et dépourvu de sensibilité, mais la formule fondamentale, énoncée dans sa plus grande pureté, du chiasme symbolique. Si on le retire de l’équation qui le calcule, le symbole mathématique n’est plus qu’une lettre isolée et, comme telle, un non-sens que nul ne songerait à interpréter. De même, si on entreprend de connaître l’image symbolique en la dissociant du chiasme qui la constitue, de l’ambivalence qui lui donne lieu, on s’égare dans le labyrinthe des croyances et des mythes. On poursuit sans fin un sens dont on avait pourtant halluciné l’incarnation, on reste victime du leurre de l’intuition immédiatement signifiante. Il est vain de chercher à connaître le sens des symboles. Cette illusion est religieuse, elle veut savoir le dernier mot de toutes choses, elle espère être initiée au « Sésame, ouvre-toi » de la création poétique. Elle croit encore en la magie d’une parole divine qui apporterait enfin la paix à l’inquiétude de l’esprit et le réconcilierait à jamais avec l’objet toujours fuyant de son désir. Les symboles n’ont pas de sens. L’herméneutique symbolique, malgré les efforts d’une prodigieuse érudition, se termine toujours en philosophie de pacotille. Elle se résout en fin de compte en oppositions élémentaires, le soleil et la lune, le ciel et la terre, l’homme et la femme, le jour et la nuit… etc., qui recommencent inlassablement le jeu de la bascule symbolique. Les termes sont interchangeables. Les images ne comptent pas, mais seulement la logique de leurs corrélations. De signifiant en signifiant, l’interprétation romantique voit toujours lui échapper la saisie ardemment attendue du signifié fondamental. Le sens demeure piégé par l’alternance symbolique, il va et vient comme la navette sur la trame, sur le système de la langue sans jamais rencontrer la surprise merveilleuse qui fait effet de sens et commence le travail maïeutique. Le sens, nous le savons, c’est dans le saut de la volonté que nous le trouverons jaillissant, dans le bond du danseur dionysiaque et non dans le pas de deux de l’automate symbolique. La mécanique du symbole est régie par l’automatisme de la répétition. Elle fonctionne par inversions réciproques et successives, dans l’intervalle invariable du dipôle symbolique. Le symbole n’est pas image signifiante, mais structure logique. Il n’est pas la source miraculeuse de la parole vivante, mais la syntaxe rigoureuse d’un système formel. Il est le terme indifférent d’une équation invariable.
La mathématique symbolique définit une structure de symétrie. De part et d’autre de la croix, l’iconographie médiévale dispose, en un schéma ordonné, répété pendant des siècles, la Vierge et saint Jean, le soleil et la lune, l’Eglise et la Synagogue, le bon et le mauvais larron, le porte-lance et le porte-éponge (35). De la même façon, la science héraldique a montré comme les blasons, scindés en deux parts aux couleurs alternées, obéissent aux lois formulables d’une combinatoire simple (36). L’artifice de la représentation figurée peut faire croire à la possible coexistence des contraires, à l’étalement simultané, sur le plan continu de l’image, de deux membres de l’équation symbolique. Cependant, la structure du chiasme imprime son dynamisme à l’apparente harmonie de l’ordonnance symétrique : l’affirmation d’un élément occulte nécessairement son double de l’autre côté du miroir. La symétrie symbolique n’est pas conjonctive, mais disjonctive : c’est l’un ou l’autre terme et non les deux ensemble, le bon ou le mauvais larron, le paradis ou l’enfer, sans compromission possible. L’ambivalence du symbole détermine un clivage dans la structure de l’ensemble. C’est ainsi que la psychologie de la forme a mis en évidence l’ambiguïté de certaines images que le regard ne sait pas réduire à l’unité : ou bien je vois deux visages, en silhouettes noires, qui se font face, ou bien je vois le vase blanc qui se profile en creux dans l’intervalle. De cette expérience, la Gestaltpsychologie tire la leçon de la « bonne forme » que construit la conscience dans le champ de sa perception. Il fallait plutôt reconnaître, dans l’instabilité de la figure, l’intermittence du chiasme symbolique qui veut que cette même conscience, quelque puissance qu’on lui accorde, est cependant bien incapable de voir à la fois les deux profils et le vase. Le regard piégé par la vacillation des apparences oscille de l’une à l’autre forme sans pouvoir jamais identifier laquelle, des deux, est la « bonne ». On a remarqué la semblable ambivalence de certaines injonctions qui, une fois encore, mettent la mort en scène : si je donne au brigand la bourse, je garde la vie, mais si je veux garder la bourse, alors je perds la vie ; je surmonte l’angoisse de mort en exaltant la cause de la liberté, mais si la liberté est vaincue, alors je serai mis à mort (37). La logique symbolique fonctionne par intercurrences répétées. Le sujet ne peut jamais se saisir que d’un seul des deux termes tandis que lui échappe l’autre. Sur la fresque de Masaccio, la croix tenue à bout portant par le Tout-Puissant fait échec à la mort ; mais la mort, ce squelette anatomique qu’on a posé sur la pierre froide, ironise cruellement l’espérance de la résurrection. Il faut que l’un ou l’autre soit oblitéré dans l’inconscience pour que l’autre ou l’un puisse faire acte de présence. Duplicité du signifiant symbolique : un symbole en cache un autre, et fascine le désir impatient de savoir par l’imminence d’un retournement ultime qui fixerait enfin le sens. Le symbole humilie la conscience en dissimulant à son regard l’envers d’une médaille qui peut pivoter, sans doute, mais cache alors l’endroit qu’elle montrait un instant auparavant. Le chiasme symbolique détermine les lois qui régissent la logique de l’inconscient. La représentation consciente bascule dans le piège que lui tend l’ambivalence du symbole. Le sujet comprend qu’il ne saurait être, dans le champ symbolique, le principe autonome et inaliénable de la visée sémantique, et qu’il ne peut échapper, victime subjuguée, au chassé-croisé du double sens. L’unité de la conscience de soi, saisie par un acte de réflexion, que postulait la philosophie classique, se brise comme un rayon réfracté quand on l’expose au prisme du chiasme. Elle apprend à renoncer à sa souveraineté.
La conscience entretient avec l’inconscient, selon Freud, la même relation que le positif avec le négatif d’une photographie qui ne parviendrait plus à joindre les deux bouts (38). Du latent au manifeste, il n’y a pas le travail difficile d’une volonté qui s’arrache à l’inconscient et cherche passionnément, douloureusement, à surmonter l’antinomie pour s’épanouir dans la lumière de la reconnaissance. Du latent au manifeste, il y a une incompatibilité logique, un clivage irréductible qui conditionne la formulation d’un membre de l’équation par la forclusion nécessaire de l’autre. Il importe de comprendre combien l’inconscient n’est pas un devenir conscient. S’il n’était que cela, la révolution psychanalytique n’aurait pas été un bien grand bouleversement, et Freud ne serait pas fondateur. La philosophie avait pensé dès Leibniz la possibilité de représentations inconscientes, les « petits sentiments confus » qui se forment en nous quand nous dormons sans songe et, quand nous sommes étourdis par quelque coup, l’infinité des « impressions sensibles » qui, à tout instant, sollicitent l’âme et inclinent la balance, jamais indifférente, de la volonté (39). Hegel avait cru discerner, dans l’histoire du monde, le soulèvement héroïque de l’Esprit, porté par « l’instinct inconscient intérieur, le plus intérieur », dans son effort pour se hisser dans le cercle parfait de la conscience de soi (40). Perception insensible ou crépuscule où s’envole la chouette, l’inconscience des philosophes est une conscience crépusculaire. Il est un subconscient qui hante obscurément l’intériorité de l’âme, mais que l’âme peut toujours, par un acte de réflexion, faire apparaître aux yeux de la conscience. L’inconscient freudien est au contraire un inconscient radical (41). Le subconscient ne diffère que par degrés de la clarté et de la distinction qui sont maximales dans la saisie de l’évidence. L’inconscient diffère par nature. La réalité de l’inconscient ouvre dans l’esprit une lacune que rien ne saurait combler : « Nous ne connaissons pas plus l’inconscient que la chose en soi de Kant », nous enseigne Freud (42). Cependant, pouvons-nous connaître que nous ne connaissons pas ? L’inconscient se signale à notre attention par le symptôme qu’il provoque, rêve ou névrose, comme la chose en soi se traduit en phénomène pour la subjectivité qui l’aperçoit (43). C’est ainsi que dans le chiasme symbolique, chaque terme manifesté est le symptôme de son antagonique forclos. Nous ne saisissons jamais la totalité de la relation, mais un terme seulement, tandis que l’autre est occulté par la bascule du chiasme. Le sens latent n’est pas le mystère dont l’élucidation nous livrerait la vérité du sens manifeste : il est, plus simplement, son image inversée (44). Entre les deux, s’articule l’échange des équivalents qui sont aussi des contraires, selon le mécanisme des permutations soumises à la loi du talion qui règle, souveraine, les transformations du rêve. Comprendre le rêve, ce n’est pas explorer les profondeurs dont les romantiques, ces spéléologues de l’âme, espéraient formuler la psychologie ; c’est discerner une correspondance biunivoque entre la syntaxe de l’hallucination et la logique du symbole. C’est établir l’isomorphisme du travail du rêve et du chiasme symbolique.
Les premiers travaux de Freud ont ouvert la voie de cette recherche. Elle n’est pas encore achevée. Cette tâche, non seulement excède nos forces, mais dépasse aussi les limites de notre propos. Il suffira d’en suggérer la possibilité en reconnaissant, dans le rêve fameux du chapitre VII de la Traumdeutung, le jeu de la bascule symbolique (45). Ce rêve en effet a valeur de modèle. « Je ne sais exactement quelle est sa source », reconnaît Freud. Cette veillée funèbre qui accouple, par delà la mort, le fils au père, est un rêve sans rêveur. La femme qui le rapporte – et qui « s’empressa de le rêver à son tour » – le tient d’un énigmatique conférencier dont nous ne saurons jamais le nom. Rêve universel, machine à rêver, il présente à l’analyste la syntaxe formelle de tout rêve en général. Il prive l’interprétation du recours à ce témoin à charge qui parle d’ordinaire, qu’on fait parler sur le divan. Le rêve du chapitre VII se construit en miroir, de part et d’autre de la cloison qui sépare l’envers de l’endroit, et la vie de la mort : c’est d’abord la chapelle ardente où repose la dépouille de l’enfant ; c’est ensuite la « chambre d’à côté » où le père inattentif se laisse aller au sommeil. Entre les deux, au point de clivage où se noue le nœud du drame, « une porte est ouverte » pour que circule le signifiant, pour que circule le mécanisme de l’inversion symbolique. Le principe de la parité, ou de la symétrie en miroir, ordonne chacun des membres de l’équation de telle sorte qu’il soit le double imaginaire de l’autre. Le père endeuillé regarde le cadavre du fils, mais la flamme du cierge, point de lumière dans les ténèbres, comme un œil qui tremble à l’extrémité d’une longue tige, lui retourne son regard. Le cierge en tombant communique au trépassé le même incendie qui flamboie dans les yeux des vivants quand, dévorés de curiosité, ils se penchent sur les morts et, par la porte un instant ouverte, jettent un regard sur l’au-delà. Cette brûlure – « Père, ne vois-tu pas que je brûle ? » – qui embrase le fils assassiné redouble, de l’autre côté du miroir, le feu qui torture le père encore vivant, et qui lui arrache l’âme. Sous le coup qui le frappe, le père, comme on dit, a vieilli de cent ans : il sera désormais semblable au vieillard pieux et dérisoire qui n’écoute ni ne répond, mais psalmodie toujours d’inutiles prières pour une veillée qui ne cessera jamais. Le père se voit en ce vieillard cassé comme on voit son destin dans un miroir magique, comme il voit la flamme de son propre regard sur le bûcher où son enfant se consume. Le face à face du rêve – le dipôle symbolique – est une hallucination du désir : en vérité, le père est seul avec lui-même, il sera seul, définitivement, pour le court chemin qui lui reste à parcourir. Le symbolisme du rêve répond à la structure de symétrie du chiasme ; il s’articule encore selon les lois dynamiques de l’ambivalence. Quand le père est debout, pour un dernier hommage, l’enfant est gisant, couché dans le cercueil sur l’horizontalité de la mort. Quand le père, épuisé de chagrin, s’abat sur le lit et cherche refuge dans le sommeil, alors l’enfant, comme un revenant que le désir illumine, se lève et, plein de fièvre, rappelle la souffrance. Quand le père s’endort, il entend depuis la pièce d’à-côté la vague rumeur d’une prière qui le poursuit comme un reproche, comme l’enfant d’outre-tombe, lui saisissant le bras, lui « murmure d’un ton plein de reproche » le ressouvenir de l’agonie. Mais quand le père se réveille en sursaut, le vieillard qui marmotte ses prières s’est à son tour assoupi. Quand le père tombe de sommeil, le cierge vertical veille sur le mort. Mais quand le père se relève, le cierge, tombé sur l’enfant, enflamme le linceul. Progrédience et régrédience se réfléchissent de part et d’autre du miroir hallucinaire. Le père se voit mourant par ce vieillard crépusculaire ; il hallucine sa mort par la mort anticipée qui s’est saisie du fils. Mais quand, rêvant, il passe de l’autre côté du miroir, l’enfant surgit de sa tombe et, de la mort à la vie, remonte le temps. Le désir du rêve fait échec un moment à l’irréversible. Sur la Trinité de Masaccio, la croix se dresse. Elle chancèle quand la mort énonce le chiasme fatal. Mais le Père éternel la redresse, il l’arrache à la fuite perspective et la plante à nouveau en plein cœur du présent. La bascule est exacte. La mathématique du symbole obéit à des lois rigoureuses. Le travail du rêve est soumis à des règles logiques, qu’on peut formaliser. La figurabilité du rêve, la violence avec laquelle il sait se traduire en images, correspond à ce qu’en mathématique on nomme la définition des éléments, dont la collection fait un ensemble. L’intensité de chaque figure que le rêveur hallucine est fonction, nous le savons, de la pression qu’exerce sur elle son double inversé, rejeté dans inconscient. La puissante évidence de la représentation symbolique – elle fascinait la philosophie romantique qui n’avait d’yeux que pour elle – n’est que le symptôme manifeste d’une représentation latente, qu’elle suppose et forclôt au même instant. On constitue en mathématique une relation binaire en joignant par un verbe – qui est le nœud de l’action – un sujet et une image (46). Il faut corréler les hallucinations du rêve au « sujet » qu’elles annulent, selon les lois nécessaires du chiasme. La logique binaire du symbolisme accouple la figure à son sujet refoulé. Chaque membre de l’équation est l’image inversée de l’autre. La figurabilité du rêve est l’effet mécanique d’une relation imaginaire. Les lois de l’association sont identiques à celles qui gouvernent l’arithmétique fondamentales des nombres naturels. Les inversions du rêve manifestent la commutativité de l’opération symbolique, c'est-à-dire la relation d’équivalence entre un couple d’éléments et son transposé. Les déplacements du rêve expriment l’associativité des éléments de l’équation, qu’on peut regrouper de diverses manières sans détruire l’égalité. Enfin, les condensations effectuées par le rêve correspondent aux lois de la distributivité qui démontrent l’identité entre le développement d’un produit et sa formule simplifiée, qui est aussi son expression la plus concise (47). Ce n’était pas dans les tropes de la vieille rhétorique – métaphore et métonymie – qu’il fallait chercher le secret de la clé des songes, mais dans les lois simples, telles qu’on les apprend à l’école, de la logique symbolique. Le travail du rêve fonctionne comme une machine arithmétique. Entre image et sujet, entre la représentation manifeste et son corrélat assujetti dans l’inconscient, le chiasme fondamental articule le jeu du double sens. Selon qu’elle montre son avers ou son obvers, la médaille du signifiant symbolique oscille sous les yeux du désir.
Le philosophe qui médite remonte le cours du fleuve. Il admettait que la source s’enfonçât dans la nuit de l’inconscient, il ne supposait pas qu’elle se divise. Freud l’énonce explicitement : il n’y a pas un inconscient, mais deux qui s’impliquent réciproquement selon le mouvement alternatif de la bascule symbolique : « L’inconscient – le psychique – se révèle être une fonction de deux systèmes bien distincts, et cela déjà dans la vie normale. Il y a donc deux sortes d’inconscients, que les psychologues n’avaient pas encore distingués. Tous deux sont inconscients au sens que donne à ce mot la psychologie. Pour nous, l’un des deux, celui que nous nommons l’inconscient, ne peut en aucun cas parvenir à la conscience ; l’autre, que pour cette raison nous nommons préconscient, peut y parvenir après que ses excitations se sont conformées à certaines règles… » (48). Nous savons en effet combien l’activité symbolique est logiquement réglée. Des deux termes de l’ambivalence, l’un, nécessairement forclos, ne peut « parvenir à la conscience » ; mais il manifeste l’autre par le symptôme, il délègue son représentant, qui est aussi son double, dans le rêve qui fait image. Le préconscient est l’ambassadeur de l’inconscient comme, sur le tableau d’Holbein, les ambassadeurs du roi et du pape sont les figures inversées du crâne que l’anamorphose escamote. Entre manifeste et latent, la censure – qui résulte de la seule nécessité logique du chiasme – dissimule le désir impatient de voir et de savoir l’autre côté du tableau. Des deux pôles de la relation symbolique, l’un, nécessairement, « censure » l’autre. L’hystérique, dit-on, simule et ment. Ce n’est pourtant pas par sa faute, mais par le jeu de la bascule qui automatise son langage et ne lui permet de prononcer un mot qu’à la condition d’en occulter un autre, qui le contredit. L’hystérique, nécessairement, ne sait pas ce qu’il dit, puisqu’il dit toujours l’inverse de ce qu’il aurait voulu dire. Ce n’est pas encore conscience, mais préconscience seulement. Le rêve est accomplissement de désir, il excite le désir par l’illusion de la révélation imminente. Il n’est encore qu’un désir en voie d’accomplissement, le sursaut différentiel de la vie qui compte, par permutations réciproques, le va-et-vient de l’automate. Le rêve est un écart minimal qui tressaute – à peine – depuis l’immobilité hypnotique qui envoûte l’animal, par signaux et par empreintes. Le désir veut le sens, et le sens est l’élan intégral du danseur dionysiaque qui interprète la terre, par sauts et par bonds. Le rêve danse mal ; il pense peu. La bête, engluée dans le réel, victime de la fixation signalétique, tombe à l’arrêt. Le courant est coupé, et la vie se fige, par saisissement. Le rêve, qui obéit à la discipline de la relation binaire, produit l’hallucination, par pulsions imaginantes. Le courant est alternatif, et le sens, mécaniquement, va et vient entre thèse et antithèse. Quelque chose commence qui ne s’achève jamais. Le tic-tac du rêve n’est qu’un métronome sans conscience. La conscience s’ennuie à ce jeu monotone ; elle veut bien davantage, elle veut l’ivresse et le vertige, elle veut la danse au rythme du marteau, le métronome intérieur qui exalte le désir, en accomplit la promesse et fait jaillir le sens. « Tous les hommes, enseignait Aristote, désirent naturellement savoir » (49). Sur l’objet de nos désirs – qui est rencontre et co-naissance – les rêves ont peu de choses à nous apprendre. Une fois dissipé le mirage romantique, une fois mise à nu la structure du symbole, l’image hallucinée fait l’aveu de sa pauvreté sémantique. Le charlatanisme de certains analystes, qui donnent à l’interprétation le lustre d’un dévoilement métaphysique, exploite l’illusion symbolique. Ils excitent le désir à la chasse du sens comme on stimule le muscle disséqué par impulsions électriques. Ils font croire à la vie comme les faux prophètes faisaient jadis croire à la résurrection en transmettant au cadavre quelques convulsions momentanées. Pour que s’accomplisse le désir, il faut que l’acte tragique ose l’attentat merveilleux et que, dans l’anneau de l’éternel retour – le cercle dionysiaque de l’orchestra – l’aurore se lève sur un monde rajeuni. Le préconscient reste piégé dans l’alternative symbolique. Terrorisé par le coup de théâtre, il est impuissant à se hisser jusqu’au jour de la reconnaissance. Incapable de dénouer le nœud de la situation et de provoquer l’événement, il demeure stupide sur la scène, comme un mauvais acteur qui ne sait que faire de son corps. Il est semblable à l’âne indécis qui se meurt entre le foin et l’eau, entre Thèbes et Corinthe. Pour délivrer le sens du charme qui le retient prisonnier dans le rêve, il faut qu’une volonté se présente et se nomme, et prenne la route qui conduit au Sphinx. L’énergie du préconscient est, s’il faut en croire Freud, une « énergie liée » (50). Mais Œdipe est un homme libre. Les représentations du rêve percutent mécaniquement les deux extrémités du dipôle symbolique. Entre préconscience et inconscience, affolé par la traque d’une signification alternativement censurée, l’appareil mental radote sans jamais s’arracher au renversement perpétuel du pour au contre. Dans le rêve, le désir vient à peine de naître. Il ne sait pas encore être poète.
Le signal est le degré zéro de la sensation. Dans le symbole, l’écart est minimal. Il est nul dans le signal. Sous le coup de l’empreinte qui le marque irréversiblement, l’animal répartit en deux rôles distincts les deux membres que l’équation symbolique égalise. Selon qu’elle s’annule par camouflage ou qu’elle surgit pour intimider, selon qu’elle est proie fascinée ou chasseur cruel, la bête oscille entre l’inconscient qui fait le mort et le préconscient qui manifeste la forme hallucinante. Le papillon disparaît, par mimétisme, sur l’écorce de l’arbre. Il s’évanouit dans l’inconscience. Mais lorsque, brusquement, il déploie ses ocelles noirs, alors c’est l’oiseau prédateur qui recule, terrifié, anéanti, et cherche à se fondre à son tour dans le décor. Quand l’un des deux termes est positif, l’autre, nécessairement, est négatif. La bête est ou bien prédatrice, ou bien victime, la nature fixe les rôles, sans jeu possible, sans le moindre degré de liberté (51). Mais le symbole articule dans le rêve ce que la nature dissocie dans le duel animal (52). Le rêve intériorise sur la scène imaginaire les deux temps opposés – inconscient et préconscient – et les assemble pour constituer un drame, ou du moins un récit. Chaque nuit le rêveur appréhende son double dans la marge de l’ambivalence, au point d’inflexion de la bascule, entre le chasseur et la proie. Cette coïncidence est précaire, puisque la syntaxe du chiasme impose qu’une représentation soit latente quand l’autre, en se manifestant, la censure. Elle fonctionne cependant dans l’unité d’un appareil mental qui amorce, par automatismes, ses premiers pas. Le désir est le prisonnier du rêve, mais le rêve se soustrait, il commence de le faire, à la fixation sur le point de regard, il émerge, naissant, de l’empreinte qui adhère au réel. Ce n’est pas encore l’invention de la parole, mais c’est déjà le système de la langue, la structure d’une logique symbolique qui, par redoublements, oppositions, alternances et inversions – c’est ainsi que (Bol)traffio se transforme en Trafoi – élabore une syntaxe. La grammaire précède la poésie. La langue est d’abord cette mécanique phonétique qui se développe sur un rythme saccadé, comme on peut l’entendre dans les comptines enfantines. Avant d’apprendre à parler, le désir apprend à compter. Le rythme symbolique n’est pas encore le rythme signifiant, il est à la musique ce qu’est au mouvement le décompte arithmétique, qui est le nombre du temps. Il est des grands poètes qui n’ont pas dédaigné de se prêter un peu au jeu de la comptine (53). Cette souris verte qui courait dans l’herbe, ou bien encore ce furet qui court, qui court du bois messieurs au bois mesdames, tissent en se jouant la trame inestimable où circule le signifiant. Ainsi le préconscient dérive au fil des associations, non pas libres, mais asservies rigoureusement aux lois du chiasme symbolique. Le signal, fixé par l’empreinte, reste muet. Mais le symbole, animé par le mouvement de la bascule, est intarissable. Un signifiant en appelle un autre, par négation et dénégation, par phrase et antiphrase, par thèse et métathèse, indéfiniment (54). Le préconscient répète inlassablement la même chose et continuera de le faire tant qu’il n’en a pas conscience. L’hypnose hallucine un réel. Le préconscient parcourt le cercle fermé d’un monde symbolique. Il fait l’expérience du cercle herméneutique – que la symbolique romantique savait définir, mais non pas dépasser (55), le cercle magique en lequel le symbole envoûte le sens et le retient par sortilège. Le monde du langage est circulaire et la terre, où voyage le signifiant, est une boule ronde. Pour que commence la danse, il faut une volonté libre qui prenne appui sur le sol et, s’arrachant à la pesanteur, s’élance vers le ciel. Le symbole, que le trop peu de désir affaiblit, reste couché sur la terre, maintenu par le filet, par le réseau de la syntaxe. Mais le signe déchire le piège, il crève l’écran de l’image et, ivre de désir, sur le rythme de l’ïambe fondamental, chante le poème.
Le signe
Le signe, selon Saussure, est « une chose double » : « Nous appelons signe la combinaison du concept et de l’image acoustique » (56). C’est là une définition, une parole définitive donc, qui termine un débat – celui des philosophes – et qui en commence un autre – celui des linguistes. Cependant, pour que tout soit bien clair, et parce qu’un croquis vaut mieux, dit-on, qu’un long discours, le maître fait un dessin au tableau :
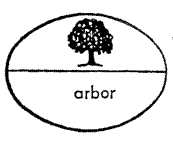
« Arbor », c’est ici le signifiant, ou du moins sa transcription phonétique, comme on transcrit sur la portée les notes d’une musique. Ce n’est pas la chose même, le son présent, vibrant, qui naît au bord des lèvres, mais seulement sa photographie. C’est une « image acoustique ». Soit. Mais en haut, le dessin, quel est-il ? C’est un arbre, bien sûr, non pas cet arbre qui, sous ma fenêtre, se balance dans le vent, mais un arbre en général, le schéma généralisé en lequel nous sommes libres de reconnaître un hêtre, un chêne, un châtaignier… De l’arbre, l’autre face du signe présente le sens, l’arbre « signifié » et non manifesté, le concept abstrait et non le phénomène rencontré. Est-ce vraiment là le sens ? Nous ne voyons qu’un graffiti maladroit, un trait d’encre de diverses façons entrelacé. Les enfants, quand on leur demande de dessiner un arbre, savent mieux faire. La figure qui, selon Saussure, doit illustrer le texte, fait penser à ce célèbre tableau de Magritte sur lequel on voit, peinte avec un grand soin, avec la minutie du trompe-l’œil, une pipe (57). Notre œil la reconnaît, comme la main reconnaît dans le creux de la paume la pipe familière. Pourtant, sous l’image, ce ne sont pas les quatre lettres du mot « pipe » que le peintre inscrit, mais, d’une écriture studieuse et appliquée, cette phrase : « Ceci n’est pas une pipe ». Il semblerait que Magritte se moque de nous et que Saussure ait pour lui le bon sens. Nous retournons le tableau, dans l’espoir de faire apparaître une forme savamment dissimulée, mais sans succès : c’est une pipe pure et simple. Pas exactement : c’est de la couleur mêlée à l’essence de térébenthine et étalée sur une toile qu’on a recouverte d’un enduit. Ce n’est pas une pipe, c’est une peinture. Le peintre nous abuse en se jouant : nous disons « c’est un paysage, une scène de genre, etc. » quand il n’y a qu’un peu de pigment coloré écrasé sur le panneau. Du moins Magritte est-il assez honnête pour bien vouloir nous détromper. Saussure a moins de scrupule. Sous son petit gribouillage, il n’hésite pas à écrire : ceci est l’arbre signifié, son concept représenté. En vérité, Saussure est bien incapable de dire ce qu’est un arbre, et d’en énoncer le sens. Nous non plus. Sur les arbres, on pourrait rassembler toute une bibliothèque, du manuel du botaniste jusqu’à l’hymne du poète. C’est inutile, nous dira-t-on, il suffit de consulter les dictionnaires. Ceci, cependant, ne disent rien du sens, mais réfèrent un mot à d’autres mots, et sont bien contraints, en fin de compte, de revenir à leur point de départ. Pour le dictionnaire, un arbre, c’est toujours une grosse plante, et la plante, c’est un petit arbre. Le sens, qu’on nous avait dit pourtant « combiné » avec le signifiant, nous échappe. Le linguiste prétend le retenir prisonnier dans l’ellipse qui cerne le schéma, et maintient ensemble les deux faces du signe. Mais le sens, en s’esquivant, nous indique qu’il faut briser ce trait et transformer l’ellipse, selon la raison des projections coniques, en parabole. Le signifiant diverge, paraboliquement, sur le signifié. La définition s’ouvre sur l’inachevé. Le sens oriente la voie d’une recherche. Il n’est pas figure qui se montre, mais énigme qui donne à penser.
Le linguiste suppose que le signifié, dans le signe, se laisse représenter. Ce n’est peut-être qu’une illusion. Illusion nécessaire, il est vrai, puisque sans elle nous ne pourrions communiquer. Car enfin, je me fais bien comprendre quand je nomme l’arbre. Du moins faisons-nous semblant de nous comprendre, pour la commodité de l’échange. Les hommes sympathisent dans l’écoute du signe, ils font se converger l’attention vers un même point, porté à l’infini. Le signe ne circule pas comme circule la monnaie, qu’on soupèse dans le creux de la main, qui s’use par contact et se dévalue avec le temps (58). Le signe tourne nos regards dans la même direction, il nous appelle à penser ce que nous ne pensons pas encore. La monnaie n’est qu’un moyen, sa valeur intrinsèque nous est indifférente, elle ne vaut que par la marchandise dont elle permet l’acquisition. Mais quand le langage n’est qu’un moyen – moyen d’expression ou moyen de pression – alors nous parlons mal, nous ne répondons plus à l’appel du sens et les mots, sur nos lèvres inattentives, s’appauvrissent et se dévaluent (59). Pour bien parler, il faut savoir qu’on ne sait pas ce qu’on dit. Le poète et le philosophe s’étonnent du langage. Ils ne traduisent pas le concept dans le mot, le signifié dans le signifiant, mais interrogent le mot lui-même pour faire valoir le sens, ils font jouer le mot pour que le sens donne à penser. Ils ne l’utilisent pas : ils s’émerveillent de ses possibilités. Ce n’est pas le poète qui utilise le langage, mais le langage qui utilise le poète et le soumet, impérieusement, à la question du sens. Comment cela est-il possible ? Comment puis-je nommer ce que j’ignore ? Comment puis-je viser un sens que je ne connais pas ? Comment savoir ce qu’est un arbre ?
Quand l’esprit entend le mot, il se représente l’idée. Il ne griffonne pas, comme Saussure sur le cahier du cours, un dessin dérisoire, mais tourne son attention vers l’énigme lumineuse que le verbe fait poindre. Il se représente sans voir, mais écoute, attentif, le dieu qui va venir. Le signe représente sans image. Il fait tout le contraire du symbole qui, par la relation binaire du chiasme, représente l’image en occultant le sujet. La représentation symbolique subordonne l’hallucination de la forme manifeste à la forclusion de son double latent. Le mot ne se représente, sur la scène du préconscient, qu’en censurant la chose, sur l’autre scène inconsciente. Dans l’inconscient, la chose seule demeure, inaccessible au sens et sans mot pour la dire : « La représentation inconsciente, écrit Freud, est la représentation de la chose seule » (60). La chose est la prégnance de l’empreinte, le coup du réel que reçoit, fasciné, l’animal qui fait le mort. Les bêtes ne parlent pas. La terreur signalétique leur coupe la parole. Mais le sursaut différentiel que le rêve imprime au désir s’arrache à la fixité hypnotique du signal et produit, par bascule, des images instables. La logique symbolique distrait l’image du mutisme de l’inconscient, elle prélève sur le réel – qui demeure présent en-deçà du langage – une figure apparaissante que le discours du préconscient – par associations enchaînées – peut identifier et nommer : « Le système préconscient apparaît quand cette représentation de chose (c'est-à-dire : celle qui se trouve refoulée dans l’inconscient) est surinvestie du fait qu’elle est reliée aux représentations de mots qui lui correspondent » (61). Le symbole fait se correspondre le mot et la chose, connectés l’un à l’autre par le renversement du chiasme. Le mot ne représente la chose qu’à la condition d’en censurer la réalité. Il ne la nomme pas : il la dissimule. Le discours est le masque que le préconscient pose sur le réel. Le mot aveugle le point de regard. Dans le rêve, le désir ose – tout juste – l’occultation de la présence. Il se détache de l’empreinte par la « représentation du mot ». Hegel l’avait déjà dit avant Freud. L’Esprit, en sa phénoménologie, naît du langage avant de naître à l’échange. Le discours que tient le sujet ne s’adresse pas à l’autre conscience, qui aliène le désir, mais à la chose, à l’objet qui fait obstacle : en le nommant, le mot nie la singularité de l’existence sensible et pose l’universalité du concept (62). La représentation de mot est la négation de la représentation de chose qui lui correspond. Le mot ne désigne pas la chose, il la supprime. « L’image est détruite, écrit Hegel, et le mot la remplace […] Le langage est la disparition du monde sensible en son immédiate présence, la suppression de ce monde, dès lors transformé en une présence qui est un appel apte à éveiller un écho chez toute essence capable de représentation » (63). Ainsi le représentant symbolique est l’écho de la présence réelle, refoulée dans l’inconscient. Dans la forclusion de la chose par le mot, Hegel croit reconnaître le premier acte de la conscience. Ce n’est pourtant que préconscience, et non conscience, associations qui vont et viennent de signifiant en signifiant, selon les lois du chiasme, et non parole poétique qui délivre le sens du dipôle qui le retient prisonnier, et déploie le signifié sous les yeux de la conscience. Freud, ici, est plus précis : le mot qui se représente en occultant la chose appartient aux représentations du système préconscient. Nous reconnaissons là la loi du talion qui gouverne le symbolisme : c’est l’un ou l’autre, le mot ou la chose, et non les deux à la fois. La relation est disjonctive, jamais conjonctive. C’est dans la conscience seulement que peut s’accomplir selon Freud la juxtaposition des deux termes. La conscience pacifie la pensée, elle établit un traité entre les deux adversaires que l’ambivalence fait jouer l’un contre l’autre. Elle réconcilie les contraires. Elle transforme l’inversion symbolique en addition signifiante : « La représentation consciente englobe la représentation de mot correspondante, tandis que la représentation inconsciente est la représentation de la chose seule » (64). C’est ainsi en effet que le sens se représente à l’esprit. Comment cela est-il possible ? Comment le langage peut-il nommer sans supprimer, où la parole trouve-t-elle la force de surmonter la violence de la dénomination, quelle est la grâce qui met fin à l’hostilité du mot et de la chose, et leur enseigne l’amitié du poème ? Le chiasme est pourtant rigoureux : « L’image est détruite et le mot la remplace », écrivait Hegel. Mais la conscience regardante aperçoit à la fois l’image et le mot. La signification est l’enfant de cette alliance rare. La pensée attentive entend, claire et distincte, la consonance miraculeuse. Le sens est sur le point de naître.
Le symbole censure la présence. Le signe la magnifie sous le soleil levant de la pensée. Comment le signifié peut-il se représenter dans le signe ? Comment peut-il se montrer sous les yeux de la conscience ? La chose, dans l’inconscience, se représente en se présentant, elle fait acte de présence par l’empreinte du réel. La chose se représente sur le mode de la présence. Mais le sens se représente sur le mode de l’absence. Le signe conscient ne peut représenter la signification en faisant apparaître la réalité de la chose, son empreinte sensible, puisque « le mot la supprime ». Il ne peut la représenter que dans la béance qui s’ajoure par la disparition de la chose. Le sens se manifeste au regard de l’esprit par le mouvement de sa disparition, il fait signe à l’esprit en échappant à son regard, il se rend sensible par l’esquive et la fuite, et laisse ouverte la voie de la méthode. Il entretient l’amitié de la recherche. Le sens se représente sur le mode de l’absence. Absence n’est pas forclusion. La forclusion annule, brutalement, par l’opération du chiasme symbolique, le corrélat inconscient de l’hallucination préconsciente. Le symbole, toujours, escamote quelque chose. Mais le signe dévoile, il éclaire la conscience attentive et, glissant d’entre les doigts, l’emporte dans le sillage de la connaissance. Il commence un mouvement de valse qui ne prendra jamais fin, il inaugure une danse qui fait croître l’ivresse. Le face à face symbolique engage une polémique ; mais la poursuite du sens est un entraînement amoureux, une caresse perpétuelle, une invitation au voyage. Alêtheia est dévoilement : non pas le dévoilement de l’irréfutable, le mot de l’énigme enfin déchiffré, mais le mouvement du dévoilement lui-même, l’élan sans fin continué, l’andante de la symphonie intérieure. Le sens prolonge le saut du danseur, il amplifie son désir en accompagnant son effort, comme l’orchestre accompagne le piano. La vérité se refuse toujours, par amitié, à prononcer son dernier mot. Elle poursuit sans fin, en se laissant poursuivre, les fêtes galantes de l’esprit comme, sur les tableaux de Watteau, Mezzetin, malgré l’heure tardive, accorde sa guitare pour un dernier menuet. Le symbole aiguise le désir du prochain, la capture avide du latent qu’on pressent imminent. Le signe enseigne l’amour du lointain en prolongeant à perte de vue le paysage de la terre, en découvrant à la volonté l’espace immense de son interprétation. La fuite du sens est le vertige de l’esprit, et le vertige est la conscience maîtrisée du vide. Pour le regard qui tombe sous le coup de l’hypnose, cet arbre dont Saussure entreprenait le schéma est une empreinte irréversible, un réel définitif. Mais pour le poète qui apprend à le nommer, il est une énigme arborescente, une surprise phénoménale que la promesse d’un sens avenir illumine et dynamise. Il est l’avènement miraculeux d’une colonne qui s’élance, droite, à l’assaut du ciel. Dans l’évanescence du sens, l’arbre frémit sous le vent, dans le vent de l’Esprit. Il est la métaphore qui suscite la parole, qui murmure le poème mais ne divulgue pas le secret. Il est à la fois le sens et l’image, et irradie l’image par l’esquive dansante du sens. L’arbre se montre dans la lumière de l’Esprit, il apparaît dans la clarté matinale sur fond d’absence, comme apparaît avec l’aurore la promesse du jour qui vient (65). Cet arbre, ce n’est pas un arbre, mais une image de la pensée, une énigme qui se réfléchit. On peut dans son feuillage entendre le souffle du monde comme les anciens entendaient dans le bruissement des chênes la parole du dieu. Il est, si l’on veut, le miroir du rythme fondamental : « L’arbre est l’être du grand rythme, écrit Bachelard, le véritable être du rythme naturel. C’est lui qui est le plus net, le plus exact, le plus sûr, le plus riche, le plus exubérant dans ses manifestations rythmiques. La végétation ne connaît pas de contradiction. Il vient des nuages pour contredire le soleil des solstices. Aucune tempête n’empêche l’arbre, à son heure, de devenir vert » (66). L’arbre est encore, si l’on préfère, l’équivalent sensible de l’élan dionysiaque, le saut vigoureux du danseur qui frappe la terre et s’élève, les bras levés vers le ciel comme un feuillage qui se déploie, soulevé par le désir d’atteindre sa cime : « L’arbre seul, écrit Claudel, dans la nature, pour une raison typifique, est vertical, avec l’homme […] L’arbre s’exhausse par un effort, et cependant qu’il s’attache à la terre par la prise collective de ses racines, les membres multiples et divergents, atténués jusqu’au tissu fragile et sensible des feuilles, par où il va chercher dans l’air même et dans la lumière son point d’appui, constituent non seulement son geste, mais son acte essentiel et la condition de sa stature » (67). L’arbre représente la geste de l’esprit. Il représente bien d’autres choses encore, selon les mille et une fêtes de la pensée. Le poème s’élève avec l’arbre sans jamais atteindre le faîte. La parole éclaire le phénomène sans jamais le prendre sur le fait. L’arbre parle, il répond au mot qui l’appelle. Comme le mot magique qui dénoue le charme de l’empreinte et délivre la jeune fille prisonnière de l’écorce, ainsi le verbe poétique donne à l’arbre la parole. Ceci n’est pas un arbre, mais un hymne développé. Ceci n’est pas une pipe, mais un foyer incandescent. La pipe parle, elle trace en volutes la ligne quintessenciée de la méditation. Elle dit au poète le repos et la paix de la pensée attentive :
J’enlace et je berce son âme
Dans le réseau mobile et bleu
Qui monte de ma bouche en feu,
Et je roule un puissant dictame
Qui charme mon cœur et guérit
De ses fatigues mon esprit (68)
Le phénomène n’est pas l’empreinte. L’empreinte est la présence d’un réel invariable. Le phénomène est le mouvement de l’apparition – dont la nature, dit Aristote, est le principe – il est l’épanouissement de la chose dans la lumière du sens (69). La venue de la vérité est une phénoménologie de l’apparence. La vérité n’est pas le dogme, dont l’initié énonce impérativement la formule. La vérité est le mouvement du dévoilement, la caresse qui fait paraître le monde et naître sur les lèvres le commencement d’un mot. Le symbole masque la chose. La vérité la manifeste en s’effaçant devant elle. L’esprit a l’art et la sagesse de s’effacer devant lui-même. Comme la caresse qui recouvre la chair puis, s’effaçant, la fait se gonfler de jouissance, ainsi l’évanescence du sens laisse paraître la chose en majesté. La pensée entraînée par le geste de la co-naissance découvre progressivement le sens de la terre. Comme Arlequin, amoureux, poursuit Colombine, rieuse, ainsi le signifiant s’élance dans la forêt profonde à la poursuite du sens. L’étreinte fertile est source de vie, puis se délace et le jeu recommence. Eternel retour, perpétuel amour de la parole et du sens. L’idole, que le symbole hallucine, s’évanouit tandis que le phénomène se conçoit. Un sourire s’illumine quand le geste de la pensée amicale dévoile le visage. Le crépuscule des idoles est l’aurore du sens. Il faut remercier Dieu de nous avoir fait la grâce de son inexistence. La chose se signe quand elle pénètre dans la cathédrale du langage. L’arbre incline ses branches, il salue le poète et féconde le fruit de ses entrailles. De révérence en révérence, à la suite de l’ange – qui est le messager, le message qui appelle le mot – le rythme de la vie ouvre la danse. La scène tragique s’éclaire sous les feux du désir. Au lever du rideau, la représentation commence. Une volonté paraît et entame le chant.
L’art, selon Platon est mimêsis (70). Le peintre traduit, il trahit la forme pensée en la manifestant dans la présence, en l’incarnant dans l’idole. Il fait déchoir l’eidos en eidôlon. L’idole est la forme symbolique que le désir dans le rêve hallucine, elle est le regard de l’icône qui refoule le latent. L’image est une idée dépravée. Mais le langage aussi est mimêsis. Le mot, cependant, n’imite pas la chose comme le peintre son modèle. La mimêsis du peintre – l’homme que la tekhnê rend habile – se fait kata topon oraton, selon le visible, elle manifeste l’idée dans le jour de la présence, elle convoque par magie le sens sur le théâtre des apparences. Le peintre idolâtre l’apparence. Il produit un fantôme – phantasma – et fait croire aux revenants. Mais la mimêsis du dialecticien se fait kata topon noêton, selon l’intelligible, elle représente le sens par la visée de l’absence, elle oriente l’esprit vers cette issue qui, dans la caverne, s’ébrase vers la lumière (71). Elle convertit le regard dans la pensée de l’invisible. Les mots n’ont pas de sens, ils ont des significations. Ils poursuivent sans fin ce que nous ne savons pas encore nommer. Le dogmatisme rêve de capturer le sens dans le filet de la définition. La signification, qui est activité sémantique, force de production poétique, brise le cercle et fonde une méthode, elle ouvre une perspective qui est aussi la condition de possibilité d’un discours signifiant. Le sens peut être enfermé dans une formule : il est objectivable et réifié, et son mode de présentation est celui de tout objet conceptuel. La signification au contraire est un acte en voie de développement, elle limite un espace de liberté sans lequel le jeu des signes ne pourrait avoir lieu. Elle n’est pas elle-même concept, mais l’horizon sous lequel le concept se distingue. Le symbole a un sens qui n’est jamais manifeste. Le signe est une signification, qui ne cache rien, mais toujours appelle à penser.
L’idole – eidôlon – annule la réflexion par la proximité de sa présence. Le logos appelle la pensée à l’écoute du lointain, au point de fuite d’une perspective qui ne converge jamais, par l’ouverture qui donne sur l’invisible. La tekhnê imite par symboles ; le logos imite le signe. La vérité est dia-lectique, elle opère son dévoilement dans l’élément du langage. Le langage est le milieu mental de l’idée sur le point d’apparaître. La réminiscence se développe dans le révélateur du langage, comme la photographie dans le bain du révélateur. La torpille, toujours, nous glisse entre les mains. L’artiste est le possédé de la vérité, il adore le dieu présent, il adhère à l’idole comme l’animal à l’empreinte, comme la chaîne des anneaux maintenus en contact par la force de l’aimant (72). Par révélation hallucinée, la magie sophistique accole le signifiant avec le signifié, elle établit entre les deux un courant continu, elle ferme l’ellipse du signe (73). Par torpillages instantanés, la parole philosophique court-circuite l’hypnose continue de l’inspiré. Elle appelle à penser, par impulsions fugitives. Ainsi la torpille allume l’esprit, elle le saisit en se dessaisissant et l’emmène vers le large. Elle arrache le sens à l’aimant, à l’amant jaloux qui le retient, et le lance dans le lointain. Le langage représente sur le mode de l’absence. Le signe triomphe de la fascination symbolique (74). Il conjure l’envoûtement et ouvre la danse de l’esprit, qui est le mouvement de la maïeutique. Platon se méfie des poètes. C’est pour les avoir trop aimés dans le temps de sa jeunesse que Socrate, adulte, choisit de se prémunir contre leurs enchantements (75). Homère est un trop grand poète pour n’être pas dangereux. « Je m’exprimerai en prose, dit le philosophe, car je ne suis pas poète » (76). La critique platonicienne de la poésie n’est peut-être que le ressentiment d’une désillusion amoureuse. La philosophie est une méditation de la séparation. Platon confond le phénomène avec l’empreinte, la reconnaissance avec l’hallucination, l’apparence avec l’apparition. Amant déçu qui ne sait pas se déprendre de ce dont il fut épris, incapable de s’arracher à la fascination, il n’aperçoit de l’œuvre que son état achevé, il fixe son regard sur la forme symbolique. Il reste encore victime de l’hypnose qu’il a pourtant lui-même tant contribué à dénoncer. L’esthétique est poïétique, production du sens et non admiration pétrifiée. Le tableau n’est pas un symptôme. L’artiste ne rêve pas la beauté, il participe activement à son engendrement, selon les lois formulables de la maïeutique imaginante. L’œuvre n’est pas symbolique : elle est signifiante. Platon commence la philosophie. Soucieux de définir son acte propre – qui est la pensée attentive à la connaissance d’elle-même – il se distingue de ses rivaux et, pour mieux vanter son art, critique celui des poètes. Aristote, qui sait reconnaître en la tragédie le lieu essentiel où se manifeste la condition de l’homme, est plus philosophe que son maître. L’activité poétique est une philosophie naissante qui appelle à penser en illuminant le phénomène dans la visée du sens. Platon veut croire que l’image censure la pensée, quand elle lui communique au contraire son premier ébranlement, quand elle lui donne sa mesure et accompagne son rythme. L’idée selon Platon sublime l’apparence, elle dissipe l’objet qui fait obstacle à la pensée, et découvre l’invisible lumière au sein de laquelle toutes choses sont visibles. La pense ailée de Platon est trop légère, elle s’abîme dans l’absence, elle se fond dans l’invisible. Mais la pensée de l’éternel retour est la pensée la plus lourde. Par frappes répétées, le marteau résonne sur le monde, il interprète par rencontres le sens inépuisable de la terre. Le symbole occulte le réel. Mais le signe embellit le phénomène, il en révèle la beauté. Le sens, en s’absentant dans l’infini de la visée, sanctifie la forme, il l’auréole dans le nimbe de l’énigme, la dessine et la fait saillir, à la façon de l’arbre qui paraît plus grand et se découpe mieux quand on le voit sur fond d’azur. L’arbre signifie sous la caresse du signe, il fait effet de sens quand le sens s’esquive pour laisser le champ libre au déploiement de la parole. Chaque matin, le soleil se lève. Le signe, éternellement, retourne sur la terre. Le signal adhère au réel inconscient. Par écart différentiel, le symbole s’en détache et présente au désir préconscient l’image hallucinaire. Par le geste de la danse, le signe se délivre dans le lointain et représente le phénomène sous le regard de la conscience. Le langage appelle le monde, et le monde, en se représentant, répond à son appel. La pensée se prépare à l’accueil des apparences. Par la fenêtre du sens, le témoin perçoit l’annonce silencieuse du phénomène, il voit la forme merveilleuse qui s’avance sous nos yeux. La vérité vient à nous sur les pattes d’une colombe. Le regard est attentif. L’œil écoute.
L’imaginaire est symbolique : la relation binaire du chiasme hallucine l’image en annulant le sujet. L’imagination est poétique : elle est la puissance maïeutique qui engendre des œuvres, elle est sensibilité agissante qui suscite la forme dans la lumière de l’énigme. L’imaginaire fixe l’image sur le point de regard et aliène invariablement le sujet à son double. Mais pour l’imagination, l’image est une variable dans la fonction signifiante, elle se modifie et se renouvelle selon les perspectives changeantes que la signification oriente. L’imaginaire est une fascination passive. L’imagination est une opération réalisée. L’activité esthétique ne relève pas de l’imaginaire – comme le pensait Platon – mais de l’imagination qui seule a pouvoir de féconder la parole. L’imagination ne forme pas des images, elle les déforme, elle fait jouer le phénomène en le déplaçant dans la lumière de la signification, comme un cristal mobile colore dans le soleil une irisation changeante, un arc-en-ciel éphémère (77). L’œuvre manifeste l’énigme en la réfractant dans l’image imaginante. Le symbole forclôt le sens dans l’image imaginée. L’énigme s’éclaire par l’effacement du sens. Ce n’est pas le confus ni l’opaque qui est énigmatique, mais la clarté au contraire. Seule la lumière est insondable. L’énigme donne à penser en dégageant la visée de la perspective sémantique. Le symbole obture l’ouverture par inversions hallucinantes. Le symbole est mystérieux, et tous les mystères sont imaginaires. Les amateurs de symbole adorent le mystère, les connaissances occultes, les sagesses ésotériques, les initiations ténébreuses. Le mystère est la fascination du latent. Mais il n’y a d’énigme que dans l’éclat du manifeste, et rien n’est plus énigmatique que l’avènement du monde aux yeux de tous. Le mystère recouvre l’énigme. Le goût du mystérieux est aussi la haine de la pensée et le refoulement du sens. Je hais le mystère de la grande pyramide, les plates-formes aztèques pour l’atterrissage des extra-terrestres et l’orientation solaire des mégalithes de la préhistoire. Le matin des magiciens est toujours le crépuscule de la raison. Le mystère rêve au retour des idoles. La fascination – et non pas l’intelligence – de l’inconnu est toujours misologie. Le mystère est nazi – trésors cachés, serments secrets, cryptes oubliées. L’énigme – sa lumineuse blancheur – ne sourit qu’une fois effacé le mauvais œil des mauvais rêves, la prégnance du mystère. Le philosophe, enseigne Platon, doit savoir vaincre la fascination : aussi convient-il de confier son éducation à une mère amoureuse et souriante, qui « n’effraie pas ses enfants en leur contant mal à propos que certains dieux errent la nuit sous des traits d’étrangers de toutes sortes » (78). Le croquemitaine ne fait pas peur à la pensée : il la fait rire. Le diable n’est qu’un pauvre diable. Quand le mystère se dissipe, l’aurore du sens, riche de tous les possibles, peut se lever et bénir le monde. La nuit est mystérieuse, mais le jour se lève dans la clarté de l’énigme phénoménale. S’il faut en croire Hegel, le sphinx égyptien n’est pas un symbole, il est le symbole des symboles (79). Il est l’incarnation du mystère, la représentation hallucinante, monumentale, écrasante, d’un contenu latent qui prête un semblant de sens à la forme immobile. Le sens latent est toujours un pauvre sens. Mais le sphinx grec, haut perché sur sa colonne – qui est la sainteté de la droiture – les yeux grands ouverts pour ne rien perdre du jour, un sourire divin naissant à fleur de lèvres, les ailes frémissantes, dressé sur ses pattes de devant, est prêt à l’envol. Le sphinx grec écoute. Il regarde. Dans ses grands yeux clairs, nous ne devinons pas le mystère qui se réfléchit mais l’énigme qui se pense. S’il est là, debout, à la croisée des chemins, c’est pour que nous apprenions à l’effacer, pour que nous sachions à notre tour, comme jadis un certain fils de Thèbes, le précipiter dans l’abîme. Œdipe ne résout pas l’énigme, il la découvre plutôt. C’est une erreur de croire qu’une énigme est faite pour être résolue : elle est faite pour penser. Du temps où régnait le sphinx, où Laïos était souverain et Tirésias tout-puissant, le poids du mystère écrasait le désir. L’énigme n’était pas encore née : le sphinx vorace, affamé de sacrifices, assoiffé de sang, avait réponse à tout. Œdipe osera le blasphème, les Grecs, les premiers dans l’histoire du monde, oseront poser sur la gueule du monstre la lumière d’un sourire. Alors l’énigme soulèvera son voile et les hommes verront ce qu’Œdipe a su voir, ce qui crève les yeux, qu’ils sont eux-mêmes pour eux-mêmes des monstres incompréhensibles, des bêtes attachées à la terre comme l’enfant l’est à sa mère, comme Œdipe aux chevilles liées sur le mont du Cythéron, et qui marchent sur le chemin, à quatre pattes dans l’enfance craintive, sur deux jambes vigoureuses quand la volonté est ardente et s’appuyant sur une canne quand le poids de l’âge se fait sentir. Le mystère envoûte l’esprit, il s'empare de l’inconnu et l’installe dans la présence, par mirage imaginaire. Mais l’énigme éclaire la pensée, elle l’anime d’un souffle et découvre au regard de la conscience l’inconnaissance essentielle et l’absence de sens, elle fait voir l’évidence par l’audace fertile de l’imagination. Le plus énigmatique est le plus évident. Le plus simple est le plus difficile. Imaginer le sphinx, c’est en varier la forme, c’est le résoudre dans le jour. Le sphinx égyptien veille, éternellement, à la frontière du désert. Mais le sphinx érigé par les Naxiens, dans le sanctuaire de la Terre, à Delphes, est tout près du dieu lumineux qui ne parle que par énigmes. Il prête l’oreille à l’oracle. Il écoute le sens avenir.
La visée du sens caresse la chair des choses. L’éloignement du signifié est proportionnelle à l’avance du phénomène. Le mouvement de la représentation est l’acte propre de l’imagination. L’imagination poétique fait apparaître l’arbre en accompagnant la fuite du sens. L’énigme dit le sens le plus lointain, qui s’abîme dans le mouvement de sa disparition. Du sein de l’énigme, se manifeste l’évidence. La majesté de la terre réfléchit la lumière de l’énigme. C’est ainsi que le chant, en s’élevant, réfléchit le silence qui le précède, que la forme, en se manifestant, réfléchit l’invisible clarté qui la révèle. L’énigme dévoile le sens de la Terre. La représentation s’épanouit dans le jour que le sens fait se lever en s’absentant. « Le sens de la Terre » : cela ne veut pas dire que la Terre a un sens, mais bien au contraire qu’elle ne consent à se montrer que lorsque le sens s’est perdu. L’existence, dit-on, n’a pas de sens : il ne faut pas s’en plaindre, ni déclamer pour autant sur l’absurdité de notre condition, mais s’en réjouir, et bénir l’ouverture, l’innocence qui sont ainsi données. La vie des bêtes a un sens : aussi ne pensent-elles pas, mais obéissent aux ordres, aux empreintes signalétiques. Les rêves, dit Freud, ont un sens : c’est bien pourquoi ils n’ont aucune signification. Le symbole lance – ballein – contre le sens latent l’image hallucinée qui fait acte de présence. Le signe n’a pas un sens, il vise le sens le plus lointain. Il signifie, c'est-à-dire qu’il fait signe. Il enseigne. L’hallucination de l’image symbolique est l’effet du sens latent, imminent. Mais la représentation du phénomène provient du sens en voie de résolution, en voie de dissolution dans l’énigme. Je ne sais plus ce qu’est un arbre : alors seulement, l’arbre consent à se montrer en majesté. L’homme, en parlant, répond à l’appel de l’énigme comme le feu, en se ranimant, répond à l’appel du souffle qui s’engouffre dans la cheminée. « Il me semble que je découvre un chemin », écrit Descartes (80). La réflexion de la pensée attentive s’abîme dans la pensée incompréhensible – mais concevable cependant – du divin. « J’ai en quelque façon premièrement en moi la notion de l’infini que du fini » (81). Le fini s’aperçoit, clair et distinct, dans l’ouverture de l’infini. La signification qui se porte à l’infini ouvre la voie de la recherche. La méthode progresse dans l’énigme dévoilée. Elle élargit la parole qui tend vers la lacune que le sens, en s’absentant, ajoure. Le poème se déploie dans l’immensité d’un espace enfin libre. L’ouverture sémantique s’arrache à la clôture du dipôle symbolique qui, de signifiant en signifiant, reste sourd – absurde – à l’invitation du signifié. Ainsi le bond du danseur s’arrache à la terre, ainsi la flèche du signe s’élance vers le ciel étoilé. La volonté se dilate par expansion poétique. Diastole de l’esprit.
Le chiasme détermine les lois de la logique symbolique. La métaphore fait se diverger le sens dans l’ouverture signifiante. Par métaphore, je transporte le mot vers la signification avenir, je dégage la conscience attentive de sa fixation sur le présent, sur la présence, et la projette sur ce qui doit venir. La métaphore n’est pas un transport entre deux termes qu’on suppose définis, du sens propre au sens figuré, mais le lancer du poème dans la perspective de l’énigme, l’élan du désir qui le porte vers le plus lointain. Par métaphore, le signifié devance le signifiant, il est le signe avant-coureur et l’éclaireur de la conscience. Il y a poésie chaque fois que les mots pensent mieux que celui qui les prononce. La parole se déploie à la poursuite du sens. Le discours est toujours en retard sur les significations qu’il engendre. L’analogie est une équivalence close. La métaphore est une référence ouverte. L’analogie a pour fonction de résoudre l’inconnu dans le connu. Ainsi, écrit Leibniz, « Dieu est à l’égard des esprits non seulement ce qu’un inventeur est à sa Machine (comme Dieu l’est par rapport aux autres créatures), mais encore ce qu’un Prince est à ses sujets, et même un Père à ses enfants » (82). Trois termes supposés connus, le quatrième, inconnu, se laisse calculer. Mais la métaphore ouvre inversement le connu sur l’inconnu. Elle dévisage le plus familier avec les yeux de l’énigme, elle transporte le prochain dans la promesse du plus lointain. L’analogie conforte en vérifiant l’habitude. La métaphore dépayse en appelant à penser. Elle élargit l’allée du sens, elle libère la parole en faisant s’élever le chant, le largo du rythme fondamental. Trans-ire traduit meta-pherein : la métaphore est la transe du sens extasié par l’écoute de l’inouï. Le maître de l’Olympe enchaîne Prométhée sur l’énorme rocher, il veut soumettre l’insolence poétique et l’asservir à la puissance immobile. Hermès, l’envoyé de Zeus pour les vainqueurs, le « valet des dieux » pour le révolté, prédit au héros son destin : « Ton corps enfoui n’aura plus d’autre lit que l’étreinte du roc » (83). Force et Pouvoir réduisent le transgresseur au silence. Mais celui de qui les hommes tiennent le feu triomphe, sur la scène tragique, par la seule violence du verbe. Prométhée délivre la parole du bloc de la présence, la fait naître au chant et l’ouvre sur l’infini. Prométhée parle par métaphores, et toute métaphore est prométhéenne : attaché sur la pierre déserte, Prométhée regarde danser « le sourire innombrable des vagues marines » (84). La montagne est l’instrument de l’horreur sacrée ; mais la mer est la promesse que chérissent les hommes libres. La mer est métaphore : elle est l’ensemble infini de tous les chemins possibles. Sur la terre, la ligne de pente, l’écoulement des eaux et la trace de ceux qui nous ont précédés indiquent le chemin. Mais sur la mer, toutes les routes sont ouvertes, tous les parcours sont imaginables. Le sourire de la mer est une invitation au voyage. Purifiée de tous les monstres que les anciens cauchemars avaient hallucinés, illuminée et dorée, la mer est la voie royale, la brèche fabuleuse pour le grand départ, pour l’aventure pure et simple. L’Océan, et le chœur des Océanides, les filles de Téthys, sympathisent avec la cause du rebelle (85). Les dieux règnent sur la montagne olympienne. Mais les hommes, que brûlent le feu du désir, pensent devant la mer. « La mer sonore », dit le poète de l’Iliade (86). La mer résonne à l’appel du sens. Le sphinx est le symbole du symbole. Mais la mer est la métaphore de la métaphore. Elle est l’amplificateur de la voix qui signifie.
Tout signe fait signe par métaphore. La métaphore est la vérité du langage. La rhétorique classique oppose, à la métaphore, la métonymie (87). Le linguiste, analysant les troubles de l’aphasie, croit reconnaître, entre métaphore et métonymie, la double polarité qui structure la parole (88). Pour le psychanalyste, cette dichotomie recoupe celle, énoncée par Freud au sujet des mécanismes du rêve, entre condensation (métaphore) et déplacement (métonymie) (89). On a remarqué combien cette tentative pour ressusciter le vieux répertoire des tropes soulève plus de problèmes qu’il n’en résout (90). Les rhétoriqueurs ont établi un catalogue de figures, ils n’ont pas construit un ordre raisonné. Classer sans bien savoir ce qu’on classe est une entreprise toujours risquée. La rhétorique, qui tenait son autorité de la tradition, non de la réflexion, règle la pratique du style. Aucune théorie véritable ne la fonde (91). Le couple métaphore-métonymie est une opposition technique, un repère commode pour le métier d’écriture. On ne saurait l’élever à la dignité du concept. Est-ce seulement une opposition ? Prométhée appelle à son aide la mer souriante. C’est une métaphore, par similitude : la mer s’éclaire avec l’aurore, à la façon du visage que le sourire illumine. Pourtant, « le sourire innombrable des vagues marines » dit la mer par l’éclat du soleil sur la crête dansante, il dit :
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume.
« Scintillation sereine », écrit encore Valéry (92). La mer est l’image mobile de l’immobile éternité, et l’éternité, enfin retrouvée, « c’est la mer allée avec le soleil » (93). Nommer la méditerranée par l’éclat, c’est rapporter l’espace infini au point, l’immensité à l’infime. C’est déplacer le sens, c’est designer la mer non par la mer elle-même, mais par le miroitement qui la manifeste. C’est métonymie, par correspondance.
Rimbaud évoque l’enfant-poète :
En bas, – seul et couché sur des pièces de toile
Ecrue, et pressentant violemment la voile ! (94)
Voile pour navire, c’est métonymie, diront les doctes. Métonymie motivée toutefois : on ne peut remplacer indifféremment par « grappin » ni « cabestan ». Seule la voile a valeur métonymique pour dire le navire : c’est seulement toutes ailes déployées, quand les voiles blanches se gonflent sous le vent, que le navire emporté vers le large se montre en majesté. La voile n’est pas une partie du navire, elle est l’essence de son être, sa forme véritable, sa vérité manifestée. La voile est la vraie métaphore du navire puisqu’elle fait naître dans l’esprit, par association, irrésistiblement, l’assaut de la proue contre l’écume en lequel se résume « l’idée » du navire. La voile, par euphorie, suggère le navire. Elle fait apparaître l’image. Elle est métaphorique. C’est encore par métonymie qu’on dit, croit-on, « boire un verre » : on ne boit pas le verre, mais l’eau qu’il contient. Cette figure pourtant n’est possible que parce que le verre est la métaphore matérielle de l’eau, son équivalent solidifié. On dira moins volontiers « boire un pichet de terre, ou de bois ». C’est par métaphore que Rousseau se fait entendre quand il dit « le cristal des fontaines » (95). C’est par métaphore que nous buvons « le verre ». « Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour » : est-ce métonymie ? Les yeux sont à la marquise ce que la voile est au bateau, ce que le verre est à l’eau. La marquise, sans doute, n’a pas que des yeux, et c’est précisément pourquoi on se meurt d’amour pour elle. Mais l’éclat de la prunelle est le point, l’origine de la capture amoureuse. Le corps, la chair désirable ont pris forme depuis cette étincelle de vie, cette semence première. La marquise tout entière est née du point de regard qui subjugue l’amant. Le corps intégral est une dérivation, par similitude et transfert, des yeux étincelants de la séductrice. Métaphore, donc…
Métonymie, métaphore : l’opposition est superficielle. Toute métonymie analysée se révèle être métaphore. Dans l’un ou l’autre cas, l’effet sémantique est le même : ce n’est jamais la chose – l’empreinte isolée dans l’inconscient – mais le phénomène rayonnant, sa présence irradiée que désigne la conscience. Le référent n’est pas une réalité définie, mais une énigme en voie de développement. Le mot ne vise pas « la chose », mais la frange lumineuse, le nimbe qui ouvre la chose au-delà d’elle-même. La chose en s’absentant fait signe à la parole,
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt. (96)
Le sens fait éclore dans le réel le sourire du possible, il promet un bonheur avenir comme la marquise, offrant la beauté de ses yeux, ose l’aveu du désir. L’expansion du sens, la maïeutique imaginante sont le propre de l’activité poétique. Toute parole est métaphore. Les gens de bon sens veulent qu’on nomme les choses par leur nom, et qu’on appelle un chat, un chat. S’ils y tiennent tant, c’est parce qu’ils savent bien qu’un chat, c’est toujours plus qu’un chat. Pour le dire, il faut lancer le mot à la poursuite d’un sens qui, d’un bond, nous échappe, plus agile encore que l’animal lui-même. Un chat n’est pas un chat, mais une créature magique qui apparaît par miracle et s’évanouit par enchantement. Les Egyptiens, qui embaumaient son cadavre et dégageaient du granit sa forme idéale, le prenaient pour un dieu. Baudelaire s’en souvient quand il dit les chats comme « des grands sphinx allongés au fond des solitudes » (97). Un chat, c’est, pour Lewis Carroll, un sourire qui demeure suspendu en l’air quelques instants après que la bête se soit effacée (98). Un chat, c’est tout ce qu’on veut, mais certainement pas un chat. Le chat ne répond guère à l’appel de son nom et s’éclipse quand on veut le saisir. La chose ne répond pas à l’appel du mot, mais se dissipe, par métaphore, et laisse le champ libre au poème. La métaphore n’est pas un luxe inutile et vain, la tournure affectée du style précieux : elle est l’unique voie qui se dirige infiniment vers la signification jamais rejointe. La métaphore ne se laisse pas traduire : elle se file, elle file au fil des mots la forme inachevée du phénomène. La métaphore dit ce qu’elle veut dire, et dit chaque fois davantage en apprenant à le dire : « Il s’est trouvé quelqu'un d’assez malhonnête, écrit André Breton, pour dresser un jour, dans une notice d’anthologie, la table de quelques-unes des images que nous présente l’œuvre d’un des plus grands poètes vivants ; on y lisait :
Lendemain de chenille en tenue de bal veut dire : papillon.
Mamelle de cristal veut dire : une carafe.
Etc. Non, monsieur, ne veut pas dire. Rentrez votre papillon dans votre carafe. Ce que Saint-Pol Roux a voulu dire, soyez certain qu’il l’a dit » (99).
Du symbole au signe, de l’animalité à l’humanité, la rupture fondatrice – l’événement tragique – est bien celle que Platon désigne dans Le Banquet : la rencontre de la beauté. L’art travaille à la charnière du symbolique et du poétique, il a pour tâche de dénouer le cercle symbolique sur le vide lumineux du sens. Dionysos est un dieu qui délie. L’art enseigne le sens de la terre. Il conjure le cercle de la fascination, il parabolise le sens sur la trajectoire de la visée sémantique, il le fait parole et parabole. L’étymologie est un guide sûr : parole vient du latin ecclésiastique parabola, parole du Christ. La parole vivante est une parabole divine. Paraballein, c’est jeter un trait (ballein) non sur la cible, mais à côté de, le long de (para) la route qui se lance à la poursuite du sens, à la façon de la perspective qui converge vers le point de fuite porté à l’infini. La perspective parabolise l’image, elle transforme la présence verticale de l’empreinte hallucinaire par la nativité perpétuelle du phénomène dans la représentation de la conscience. Le symbole jette l’image sous les yeux, en occultant simultanément la chose refoulée dans l’inconscient, par bascule instantanée. La parabole préserve l’amitié du phénomène en traçant un chemin parallèle qui fait valoir son aspect et varier le point de vue. La parole lance la voie, elle ouvre la voie par la visée de l’essence. Elle ne définit pas le mot, elle ne le finit pas, elle le signifie et le libère en élargissant l’amplitude de son champ. L’art de bien nommer s’apparente au lancer du javelot, ou bien encore au tir à l’arc. La parole est divine – la parabole fleurit sur les lèvres du Fils de Dieu – puisqu’elle prend son essor et transgresse les limites de l’expérience humaine, puisqu’elle outrepasse les données et se dirige vers le non encore présent qui s’annonce dans le plus lointain. Le javelot lancé décrit une parabole. La parabole est la trajectoire de ce qui s’élance. La pensée est le mouvement parabolique qui répond à l’appel de ce qui la dépasse. L’animal vient buter contre l’obstacle de la présence : le réel limite son désir et fixe sa nature. Mais la pensée, par parabole, crève l’écran de la fascination et se transporte vers l’absence qui fait signe. Elle rend l’homme disponible pour la promesse de son histoire.
Toute vie est désir, extraversions, par rencontres sensibles, de l’organisme vers le monde qui l’appelle et l’excite à dépasser ses propres limites. A l’inverse des lois qui gouvernent la matière inanimée, la logique du vivant se calcule, non par sa structure propre, mais par les rencontres qui font signe et l’incitent à se porter au-delà, vers l’extériorité phénoménale. Vivre, c’est être au monde, c’est se maintenir, sensible, dans l’étonnement de la mise au monde. L’animal, dit-on, a une nature. Il ne la tient cependant pas de sa seule constitution interne – qui suffit pourtant à définir la chose – mais du milieu dans lequel il se trouve plongé, aliéné à l’image que l’interprétation esthétique propose à son désir. La nature de l’objet est suffisamment déterminée par la connaissance de sa structure intrinsèque : je sais tout du polyèdre cristallin quand je sais qu’il se compose d’un « motif » moléculaire indéfiniment répété, par nœuds et par mailles. Mais la dissection du cadavre ne suffit pas à déterminer complètement le comportement de l’animal vivant, qui agit en réagissant au monde qui le stimule. La chose se ferme sur sa propre structure. Elle trouve en elle le point de son équilibre, et le sens de sa gravité. Mais la vie s’ouvre sur ce qui la dépasse, elle répond, par la saisie de la forme, à la rencontre qui l’enivre. Excentrique, excentrée, elle se maintient, fragile, en situation instable, au seuil critique où le plus improbable conserve toutes ses chances, où le hasard est le plus fécond, où le jeu, sans fin, se renouvelle.
L’insurrection de la vie s’accomplit cependant par degrés. De l’animal à l’homme, l’ivresse est croissante. La bête se loge encore dans la niche que lui assigne son écologie. Les degrés de sa liberté se répartissent entre les bornes rigoureuses de son « territoire ». L’animal a, en effet, une nature : son répondant est un réel invariable qui subjugue son désir, par fixations et par empreintes. La portée du désir animal est limitée par identification aux objets signalétiques dont l’ensemble définit le code des valeurs efficientes pour le comportement de l’espèce. La vie de la bête est aliénée à l’ordre immuable du monde qui l’impressionne, aux signaux constants et dénombrables qui commandent son désir. Mais le désir de l’homme n’est pas fixé sur cet objet, ni lié à cette rencontre : il est libre, il le demeure du moins tant qu’il sait se rendre disponible pour toute rencontre nouvelle. Le monde humain n’est jamais fait, il est toujours à faire. « L’homme est, selon Nietzsche, l’animal estimateur par excellence » (100). Lui seul peut interpréter le monde et le transformer selon les occasions que le hasard lui ménage. Lui seul est son histoire.
Le soulèvement du désir s’engouffre dans l’espace libéré par l’essor de la signification. En l’homme seul, cet essor ne connaît pas de borne, et s’ouvre sur l’infini. L’homme seul est poète. Lui seul ose l’initiative de la parole et répond au vide illimité qui se découvre à sa venue. L’indétermination radicale du désir humain réfléchit l’indétermination de l’objet qui prend valeur à ses yeux. L’homme est le seul vivant qui a cette chance prodigieuse de ne pas savoir ce qu’il désire. Le phénomène représenté définit la cible du désir animal, il fait se converger son attention. Le désir de l’homme diverge inversement sur l’univers toujours improbable qu’à chaque instant la sensation fait surgir devant lui. Aucun objet privilégié ne peut prétendre captiver pour toujours son désir. La disponibilité de son regard, que l’habitude menace mais que préserve pourtant son indétermination originaire, le met à la merci du hasard. L’admiration, qui naît de la surprise, est en l’homme, s’il faut en croire Descartes, la première des passions, l’ouverture fondatrice qui donne le jour à la représentation et induit le déploiement de la parole signifiante (101). Le désir porte l’animal vers l’objet qui le fixe, par capture hallucinaire. Mais il élargit la liberté de l’homme dans un avenir improuvé, un univers que rien n’achève, et découvre à la conscience le champ des possibles dont aucune expérience, si passionnée soit-elle, ne saurait épuiser la fécondité. Ce n’est pas la chose – telle qu’elle se signifie à lui dans le saisissement de la rencontre – qui détermine en l’homme le soulèvement du désir, mais l’espace infini, libre encore de toute détermination effective, au sein duquel toute définition, toute cristallisation, est à chaque instant imminente. Le ciel, la mer, le désert, sont pour l’animal qui n’y est pas adapté des spectacles indifférents. Quand elle rencontre les immensités vacantes, où rien n’accroche son désir, la bête ne désire rien. Mais l’homme aperçoit, dans le vide lumineux que rien ne vient encombrer, la métaphore sensible de l’amplitude désirante qui, en lui, diverge sur l’infini et préserve le possible. Son désir, que rien ne fixe, reconnaît dans l’expansion de l’espace maximal, l’image réfléchie de sa liberté. Pour l’homme seul, le vide est plein de sens. La béance de l’abîme inhabité est ouverture signifiante. L’homme libre rêve devant la mer, infiniment. Il rêve infiniment sous le ciel étoilé, aussi vaste au-dessus de sa tête que la liberté dans le fond de son cœur. Le silence éternel des espaces infinis me ravit. Le monde, duquel l’animal demeure le prisonnier rigoureux, est fermé. Mais l’univers, en lequel l’homme reconnaît l’écho du désir qui est le sien, est ouvert. De ce que rien ne saurait accaparer son désir, il ne faut pas conclure que l’homme ne désire rien, mais au contraire que c’est l’absence d’objet qui provoque en lui l’ivresse la plus intense. L’homme est cet animal pour qui l’absence même a force de sens, pour qui toute valeur se dessine sur fond d’absence, pour qui toute détermination naît de l’indéterminé et toute rencontre du hasard. Le monde symbolique se clôt sur lui-même, selon la fermeture exacte du cercle herméneutique. Prisonnier de la syntaxe, le signifié, toujours renvoyé de signifiant en signifiant, ne découvre jamais l’issue qui lui permettrait de prendre son essor. L’univers seul est signifiant, puisque lui seul élargit la signification qui se porte à l’infini en manifestant le phénomène. C’est en s’absentant que le sens fait paraître la présence. En l’homme, le désir s’exalte tandis que l’énigme se découvre. La parole admirable, admirante, se lance à la poursuite du signe qui lui échappe. Elle suit la piste que trace la série divergente des rencontres. Elle cède à l’ivresse du désir.
L’expansion de l’espace sémantique est le développement poétique de la fulgurance initiale. L’impact de la rencontre détermine la parabole du sens. Le choc renversant, la syncope première définit l’attaque rythmique de la connaissance esthétique. Le second temps diffuse, par le travail du texte et l’élaboration de l’imagination, la merveille cristallisée un instant sur le point de regard. Le signe s’efface par l’énoncé du sens et le sens prolonge, dans le réseau du langage, l’onde de choc provoquée par la rencontre. L’intuition rythmique est l’horizon transcendantal de notre connaissance esthétique. La théorie de la rencontre et la théorie de la signification analysent et dissocient les deux temps qui scandent l’ïambe fondamental. Si le néant d’objet est signifiant pour l’homme, c’est parce que l’homme aperçoit le phénomène depuis le rythme qui le suscite. Le rythme donne sens et valeur à la lacune qui le cadence. L’intervalle vide qui sépare les frappes de la sensation est lui-même sensible. Les typographes ne disent-ils pas, du blanc qui sépare les mots, qu’il est un « signe » ? La musique fait entendre le silence ; le rythme incarne l’absence. Dans le néant momentané, la sensibilité se rend disponible au recommencement de la surprise. Ainsi, la représentation phénoménale naît de la rencontre aveuglante, comme le chant s’élève de la syncope qui, un instant, le suspend. Toute apparition prend appui sur une disparition qui la fonde. Par rencontre et poésie, par signe et signification, le gai savoir rythme la danse du vivant. L’activité esthétique s’alimente à cette source intermittente, comme l’évolution du danseur s’entretient de l’éternel retour de la chute et du saut. L’imaginaire s’immobilise sur le temps fort de la rencontre ; l’imagination s’arrache à l’image captivante et prend appui sur elle pour s’élancer dans la clarté découverte, dans le jour qui se lève. Le phénomène, que l’œuvre manifeste, est la trace du pas que l’élan vient imprimer sur la terre. Le sens de la terre s’interprète pas à pas, infiniment, selon les gerbes illuminantes que soulève à chaque rebond le marteau sur l’enclume. Le sourire innombrable des vagues marines se cristallise et se fixe sur le visage unique qui, par la grâce d’une rencontre me voit et me sourit. Et le visage lui-même se dilue dans l’océan du multiple et de l’improbable, d’où le prodige, à nouveau, surgira par surprise. La forme est intermittente sur le balancement des flots. La mer sourit. La bête, assujettie à la présence, demeure stupide, sous l’empire de la fascination. L’homme répond par le poème à l’occasion qui fait signe, selon l’oscillation de la vague.
Depuis le romantisme, la théorie classique demeure captivée par le mystère symbolique. A la suite de Platon, elle confond la vérité de l’œuvre d'art avec l’hypnose que son image suscite, elle croit connaître la beauté quand elle s’est laissé envoûter par un charme apprêtée. L’esthétique poétique, qui trouve son fondement dans l’analyse aristotélicienne de la tragédie, rompt le cercle de la fascination et développe le sens par la mise à jour de l’énigme d’où procède le phénomène. Elle transforme la rencontre en métaphore et le signe en signification. L’artiste énonce le thème : le premier, il fait valoir la promesse du sens, il détache le regard de l’image saisissante et l’oriente dans la visée de l’énigme. Le discours esthétique est une libre variation sur le thème imposé par l’œuvre, libre dans la mesure où elle répond aux possibilités infinies, toujours ouvertes et jamais épuisées, du champ sémantique, mais déterminée cependant dans la mesure où elle obéit aux lois rythmiques qui originent l’expansion de la signification poétique dans l’instant ponctuel où le signe fait valoir son droit de regard. Bien des discours – une infinité – s’ajustent au tableau et consonnent avec lui, de même qu’il suffit au musicien habile d’un thème unique et simple – les quelques notes d’un refrain d’enfant – pour tisser autour de lui la dentelle éblouissante des variations possibles. L’invention est libre, mais non pas chaotique, puisqu’elle prend appui sur le mot déjà proféré, sur l’appât que tend à l’imagination l’œuvre élaborée. Ainsi les variations de Beethoven commentent la valse composée par Diabelli. Ainsi le discours esthétique commente le tableau où le sens se contient, il élargit l’amplitude poétique à la façon de ces fleurs de papier séché, qui, nous rappelle Proust, plongées dans une tasse de thé, font éclore tout un jardin (102). L’artiste travaille l’origine, il répond aux suggestions du pur hasard, son attention demeure disponible pour la saisie de l’improbable. L’esthéticien réfléchit ce travail fondateur, il cultive l’amitié du sens et participe à sa prolifération poétique à la façon du jardinier qui sait amoureusement faire germer la semence. Il élève l’œuvre à la seconde puissance, il multiplie les variations dans l’espace de libre jeu que l’œuvre élargit contre l’obstacle du réel. Parler peinture, c’est réussir la délivrance du poème qui fait signe dans le tableau. L’artiste tente le hasard le plus radical. L’esthéticien joue dans la marge de liberté que limite l’ouverture perspective de l’œuvre. Il ne nie pas le hasard – qui conditionne la rencontre – mais en réduit l’écart. Il explore librement les possibilités d’un champ dont l’œuvre détermine l’orientation.
C’est pourquoi tous les commentaires se répondent, comme se répondent les variations imaginées par le musicien sur un thème obligé. La cellule rythmique, qui donne à l’invention sa ponctuation et sa méthode, est l’unique invariant de l’exégèse poétique. J’ai entrepris de donner la parole à la peinture. Je me suis efforcé de demeurer attentif aux suggestions qui font signe dans le tableau. Ma recherche s’est d’abord égarée dans le labyrinthe inextricable des proliférations sémantiques qui, jalouses de la liberté qui les fait vivre, résistent contre l’esprit de système qui prétend les réduire. Toutefois, en laissant le commentaire aller son allure libre, l’invariance d’un rythme s’est progressivement fait jour et m’a donné la mesure. La méthode a fait valoir ses raisons. Les analyses se sont ordonnées et chaque thème, tout en préservant sa liberté, a trouvé sa place dans la symphonie. C’est une entreprise vaine que de vouloir déterminer le langage qui seul convient à l’œuvre. Mais il est fécond de reconnaître, parmi tous les langages possibles, la scansion rigoureuse d’un thème invariable. C’est en apprenant à l’entendre qu’on apprend à jouer juste. La majesté spectaculaire est la donation qui s’offre librement à la sensibilité qui sait se rendre disponible. Le revers hallucinaire détermine la rencontre saisissante, l’attaque rythmique qui donne son élan à la parole poétique. L’expansion de la signification élargit alors l’espace onirique qui prolonge l’instant discret de la saisie dans le flux continu du devenir. L’amplitude de la divergence résout le point de regard en découvrant la clarté de l’énigme que nul objet, nul obstacle ne vient offusquer. Ainsi l’intuition esthétique, par travail poétique, retrouve l’état de grâce et la disponibilité qui rendent possible l’avènement d’une nouvelle majesté. Le phénomène se renouvelle en délivrant la signification. La peinture engendre la peinture.
Le tableau n’est pas un symptôme, l’art n’est pas une névrose. La psychanalyse, quand elle a cru pouvoir « s’appliquer » au travail de l’artiste, s’est fourvoyée. Le contresens que commet Freud, dans son essai sur Léonard, est riche d’enseignement. Ce n’est pas par une faute d’inattention, mais par un lapsus qui en dit long sur les défaillances de sa méthode, que Freud reprend à son compte l’erreur du traducteur qui fait de nibbio un vautour, et non pas un milan (103). Le père de la psychanalyse cède par là à la tentation égyptienne – qui n’est autre que la fascination du mystère symbolique – qui a toujours hanté son œuvre. Le roman de la mère abandonnée, le mélodrame de l’inceste déçu valent moins pour l’œuvre du peintre que pour l’imaginaire de l’analyste. Ce n’est pas Léonard, mais bien Freud qui hallucine la mère – die Mutter – dans le nom de la déesse Mout (104). Le vautour est une réminiscence de l’un de ces dieux égyptiens à tête d’épervier qui, dans un rêve d’enfance rapporté par Freud lui-même, emportent le lit mortuaire où gît le cadavre de la mère (105). La persistance du fantasme – celui de Freud et non celui de Léonard – résiste et fait obstacle à l’intelligence de l’analyse. Le pesant appareil de la mythologie symbolique qui étouffe et recouvre l’ouverture signifiante que le tableau découvre, comme le trait grossier que Pfister croit bon de crayonner sur le tableau du Louvre, insultent la grâce de la Vierge et de sainte Anne. L’article de Meyer Schapiro, qui ne laisse à peu près rien de la construction imaginée par Freud, énonce ce qui est une évidence pour tout lecteur familier des Carnets : le prétendu souvenir d’enfance n’est qu’une tournure rhétorique, affectée et précieuse selon la mode du temps, par laquelle Léonard entendait commencer son traité sur le vol des oiseaux. Comme les abeilles du mont Hymette qui, dit-on, butinaient leur miel sur les lèvres de Platon, ainsi Léonard se plaît à imaginer que le milan, le plus virtuose des acrobates aériens, battant de sa queue – qui est, selon un autre passage, pour l’oiseau ce que le gouvernail est au navire (106) – les lèvres de l’enfant, lui communique le souffle et l’esprit du vol, et le prédestine pour en connaître les secrets (107). Ce n’est pas le seul endroit où Léonard, qui n’avouait pourtant d’autre maître que la nature, s’exerce aux effets de style, aux expressions affectées qui étaient de mise chez les poètes de Cour. Freud se laisse égarer par l’impatience qui le pousse à deviner un sens qu’il imagine être latent. Non, le milan ne dit rien de l’empreinte inconsciente de l’image maternelle : il est au contraire un artifice allégorique, trop étudié, trop pesamment conscient, qui doit servir d’introduction aux considérations expérimentales accumulées par Léonard. Ainsi le psychanalyste, victime de sa propre fascination, hallucine le fantasme là où il faudrait savoir démonter le travail du poète. L’interprétation poétique de l’œuvre d’art s’oppose à l’interprétation psychanalytique comme le déploiement de la visée sémantique, qui prend son essor à la façon de l’oiseau rêvé par Léonard, s’oppose à la prégnance de l’image symbolique dont la présence est d’autant plus fascinante qu’elle refoule mieux le sujet. Le travail de l’imagination, fécondé par l’œuvre, déjoue la fixation qui rive le regard du préconscient sur l’empreinte hallucinaire. Toute vie s’expose au risque du rêve. Mais n’est pas artiste qui veut. L’art apprend à guérir du traumatisme de la rencontre en accompagnant le mouvement du phénomène dans la lumière de l’énigme, où le sens s’élance, puis s’évanouit. Ce n’est pas pour adorer l’idole que le peintre recommence le tableau, mais pour la précipiter dans l’abîme – qui est la réflexion infinie de la pensée avec elle-même – comme le fit autrefois Œdipe avec le Sphinx. Léonard est meilleur analyste que Freud lui-même. Sur les lèvres de l’ange androgyne, il pose un sourire naissant. Le poème est sur le point de naître, l’œuvre apprête le champ de la parole. Le rythme fondamental articule l’instantanéité de la saisie avec l’expansion poétique. La théorie de la signification accomplit les promesses qui se cristallisent sur le point de la rencontre. Le peintre ne succombe pas, pétrifié, au mauvais sort que jette le regard fascinant. Il s’en détache au contraire et commence un mouvement de danse qui donne au langage sa vraie mesure. Il interprète le sens de la terre par l’univers au sein duquel le sens s’est absenté. Il n’est nulle part de secret qui attende son déchiffrement. Il n’y a de toutes parts que la clarté manifeste qui appelle la main du peintre à se saisir de la forme évidente, et la parole du poète à en moduler le sens, selon le jeu des variations. L’art épouse le rythme de la majesté et de la signification qui se répondent l’une l’autre. Il fait se retourner vers nous, éternellement, la bête aux yeux de prodiges. En découvrant le sortilège, il perpétue l’admiration. Il recommence, éternellement, l’étonnement de l’origine.
NOTES
1- Les travaux de Helmholtz portent surtout sur la musique et l’acoustique. Pour les arts plastiques, on lira, de cet auteur, « L’optique et la peinture » dans Ernst Wilhelm von Brücke, Principes scientifiques des beaux-arts, essais et fragments de théorie (Paris, Gerner Baillère, 1878).
2- « Nietzsche va même jusqu’à recourir à des ouvrages de physique, de chimie et de biologie parus à cette époque (1881-1882), et dans ses lettres datées de ces années il agite le projet d’aller faire des études de sciences naturelles et de mathématique en quelque grande université » (Heidegger, Nietzsche, 1971, tome I, p. 266). Sur ce thème, on lira avec profit l'excellent petit essai de Barbara Stiegler, Nietzsche et la biologie, « Philosophies », PUF, 2001.
3- Francis Crick, « Réflexions sur le cerveau », Pour la Science, n° 25, novembre 1979 : « S’il est une idée dont nous devrions nous méfier, c’est, selon moi, celle de “l’homunculeˮ. Récemment j’essayais désespérément d’expliquer à une femme intelligente le problème de la perception. Comme elle ne parvenait pas à comprendre où il résidait, je finis par lui demandait, en désespoir de cause, comment elle croyait voir le monde. Elle me répondit qu’elle croyait avoir à l’intérieur de la tête une sorte de récepteur de télévision. “Et alors, demandais-je, qui le regarde ?ˮ Instantanément, elle comprit le problème. »
4- Sur le thème de l’empreinte animale, voir Konrad Lorenz, Essai sur le comportement animal et humain (Paris, Le Seuil, 1970, chap. I et II). Egalement Jean-Marie Vidal, « L’empreinte chez les animaux », La Recherche, n° 63, janvier 1976, p. 24-35 (avec bibliographie).
5- « Contrairement à ce que l’on observe chez la plupart des Invertébrés, l’action de la lumière sur les photorécepteurs des Vertébrés se traduit par une hyperpolarisation » : Yves Gallifret, article « Vision (Physiologie) », Encyclopedia Universalis, Paris, 198, tome 18, p. 890.
6- Roger Caillois, Le mimétisme animal, Paris, Hachette, 1963. Ce thème avait déjà été esquissé par le même auteur dans Le Mythe et l’homme, chapitre « Mimétisme et Psychasténie », et dans Méduse et Cie, la dernière partie. Egalement Adolf Portmann, Animal Forms and Patterns : A Study of the Appearance of Animals, Londres, 1952, traduction anglaise de Die Tiergestalt, 1948. La traduction française de ce livre fondamental, autrefois chez Payot, sous le titre La Forme animale, vient d’être republiée en 2013 aux éditions La Bibliothèque, Paris, avec une préface de Jacques Dewitte. Ce texte inspire Merleau-Ponty dans Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 298 sq. ; ainsi que Jacques Lacan, Séminaire XI, Paris, Le Seuil, 1973, p. 91-92.
7- Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 1966, « Communication animale et langage humain », tome I, p. 56-62.
8- Cité par T. Todorov, Théories du symbole, 1977, p. 242.
9- E. Kant, Critique de la faculté de juger, 1965, § 59, p. 175.
10- Idem, § 59, « De la beauté comme symbole de la moralité », p. 173 sq.
12- F. W. Schelling, Introduction à la philosophie de la mythologie, tome I, 1945, leçons VIII à X : la philosophie découvre, selon Schelling, dans la mythologie, « un processus théogonique » qui manifeste la vérité dans l’intériorité de la conscience. Sur la question du symbolisme chez Schelling, voir également « Schème, allégorie, symbole », dans Textes esthétiques, prés. X. Tilliette, Klincksieck, 1968, p. 45-49.
13- L’art symbolique est le premier moment de l’Idée qui se cherche encore obscurément – inconsciemment – dans la forme extérieure, sans réussir pourtant à ce que réussira l’art classique : la représentation adéquate de soi-même. Voir « L’art symbolique », dans Esthétique, trad. S. Jankélévitch, 1979, tome II.
14- Ainsi Todorov (Théories du symbole, 1977, p. 357) se reconnaît romantique et n’en prend conscience qu’à la fin de son ouvrage, tout en affirmant, un peu rapidement peut-être, que par cette seule conscience, il cesse de l’être : « J’étais “romantiqueˮ au moment où je commençais à écrire ces pages ; parvenu à la fin, je ne pouvais le rester : je me vois autre. »
15- Schelling, cité par T. Todorov, Théories du symbole, 1977, p. 246.
16- F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 1974, p. 101.
17- J. J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, chapitre IV : « Des caractères distinctifs de la première langue, et des changements qu’elle dut éprouver » : « … la plupart des mots radicaux seraient des sons imitatifs ou de l’accent des passions, ou de l’effet des objets sensibles : l’onomatopée s’y ferait sentir continuellement. » Sur ce thème, voir T. Todorov, Théories du symbole, 1977, chapitre V : « Imitation et motivation », p. 161-178.
18- « Voilà donc les premiers hommes, outre qu’ils poussent des cris inarticulés de joie, de douleur, de colère, occupés à siffler comme la tempête, à mugir comme les vagues de la mer agitée, à faire du fracas avec leur voix comme des pierres roulantes, à hurler comme les loups, à roucouler comme des colombes, à braire comme des ânes » (A. W. Schlegel, « De l’étymologie en général », cité par T. Todorov, Théories du symbole, 1977, p. 271).
19- T. Todorov, Théories du symbole, 1977, p. 236 : « Jusqu’en 1790, le mot de symbole n’a pas du tout le sens qui sera le sien à l’époque romantique : ou bien il est simple synonyme d’une série d’autres termes plus usités (tels : allégorie, hiéroglyphe, chiffre, emblème, etc.) ou bien il désigne de préférence le signe purement arbitraire et abstrait (les symboles mathématiques). »
20- E. Kant, Critique de la faculté de juger, 1965, § 59, p. 174.
21- « Il se joue un jeu à l’extémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile » (Blaise Pascal, Œuvres complètes, 1962, pensée n° 451, p. 1213 ; édition Brunschvicg n° 233).
22- B. Pascal, Œuvres complètes, 1962, pensée n° 285, p. 1161 ; édition Brunschvicg, n° 298.
23- B. Pascal, idem, pensée n° 309, p. 1166 ; Brunschvicg n° 298.
24- Aristote, La Poétique, 1452 a 22.
25- Ainsi le triptyque Braque, par Rogier van der Weyden (vers 1451, musée du Louvre) et le diptyque Jean Carondelet par Jan Gossaert, dit Mabuse (1517, musée du Louvre).
26- Ce trait paraît clairement sur de nombreux tableaux : par exemple, Baldung Grien, Les trois âges de la femme et la Mort, vers 1510 (Vienne, Kunsthistorisches Museum) et Memling, l’Autel portatif de Strasbourg, fin XVe siècle (Strasbourg, musée des beaux-arts). Ce jeu du contraste est d’abord pictural (ce pourquoi le symbole est d’abord une image, et non un texte), mais il peut être aussi être poétique. C’est ainsi, par exemple, que Ronsard se plairait moins à évoquer la chair décomposée de la morte si ce spectre d’outre-tombe ne rendait plus désirable encore le corps amoureux de la vive.
27- Giorgio Vasari, « Vie de Massaccio », dans Les peintres toscans, prés. André Chastel, 1966, p. 123.
28- J.-P. Vernant, « Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d’Œdipe-Roi », dans Mythe et tragédie en Grèce ancienne, 1977, p. 99-131.
29- Sophocle, Oedipe-Roi : deux vers évoquent directement la symétrie tragique du coup et du contrecoup : le vers 417 (« Bientôt, comme un double fouet – amphiplêx – la malédiction d’un père et d’une mère, qui approche terrible, va te chasser d’ici ») et le vers 809 (« Mais le vieux me voit, il épie l’instant où je passe près de lui et de son chariot et il m’assène en pleine tête un coup de son double fouet – diplous »). Traduction Paul Mazon.
30- S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, 1971, chapitre I, p. 5-11.
31- On pourra se référer à l’interprétation de l’interprétation freudienne de « Signorelli » par Lacan, Séminaire XI, chap. II, p. 29 ; et Guy Rossolato, Essais sur le symbolisme, 1979, « Le sens des oublis ; une découverte de Freud », p. 97-111.
32- Le dernier en date, pourtant riche et explorant des domaines plutôt méconnus dans ce genre d'ouvrages, ne contrevient pas à cette règle (composé sous la direction d’Yves Bonnefoy, Paris, Flammarion 1981, deux volumes).
33- Ces remarques sur l’ambivalence du symbolisme médiéval concluent l’article de Panofsky, « Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait », Burlington Magazine, 1934, vol. LXIV, p. 117-127.
34- Pour la perdrix et la licorne, on se reportera aux articles correspondants de L. Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ, Paris, 1940. Quant au miroir, la femme qui s’y mire, sur la fresque de Giotto dans la chapelle de l’Arena, à Padoue, est une allégorie de la Prudence (image, sans doute, du « connais-toi toi-même »). Cependant la femme au miroir représente encore le péché d’orgueil – « Superbia » – parmi les Sept péchés capitaux tels que les a représentés Jérôme Bosch (musée du Prado) ; elle est encore une image de la Vanité – ou de la Luxure – sur l’autel portatif que peint Memling à la fin du XVe siècle (musée de Strasbourg).
35- Emile Mâle, L’Art religieux du XIIIe siècle en France, 1958, tome II, p. 109-114.
36- Voir Michel Pastoureau, « L’Héraldique nouvelle », Pour la Science, novembre 1977, n° 1, p. 50-59.
37- Sur ce terme de l’alternative aliénante, voir Jacques Lacan, Séminaire XI, chapitre XVI, p. 192 et 193.
38- Freud, Métapsychologie, 1969, « Note sur l’inconscient », p. 184 : « Une analogie grossière, mais qui ne serait pas inappropriée, avec cette relation supposée de l’activité consciente à l’activité inconsciente pourrait être trouvée dans la photographie. Le premier temps est le “négatifˮ ; toute photographie doit passer par le “processus négatifˮ, et ceux des négatifs qui ont réussi l’examen sont admis au “processus positifˮ, aboutissant à l’image finale. »
39- G. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, GF, 1966, livre II, chap. I, p. 94 et 97.
40- Leçons sur la philosophie de l’histoire, Hegel, introduction, trad. Gibelin, Vrin, 1967, p. 32.
41- S. Freud, « L’inconscient », Métapsychologie, 1966, p. 73 : « Nous aurons également le droit d’écarter la dénomination de “subconscienceˮ comme incorrecte et trompeuse. »
42- S. Freud, idem, p. 74.
43- S. Freud, idem, p. 98: « Les processus inconscients ne nous sont connaissables que dans les conditions du rêve et des névroses […] En eux-mêmes, ils sont inconnaissables. »
44- C’est ainsi, selon Freud, que l’inconscient articule le désir par un jeu de polarités opposées (Métapsychologie, « Pulsions et destin des pulsions », 1969, p. 35) : « Peut-être comprendra-t-on mieux les multiples contraires “d’aimerˮ si l’on considère que la vie psychique en tant que telle est dominée par trois polarités, trois oppositions : Sujet (moi)-Objet (monde extérieur), Plaisir-Déplaisir, Actif-Passif. »
45- S. Freud, L’interprétation des rêves, 1971, chap. VII, p. 433 et suiv. Voici le texte du rêve tel qu’on le lit chez Freud : « Un père a veillé jour et nuit, pendant longtemps, auprès du lit de son enfant malade. Après la mort de l’enfant, il va se reposer dans une chambre à côté, mais laisse la porte ouverte afin de pouvoir, de sa chambre, regarder celle où le cadavre de son enfant gît dans le cercueil, entouré de grands cierges. Un vieillard a été chargé de la veillée mortuaire, il est assis auprès du cadavre et marmotte des prières. Au bout de quelques heures de sommeil, le père rêve que l’enfant est près de son lit, lui prend le bras, et lui murmure d’un ton plein de reproches : “Ne vois-tu donc pas que je brûle ?“ Il s’éveille, aperçoit une vive lumière provenant de la chambre mortuaire, s’y précipite, trouve le vieillard assoupi, le linceul et un bras du petit cadavre ont été brûlés par un cierge qui est tombé dessus. » On lira sur ce texte le commentaire de Jacques Lacan, Séminaire XI, 1973, chap. V, p. 53 et suiv.
46- Voir C. Cagnac, E. Ramis et J. Commeau, Nouveau cours de mathématiques spéciales, Paris, Masson, 1963, p. 9. La relation binaire se trouve définie selon le schéma : sujet (a ∈A), verbe, image (b ∈ B). Ce qui s’écrit en abrégé : a R b. On dit qu’il y a correspondance entre les variables x (de domaine A) et y (de domaine B).
47- L’associativité s’écrit : (a.b).c = a.(b.c). La commutativité : a.b = b.a, et enfin la distributivité : (b + c).a = b.a + c.a.
48- E. Freud, L’interprétation des rêves, 1971, chap. VII, p. 521-522.
49- Aristote, La Métaphysique, 980 a 21.
50- Freud rend hommage à Breuer qui sut le premier distinguer l’énergie libre de l’énergie liée (« Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, chap. IV, 1965, p. 33). Cette opposition sera toujours maintenue dans l’œuvre de Freud (voir Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, 1971, p. 133-136).
51- Ainsi le chat est chasseur, par une nécessité imaginaire à laquelle il n’échappe pas. A quoi rêvent les chats ? De passionnantes expériences, qui ont permis d’observer le comportement onirique, ont mis en évidence que le chat se rêve en chassant sa proie, la poursuivant mais ne s’en saisissant jamais. C’est ainsi que le rêve accomplit peut-être le désir, mais n’atteint cependant jamais la jouissance. Voir Michel Jouvet, « Le comportement onirique », Pour la Science, n° 25, novembre 1979, p. 136-152.
52- C’est ainsi que Cassirer montre que l’emploi du duel, dans les langues anciennes, exprime une sorte de fixation sur l’alter ego, et que sa disparition témoigne d’une intelligence plus formelle de la série illimitée des nombres : « La régression du duel coïncide avec la transformation progressive et continue du nombre individuel et concret en un nombre élément d’une série […] A mesure que s’impose l’idée d’une mesure numérique considérée comme un tout construit selon un principe rigoureusement unitaire, chaque nombre singulier, au lieu de représenter un contenu particulier, devient progressivement une simple position équivalente aux autres » (La philosophie comme forme symbolique, 1972, tome I, p. 207-208).
53- Par exemple, Victor Hugo :
Mirlababi surlababo
Mirliton ribon ribette
Surlababi mirlababo
Mirliton ribon ribo.
(Comptines de langue française, recueillies et commentées par J. Baucomont, F. Guibat, tante Lucile, R. Pinon et Ph. Soupault, Paris, Seghers, 1971, p. 291).
54- S. Freud, « L’inconscient », Métapsychologie, 1969, p. 100 : « Au système préconscient reviennent encore : l’instauration d’une capacité de communication entre les contenus des représentations, de sorte qu’elles puissent s’influencer réciproquement ; l’ordonnance temporelle des contenus… ».
55- T. Todorov, Théories du symbole, 1977 ; p. 217.
56- F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 1974, p. 98 et 99.
57- La première version de cette image, plusieurs fois recommencée par Magritte, remonte à 1926. On lira le commentaire qu’elle a inspiré à Michel Foucault : « Ceci n’est pas une pipe », Paris, Fata Morgana, 1973. Il est curieux qu'on ne pense que très rarement au sens argotique et sexuel de cette formule. Si l'on y pense, il devient évident, en effet, que l'image de Magritte « n'est pas une pipe »...
58- La comparaison du langage avec la circulation de la monnaie, et plus généralement de l’échange linguistique avec l’échange économique, est une des métaphores les plus insistantes (avec celle du jeu d’échecs) du Cours de linguistique générale de F. de Saussure.
59- « L’homme se comporte comme s’il était le créateur et le maître du langage, alors que c’est celui-ci au contraire qui est et demeure son souverain. Quand ce rapport de souveraineté se renverse, d’étranges machinations viennent à l’esprit de l’homme. Le langage devient un moyen d’expression. En tant qu’expression, le langage peut tomber au niveau d’un simple moyen de pression » (M. Heidegger, « L’homme habite en poète », dans Essais et conférences, 1958, p. 227).
60- S. Freud, « L’inconscient », Métapsychologie, 1969, p. 118.
61- S. Freud, ibid., p. 118-119.
62- Hegel, La Phénoménologie de l’Esprit, trad. Hyppolyte, tome I, p. 84 : « C’est aussi comme un universel que nous prononçons le sensible. Ce que nous disons, c’est ceci, c'est-à-dire le ceci universel, ou encore il est, c'est-à-dire l’être, en général. Nous ne nous représentons pas assurément le ceci universel, mais nous prononçons l’universel. »
63- Hegel, Propédeutique philosophique, 1964, § 159, p. 164.
64- S. Freud, « L’inconscient », dans Métapsychologie, 1969, p. 118.
65- C’est en ce sens qu’il faut interpréter la trop célèbre « finalité sans fin » de l’Analytique du beau : la rencontre de la beauté – libre et non adhérente – fait saillir la forme du fond de cet « abîme » qu’ouvre, dans le système du monde, l’élan infini de notre liberté. Le pont de la Troisième Critique ne relie pas un continent à un autre continent, mais plutôt l’infinité lacunaire de la liberté à la multiple splendeur de la matière phénoménale. Ainsi l’éclat de la beauté surgit de l’infini, finalité sans fin, image radieuse d’une autonomie épanouie dans la plénitude de la maturité. Elle surgit « sur fond d’absence », majesté souveraine que le concept s’épuise à nommer. Sur l’interprétation de la « finalité sans fin », on lira les belles pages de Jacques Derrida, « Parergon » (« III- La façon de faner les tulipes ») dans La vérité en peinture, Paris, 1978.
66- Gaston Bachelard, L’air et les songes, 1943, p. 254-255.
67- Paul Claudel, « Connaissance de l’est », Œuvres poétiques, Pléiade, 1967, p. 79.
68- Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, dans Œuvres complètes, Pléiade, 1961, p. 65.
69- On lira sur ce thème Martin Heidegger, « Ce qu’est et comment se détermine la phusis », dans Questions II, 1968, p. 165-276.
70- On trouvera toutes les références concernant le thème de la mimêsis platonicienne dans P. M. Schuhl, Platon et l’art de son temps, 1952. Pour l’interprétation, on se reportera à la remarquable analyse de Jacques Derrida, « La Pharmacie de Platon », dans La Dissémination, 1972, d’abord paru dans Tel Quel, n° 32 et 33, 1968.
71- Platon (Rép. VII, 514 a) écrit : « anapeptamenên pros to phôs tên eisodon », de petannumi, s’ouvrir en se déployant, qui a donné « pétale » (to petalon) et pétase (o petasos) qui désigne, comme on sait, le chapeau ailé du dieu Hermès. Ainsi à la périphérie du corps sensible – la caverne où résonnent les signes – s’ouvrent les yeux fertiles, comme des fleurs écloses, comme des ailes déployées offertes à la lumière.
72- Platon, Ion, 533 d et suiv.
73- Tel est le point qui oppose irréductiblement, dans Le Banquet, l’Eros comique, dont Aristophane se fait l’interprète, et l’Eros philosophique dont Socrate doit la connaissance à Diotime, prêtresse de Mantinée. Selon la théorie aristophanienne du sumbolon, l’accomplissement du sens comble un vide et restitue une totalité. La comédie s’achève heureusement, par un mariage. Mais selon le philosophe, le désir extasie au contraire le sens et l’ouvre sur l’immensité, « l’océan du beau ». La chasse à la torpille ne s’achève jamais.
74- C’est ainsi que, selon Platon, la dialectique est le charme auquel ont recours les mortels pour dissiper le spectre du Croquemitaine (to mormolukaion : Phédon, 77 e et 78 a). On se reportera au commentaire de ce passage par Jacques Derrida, La Dissémination, 1972, p. 138 et suiv.
75- Platon, Rép. X, 608 a ; « Tant que la poésie sera incapable de se justifier, nous l’écouterons, en nous redisant les raisons que nous venons de donner, pour nous prévenir contre ses enchantements, et nous prendrons garde de retomber dans la passion qui charma notre enfance et charme encore le commun des hommes. »
76- Platon, Rép. III, 393 d.
77- G. Bachelard, L’air et les songes, 1943, p. 7 : « On veut toujours que l’imagination soit la faculté de former les images. Or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. » On remarquera à ce propos combien l’image la mieux « réfléchissante » pour le jugement esthétique est, selon Kant, celle qui offre le spectacle d’une constante déformation, d’une perpétuelle métamorphose : les figures changeantes du feu ou les tourbillons de la rivière (Anthropologie, § 30, et Critique de la faculté de juger, § 22, « Remarque générale »). On trouvera un intéressant commentaire de ce thème dans Olivier Chédin, Sur l’esthétique de Kant…, 1982, chap. II : « L’imagination esthétique dans le jeu des facultés. L’unité esthétique intuitive du divers de l’intuition », p. 49-62.
78- Platon, Rép. III, 381 e. Sur les épreuves imaginées par Platon pour tester la résistance des « âmes d’or » à la tentation de la fascination ou de la terreur, voir Rép. III, 413 d.
79- Hegel, Esthétique, trad. S. Jankélévitch, II, p. 75.
80- R. Descartes, « Méditation IV », dans Œuvres et lettres, Pléiade, 1963, p. 301.
81- Idem, « Méditation III », p. 294.
82- Leibniz, Monadologie, § 84, dans Œuvres, 1972, p. 407.
83- Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 1019, trad. P. Mazon.
84- Eschyle, Ibid., v. 89-90.
85- Dans la Théogonie d’Hésiode, Océan a pour mère Gé, et Prométhée, Clymène. Pour Eschyle, Prométhée et Océan sont frères et tous deux nés de Gé. C’est Océan qui, le premier, a pitié du héros enchaîné : « De tes maux, sache-le, j’ai compassion. Le sang, je crois, m’y contraint, et le sang n’y fût-il pour rien, il n’est personne qui tienne plus de place dans mon cœur » (v. 291-292, trad. P. Mazon).
86-« Thalassa ekhêessa », par exemple Iliade, chant I, v. 157.
87- T. Todorov, Théories du symbole, 1977, p. 112.
88- R. Jakobson, « Deux aspects du langage et deux types d’aphasie », dans Essais de linguistique générale, chap. II, p. 43-67. D’abord publié dans Fundamentals of language, La Haye, 1956.
89- Jacques Lacan, Séminaire III, chap. 17 et 18, p. 243-262. Egalement, J. F. Lyotard, Discours, Figures, 1971, note 1 de la p. 274 et p. 303-304.
90- T. Todorov, Théories du symbole, 1977, note 1 de la p. 274 et p. 303-304.
91- Ainsi, remarque T. Todorov (Théories du symbole, 1977, p. 113) : « A aucun moment la beauté ne s’interroge sur le pourquoi de ces trois relations seulement [à savoir métaphore, synonymie et synecdoque]. Cela n’empêche pas Fontanier d’être convaincu par ce classement et de l’appliquer fidèlement dans le Commentaire raisonné et dans le Manuel chrétien. »
92- Paul Valéry, Le Cimetière marin, v. 7-8 et v. 23.
93- Arthur Rimbaud, « L’éternité », Œuvres complètes, 1972, p. 79. Dans « Une Saison en enfer », Rimbaud corrige – de façon peut-être malheureuse – ce vers : « C’est la mer mêlée / Au soleil » (idem, p. 110).
94- Arthur Rimbaud, « Les Poètes de sept ans », Œuvres complètes, 1972, p. 45.
95- « … et du pur cristal des fontaines sortirent les premiers feux de l’amour » (J. J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, 1996, chap. IX, p. 525).
96- Paul Valéry, Le Cimetière marin, v. 25-27.
97- Baudelaire, « Les Chats », dans Les Fleurs du mal, dans Œuvres complètes, Pléiade, 1961, p. 64.
98- Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, Paris, Flammarion, 1970, trad. H. Parisot, chap. VI, p. 175.
99- André Breton, Point du Jour, 1970, p. 25. On relira aussi les pages de La Recherche… que Proust consacre à la puissance poétique de la métaphore, à propos des tableaux d’Elstir (I, 835) et de l’art en général, et plus particulièrement des travaux d’écriture (III, 889).
100- F. Nietzsche, La Généalogie de la morale, « Deuxième dissertation », § 8 ; Œuvres complètes, tome VII, 1971, p. 263.
101- R. Descartes, Traité des passions, art. 53 ; Œuvres et Lettres, Pléiade, 1963, p. 723.
102- M. Proust, A la recherche…, tome I, p. 47.
103- Treize années après la parution du Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci de Freud, Eric Maclagan (« Leonardo in the Consulting Room », Burlington Magazine, XCII, 1923, p. 54-57) fut le premier qui repéra la traduction erronée de nibbio en vautour. Mais c’est Meyer Schapiro qui, dans une conférence prononcée en 1955, puis dans un article qui en développait les idées (« Léonard et Freud : une étude d’histoire de l’art », dans Style, artiste et société, 1982, p. 93-138) mit en évidence toute la fragilité des spéculations freudiennes. Cet article n’a été traduit en français que récemment, soixante-douze ans après la publication du livre de Freud. Il n’a cependant pas ébranlé l’admirable confiance que les psychanalystes accordent à leurs propres interprétations. A ce propos, le livre de K. R. Eissler, (Léonard de Vinci, étude psychanalytique, 1961, trad. française, 1980) me semble une merveilleuse illustration du critère de falsifiabilité formulé par Karl Popper : quelque soient leurs erreurs, la psychanalyse et son père fondateur ont toujours raison. Freud discerne dans le prétendu vautour une image de la bonne mère. Schapiro rappelle une fable qui attribue au milan le rôle de la mauvaise mère. Peu importe : « Le principe de base de la psychanalyse, écrit Eissler, est la loi de surdétermination selon laquelle tous les phénomènes psychiques sont multifonctionnels et déterminés par une série ou une pluralité de forces » (p. 312 de la trad. française). Ainsi, bonne ou mauvaise, la mère est toujours la même et Freud ne se trompe jamais. Cette loi de surdétermination est décidément bien commode : après tout, vautour, milan, quelle importance ? L’oiseau n’est-il pas toujours un symbole maternel ? « Pour autant que l’interprétation de Freud ne concerne pas spécifiquement ce type d’oiseau, on peut s’attendre à ce qu’elle soit correcte » (id. p. 26). Pourtant, dans le zèle qu’il dépense pour défendre son maître, Eissler est dépassé par E. Neumann, qui écrit cette affirmation proprement stupéfiante : « L’oiseau du fantasme d’enfance de Léonard, considéré dans son unité créative uroborique du sein-mère et du phallus-mère, est symboliquement un vautour, même si Léonard l’appelle un nibbio » (« Leonardo da Vinci in the Mother Archetype », dans Art and the creative Unconscious, Bollingen Series XLI, New York, Pantheon Book, 1959 ; cité par K. R. Eissler, p. 35). Il est vrai qu’Eissler lui-même reconnaît qu’un « tel raisonnement est inconciliable avec le type de méthode scientifique qui s’est avéré efficace » (p. 36).
104- S. Freud, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, 1977, p. 57 et suiv.
105- S. Freud, L’interprétation des rêves, 1971, chap. VII, p. 495 et suiv.
106- « Nous en dirons autant du timon placé derrière le mouvement du navire, à l’instar de la queue des oiseaux » (Léonard de Vinci, Les Carnets, 1942, tome I, p. 383).
107- Meyer Schapiro (« Léonard et Freud : une étude d’histoire de l’art ») cite plusieurs exemples de cette figure traditionnelle. Ainsi l’image des abeilles faisant leur miel sur les lèvres de Platon nouveau-né se trouve chez Cicéron, De Divinatione, I, XXXVI, 78 (Art, Style, Société, 1982, p. 104).
Pour lire la suite (théorie des échanges), cliquer ICI
|
|