|
ARISTOTE
AUGUSTIN
BALZAC
BAUDELAIRE
CHATEAUBRIAND
DANTE
DELEUZE
DESCARTES
DIDEROT
DOSTOÏEVSKI
DUBOS
HANSLICK
HEGEL
HEIDEGGER
HOMERE
KANT
KIERKEGAARD
LACAN
Ecouter la folie
1- Le Symbolique
2- L'Imaginaire
3- Le Réel
4- La Vérité
5- Le Maître
6- Le Désir
MICHEL-ANGE
MONTAIGNE
NIETZSCHE
PASCAL
PLATON
PLOTIN
PROUST
ROUSSEAU
SCHLOEZER
SCHOPENHAUER
SPINOZA
VALERY
WINCKELMANN
|
LACAN
ECOUTER LA FOLIE
4- La Vérité
En un temps – celui du boom économique de l’après-guerre, trompeusement nommé les « Trente Glorieuses » (1) – où triomphaient insolemment les dites « sciences humaines » (sociologie, psychologie, linguistique, anthropologie, démographie, histoire…etc.), il était de bon ton de remiser au magasin des antiquités l’idée de vérité, vieille idole dont nul n’éprouvait plus le besoin. L’absolu que cette idée implique était en contradiction frontale avec le relativisme régnant, qui ne reconnaissait que des normes, conditionnées par les circonstances, le moment, le milieu, mais n’admettait en aucun cas qu’on puisse se référer à l’inconditionné de la vérité. L’air du temps se plaisait, Foucault et Deleuze parmi d’autres, en se réclamant d’une lecture souvent approximative de Nietzsche, à discréditer la « volonté de vérité ». L’enseignement de Lacan, qui eut lieu précisément pendant cette période, était sur ce point, comme sur tant d’autres, parfaitement intempestif, et le succès qu’il rencontra peut sembler à ce propos paradoxal, à moins de poser en principe qu’une pensée est d’autant mieux reçue qu’elle prend davantage son époque à rebrousse-poil. Lacan n’a jamais renié l’idée de vérité, il s’est efforcé au contraire de lui donner une valeur constructive au sein de la relation analytique, une valeur sans laquelle le projet d’une « éthique de la psychanalyse » (Séminaire VII, 1959-60) n’aurait jamais pu être formulé. Et même lorsque Lacan reconnaît la communauté d’esprit qui le lie aux travaux de Lévi-Strauss – autorité suprême des sciences humaines alors triomphantes – il répugne cependant à partager le relativisme total qui conduit son ami, dans Les Structures élémentaires de la parenté, à fonder l’interdiction de l’inceste sur la seule logique des échanges. Selon Lacan, l’analyse purement formelle de l’anthropologue échoue à démontrer pour quelles raisons ce sont les femmes, et non les hommes, qui font seules les frais de l’échange (les systèmes de parenté fonctionneraient tout aussi bien si les femmes échangeaient les hommes, plutôt que les hommes les femmes), et surtout pour quelle raison l’interdit porte toujours sur le lien incestueux du père avec la fille, jamais sur celui du fils avec la mère (2). Le formalisme structural, qui s’en tient à la combinatoire des relations possibles, échoue à rendre compte d’un réel que le désir oriente, mettant en jeu cet objet énigmatique et fondamental, à la frontière de l’imaginaire et du symbolique : le phallus, que Lacan définit souvent comme « le signifiant du signifiant manquant », soit de cet effet de sens qui marque un point d’ancrage dans le jeu toujours réversible des réciprocités combinatoires (3). On ne s’étonnera donc pas si l’impératif de la vérité se porte à l’encontre d’un structuralisme alors dominant, qui ne veut connaître que la syntaxe des relations et s’enivre d’un jeu conceptuel déconnecté du réel, indifférent à la chronologie, à l’opacité des faits comme à l’insistance des désirs. L’enthousiasme pour la cybernétique et les premiers ordinateurs jouait en faveur de ce formalisme hyperbolique. Lacan résiste. Dans le jeu incessant des échanges, il y a quelque chose qui se maintient, quelque chose qui demeure, une inconnue qui ne se laisse pas résoudre dans le langage toujours réversible des équations. Et Lacan, en un temps où il était pourtant de bon ton de ne plus invoquer cette vieille lune, n’hésite pas à lui donner son nom : vérité. Ce geste singulier n’était peut-être pas pour rien dans le succès que rencontraient alors les Séminaires. En cet âge d’or de la société dite de consommation, il restait des esprits, non pas rassasiés, mais assoiffés, qui se refusaient à faire leur deuil de la vérité, et trouvaient dans l’enseignement de Lacan une substantielle nourriture.
On ne peut dire, pour autant, que Lacan demeurait étranger au structuralisme. Lui qui se réclamait du Cours de linguistique générale de Saussure, et précisément des Structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss – ce qui ne l’empêchait pas d’en pointer le défaut – se sentait solidaire de ce courant intellectuel. Lacan n’enfermait-il pas l’homme dans la sphère du langage, ne le confinait-il pas derrière ce qu’il nommait « le mur du langage » (4), s’interdisant ainsi de trouver un point d’appui au-delà, ou en-deçà, du système des signifiants, se privant d’une prise ferme et constante susceptible d’assurer la valeur du vrai ? (5) Il faut ici rappeler que les mots, à l’inverse d’une croyance naïve, mais commune, ne désignent nullement les choses, mais des concepts qui changent avec les modes et passent avec le temps. En outre, selon une formule souvent répétée par Lacan, le signifiant n’est signifiant que pour un autre signifiant, selon un jeu de relations, ou d’implications réciproques, qui se poursuit indéfiniment, sans qu’on parvienne jamais à se saisir d’un sens qui serait à lui-même sa propre raison. Toute langue est composée d’un nombre fini de mots (un peu plus de 30.000 dans le français usuel, 90.000 dans les dictionnaires les plus complets, auxquels il faut ajouter les mots des vocabulaires spécialisés), et le sens de chaque mot étant fonction lui-même d’un certain nombre de mots – ceux qui composent sa « définition » – il est fatal, si l’on se met en tête de définir les mots de la définition, puis les mots de la définition des mots de la définition, et ainsi de suite, qu’on finisse toujours, et assez rapidement, par retomber sur ses pieds. Il faut s’y résigner : s’il faut en croire les dictionnaires, la liberté sera toujours absence de contrainte, et la contrainte privation de liberté. L’ordre symbolique est incapable par lui-même de se saisir du sens, il faudrait pour cela un saut qui franchisse le « mur du langage » et échappe à la ritournelle de la parole vide, pour se mettre en présence de l’être même qui donne le sens, brisant le cercle infernal des mots qui ne font que le déléguer sans jamais s’en emparer. On objectera peut-être qu’un système formel est pourtant capable d’établir des vérités, et même les plus simples, comme deux et deux font quatre, qui résume assez bien ce qu’on croit encore quand on ne croit plus en rien. C’est ainsi que Maurice de Nassau, pressé par son confesseur de faire acte de foi avant que la mort ne l’emporte, lui confia : « Monsieur mon ami, j’ai bien du déplaisir de ne vous pouvoir donner le contentement que vous désirez de moi. Mais vous voyez que je ne suis pas en état de faire de longs discours, ni de vous rendre compte de ma créance par le menu. Je vous dirai seulement en peu de mots que je crois que deux et deux font quatre et quatre et quatre font huit. Monsieur Tel (montrant du doigt un mathématicien qui était là présent) vous pourra éclaircir sur les autres points de notre créance » (6) ; le Dom Juan de Molière s’en souvient quand il répond à son serviteur, qui s’inquiète de sa croyance : « Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et quatre et quatre sont huit » (III, 1). Toutefois, cette prétendue vérité est dépourvue de tout contenu réel, puisque si l’on transpose cette relation dans un système de numération binaire, 2 + 2 = 4 s’écrit : 10 + 10 = 100. Qui ne voit qu’on ne fait que jouer ici avec des signes de pure convention, que seule la relation demeure, quand la vérité prétend à l’absolu et non au relatif ? Nous dirons plutôt que de telles relations sont exactes, c'est-à-dire qu’elles sont conformes aux règles qui définissent la syntaxe de telle ou telle structure ; mais elles ne peuvent nullement prétendre être vraies. La vérité n’est pas l’exactitude. Il faut pourtant que les mots aient un sens, sinon le langage tournerait à vide, et serait proprement dément, à la façon de la « langue fondamentale » qui hante l’esprit du président Schreber, proférant sans interruption des phrases toujours inachevées et dont le sens demeure en suspens : « Ce problème se pose, énonce Lacan, à partir de la question de savoir de quelle façon la parole a rapport avec la signification, comment le signe se rapporte à ce qu’il signifie. En effet, à saisir la fonction du signe, on est toujours renvoyé du signe au signe. Pourquoi ? Parce que le système des signes, tels qu’ils sont institués concrètement, hic et nunc, forme par lui-même un tout. C'est-à-dire qu’il institue un ordre qui est sans issue. Bien entendu, il faut qu’il y en ait une, sans quoi ce serait un ordre insensé » (7). Le désir d’échapper à cette parole vide, qui est désir d’une parole pleine (8), se laisse entendre dans les questions des enfants : interrogeant sur le pourquoi, et sur le pourquoi du pourquoi, et ainsi de suite sans trouver le terme, l’enfant, porté par le désir de vérité, presse l’adulte de lui rendre le sens présent, de se placer en dehors du jeu des signifiants plutôt que de relayer sans fin les références : « L’enfant, remarque Lacan, dès lors qu’il sait s’affairer et se débrouiller avec le signifiant, s’introduit à cette dimension qui lui fait poser à ses parents les questions les plus importunes, dont chacun sait qu’elles provoquent le plus grand désarroi et, à la vérité, des réponses presque nécessairement impotentes : Qu’est-ce que courir ? Qu’est-ce que c’est, taper du pied ? Qu’est-ce que c’est, un imbécile ? […] De quoi s’agit-il, dans ce moment de la question ? – sinon du recul du sujet par rapport à l’usage du signifiant lui-même, et de son incapacité à saisir ce que veut dire qu’il y ait des mots, que l’on parle, et que l’on désigne telle chose si proche par ce quelque chose d’énigmatique qui s’appelle un mot, ou un phonème » (9).
Pourtant, le monde symbolique, dans l’enceinte duquel tout ce qui est humain demeure confiné, n’est pas un univers hermétique, totalement insensible aux pressions venues de l’extérieur. Des fissures lézardent la forteresse, des dépressions ouvrent des brèches dans le mur du langage. Certes, la vérité se dérobe dans l’ordre symbolique, mais elle montre néanmoins le bout de son nez dans les blancs du discours, dans le suspens de la parole. C’est un paradoxe sur lequel Lacan revient souvent : c’est toujours par l’erreur (10), par la confusion ou par la défaillance que la vérité vient à nous. Rêves, lapsus, équivoques, glissements de sens (métaphore et métonymie), dénégations, silences… Le refoulé disjoint la construction de la phrase, et la vérité parle non par ce que nous disons, mais par ce que nous ne voulons, ou pouvons pas dire. Et c’est parce qu’elle est toujours l’intruse qu’on n’attendait pas qu’il est si difficile de la faire taire. Ecoutons la voix de la vérité : « Pour que vous me trouviez où je suis, je vais vous apprendre à quel signe me reconnaître. Hommes, écoutez, je vous en donne le secret. Moi, la vérité, je parle […] Que vous me fuyiez dans la tromperie ou pensiez me rattraper dans l’erreur, je vous rejoins dans la méprise contre laquelle vous êtes sans refuge. Là où la parole la plus caute (11) montre un léger trébuchement, c’est à sa perfidie qu’elle manque, je le publie maintenant et ce sera dès lors un peu plus coton de faire comme si de rien n’était, dans la société bonne ou mauvaise. Mais nul besoin de vous fatiguer à mieux vous surveiller. Quand même les juridictions conjointes de la politesse et de la politique décrèteraient non recevable tout ce qui se réclamerait de moi à se présenter de façon si illicite, vous n’en seriez pas quittes pour si peu, car l’intention la plus innocente se déconcerte à ne pouvoir plus taire que ses actes manqués sont les plus réussis, et que son échec récompense son vœu le plus secret » (12). Extraordinaire prosopopée de la vérité qui fait irruption au beau milieu d’une conférence prononcée à Vienne en novembre 1955, et dont le texte publié est le remaniement. Lacan donne la parole à la Vérité, qui parle à sa façon, non selon les lois de la syntaxe consciente, du discours articulé, mais par métaphore, métonymie, inversion, puisqu’aussi bien nous savons que l’inconscient est structuré « comme un langage », non qu’il soit lui-même un langage, mais parce qu’en son sein se tissent des correspondances qui se font échos, et aimantent la prétendue « libre » association d’idées. Cette déclaration fracassante vient se loger dans un paragraphe intitulé « La chose parle d’elle-même », et dans un texte lui-même intitulé, « La chose Freudienne ». La vérité ne parle pas avec des mots – ou alors de sont des mots-valises, des mots tordus, des mots forgés, des mots d’esprit, des jeux de mots – elle parle avec des choses : « Le commerce au long cours de la vérité ne passe plus par la pensée : chose étrange, il semble que ce soit désormais par les choses, rebus », ajoute Lacan en faisant allusion à un célèbre passage de L’Interprétation des rêves de Freud, qui compare le rêve au rébus (13). Parler avec des choses, avec « la Chose » (das Ding), ce n’est pas référer le sens au sens en une série indéfinie de relais, mais montrer à l’inverse le sens en personne, lui laisser faire son apparition sur le théâtre de la représentation mentale. Là où la parole manque, la chose se montre, et là où la chose se montre, le sujet n’a plus de mots pour la dire. La vérité fait signe, là où on l’attendait le moins, non dans le fil de la démonstration, mais dans les lacunes du discours : « Je vagabonde, continue la Vérité en personne, dans ce que vous tenez pour être le moins vrai par essence : dans le rêve, dans le défi au sens de la pointe la plus gongorique et le nonsense du calembour le plus grotesque, dans le hasard, et non pas dans sa loi, mais dans la contingence, et je ne procède jamais plus sûrement à changer la face du monde qu’à lui donner le profil du nez de Cléopâtre » (14).
Si la vérité « se montre », puisqu’il lui arrive de montrer le bout de son nez, c’est parce qu’elle se dissimule, ou se voile le plus souvent : ce qui est toujours là ne peut faire son apparition, et il faut la retraite des coulisses pour réussir son entrée en scène. Tantôt la vérité se laisse deviner, tantôt elle se dérobe. Et c’est pourquoi Lacan compare sa recherche, et par analogie les jeux de cache-cache de l’analyse ou de l’enseignement, à un « judo avec la vérité » (15), soit l’art de faire trébucher le partenaire non pas en s’opposant frontalement à lui, mais en l’accompagnant au contraire dans les défaillances de son propre discours. La vérité ne saurait être fonction du seul formalisme de la démonstration – qui n’est que la vérification de la cohérence du discours, qui peut fort bien être démentiel par ailleurs : le délire du paranoïaque est infalsifiable, seule la vérité peut être réfutée. La vérité ne procède pas de la démonstration, elle naît de l’événement. La vérité ne calcule pas, elle s’impose. Elle n’est pas une « valeur », elle est un fait. Il faut toujours un acte de rupture pour provoquer son apparition. Nécessairement extérieure au système de l’échange symbolique, au fil de la conversation, à l’enchaînement des propositions, c’est par les fractures du discours qu’elle surgit par surprise. Aussi dit-on de la vérité qu’elle « sort du puits », ou « de la bouche des enfants », qu’elle « se fait jour », qu’elle « jaillit », qu’elle « surgit », qu’elle « éclate » ou qu’elle « explose ». Son inconditionnalité est un effet de l’acte de sa naissance, sa valeur est absolue, puisque venue de nulle part, elle semble naître d’elle-même, à l’inverse des raisons toujours enchaînées selon l’ordre du discours, toujours relatives l’une à l’autre. La démonstration obéit au principe de non-contradiction, elle n’est valide qu’à la condition de ne pas se contredire. La vérité est à rebours l’acte même de la contradiction, elle ne se manifeste qu’en réfutant ce qui la précède, par un coup d’éclat qui est aussi un retournement de situation. Aussi Lacan répète-t-il souvent que c’est de l’erreur que procède la vérité, comme s’il fallait cet effet de contraste pour légitimer son autorité. Si l’ordre symbolique était le seul maître, il n’y aurait que le ronron de la ritournelle, la parole vide, le discours qui tourne en rond. Pour que la vérité apparaisse, il faut donc que le Réel vienne faire dérailler la rengaine. La vérité est ainsi toujours dérangeante, elle est nécessairement insolente, ce qui signifie exactement qu’elle fait perdre l’habitude : « A une vérité nouvelle, écrit Lacan, on ne peut se contenter de faire sa place, car c’est de prendre notre place en elle qu’il s’agit [ce qui nous impose de changer de place…] Elle exige qu’on se dérange. On ne saurait parvenir à s’y habituer seulement. On s’habitue au réel [qui n’est ici que l’ordre établi]. La vérité, on la refoule » (16). Ce à quoi nous ne sommes pas habitués nous paraît toujours nouveau, et c’est aussi ce que Lacan aime à rappeler en citant Max Jacob : « Le vrai est toujours neuf » (17).
Que la vérité soit de l’ordre de l’événement et non du discours nous permet de mieux comprendre l’intérêt que Lacan porte à la tragédie. Nous savons en quels termes Lacan interprétait le conflit d’Antigone et de Créon sur le modèle de l’antagonisme du Réel et du Symbolique. Il consacre au commentaire de la tragédie de Sophocle trois séances successives de son Séminaire en mai et juin 1960, et les trois dernières leçons de l’année qui leur font suite ont pu être regroupées par Jacques-Alain Miller sous le titre : « La dimension tragique de l’expérience psychanalytique ». D’autres exemples témoignent de la centralité du thème tragique dans la théorie lacanienne de l’analyse : dans le séminaire du 6 juin 1956, Lacan développe une analyse serrée de la tragédie de Racine, Athalie, pour l’imminence de la mort dont la menace perce à tout moment la solennité du vers et lui donne sa tension propre ; sept séminaires, de mars à juin 1959, développent une lecture approfondie d’Hamlet, qui exerce sur Lacan une véritable fascination, drame de la mélancolie, de la mort du père et de la déchéance de la mère, Hamlet qui nous montre selon lui l’unique dimension qui demeure possible pour la tragédie après la rédemption chrétienne (18) ; et au mois de mai 1961, Lacan consacre encore quatre séances à la trilogie des Coûfontaine, si déroutante, au magnétisme si insolite qu’on ne sait si cette fresque des convulsions de la révolution française est un morceau d’histoire ou la projection d’un songe : L’Otage, Le Pain dur et Le Père humilié. Et d’autres encore, telle la lancinante référence à la lamentation du vagabond aveugle de l’Œdipe à Colone, selon laquelle il vaudrait mieux ne jamais naître en ce monde (19). On devine que dans la salle, certains s’impatientent parfois, les psychanalystes sans doute, d’un séminaire qu’ils attendaient surtout clinique et qui dérive vers les Lettres. Cet accent mis sur le tragique ne s’écarte pourtant nullement de l’expérience analytique, dans la mesure où cette expérience est aux yeux de Lacan une épreuve de vérité, semblable en plus d’un point à la mécanique du drame tragique : « L’éthique de l’analyse n’est pas une spéculation sur l’ordonnance, l’arrangement de ce que j’appelle le service des biens [Lacan entend par là le système des valeurs d’échange]. Elle implique à proprement parler la dimension qui s’exprime dans ce qu’on appelle l’expérience tragique de la vie. C’est dans la dimension tragique que s’inscrivent les actions, et que nous sommes sollicités de nous repérer quant aux valeurs » (20). On sait que, selon Aristote, la tragédie compose un « système des actes » (sustasis tôn pragmatôn) rigoureusement enchaîné (21), et qui se joue en trois temps : le nœud qui se serre depuis longtemps (desis), le coup de théâtre (peripeteia) qui renverse le sens de l’action et le dénouement (lusis) qui voit naître un monde nouveau sur les ruines de l’ancien monde (22), trois moments qu’il est possible de lier aux trois passions tragiques, la terreur pendant le nouement, la pitié quand tombe le coup de la justice divine avec le coup de théâtre, et enfin la purification qui apaise les craintes d’un autre temps et nous apprend à nous réjouir de celui qui vient (23). Ce schéma tragique nous permet de comprendre que toute tragédie consiste en la mise en scène d’un retournement de situation, qui renverse l’ordre du monde et inverse le signe dont les dieux affectent les mortels, faisant passer les uns du malheur à la félicité, et les autres de la fortune à l’infortune. La tragédie met en scène le retour du refoulé (il y a toujours, dans la tragédie, un cadavre dans le placard), dans la mesure où elle nous fait assister à l’émergence de l’Evénement en ce qu’il a de plus essentiel, à la croisée des mondes et des destins, quand éclate enfin la vérité dont nous savons précisément que son essence est d’être événement et non simple discours. S’il n’est pas vrai, mais seulement exact, que deux et deux font quatre, il est en revanche bel et bien vrai qu’Œdipe a tué son père et épousé sa mère. Et c’est ainsi qu’en recourant à la ruse de la libre association, l’analyse débusque la vérité. Tandis que se brise en mille morceaux le miroir du fantasme, l’analysant découvre l’énigme de la vie, dans sa nudité, dans son indifférence et dans son inhumanité, au sein de laquelle tous les choix, s’il en est encore temps, sont encore possibles, selon que l’on prend le parti de renaître à la vie, ou de renoncer à vivre. A chacun sa vérité. Ce dénouement tragique de l’analyse peut sans doute nous aider à comprendre l’étrange et profonde remarque de Lacan : « Quant à la dernière séance, elle ne se passe pas sans, chez l’un et l’autre des partenaires, la plus forte envie de pleurer. C’est ce que Balint écrit, et cela a la valeur d’un témoignage extrêmement précieux de ce qui est la pointe de toute une tendance de l’analyse » (24). Selon Michael Balint, ces larmes expriment la douleur de la rupture d’une relation devenue quasi amoureuse, celle qu’ont nouée, au cours de l’analyse, l’analysant avec l’analyste. Lacan l’entend certes en un tout autre sens, les larmes exprimant plutôt selon lui la découverte du non-sens de la vie, la leçon amère d’Œdipe à Colone : qu’il aurait mieux valu ne jamais naître et qu’il vaut mieux, une fois né, mourir au plus tôt. Lacan n’est pourtant pas sans savoir que la fin de la tragédie est plus complexe, ambivalente, à la fois désolante par l’effondrement de ce que l’on croyait être, et enivrante par l’espérance de ce qu’il est encore permis de devenir.
Pour sortir du cercle du langage, de la ronde des signifiants, l’analyste, s’il faut en croire une image frappante proposée par Lacan, doit réussir à « franchir le mur du langage » comme on franchit le mur du son (25). On sait que le bolide, quand il approche de la vitesse du son, accumule devant lui un bouclier d’ondes qui résiste à son accélération ; il lui faut alors un supplément d’énergie pour vaincre cette résistance et provoquer l’onde de choc qui le libère. Au moment du bang supersonique, la vitesse du bolide, délivrée, peut donner toute sa puissance. Le changement de vitesse provoque alors le sentiment d’une anticipation, une soudaine accélération du temps, comme une scansion temporelle, ou, selon une expression que Lacan affectionne, une « pulsation temporelle » (26). Il faut une rupture de rythme, une discontinuité dans la continuité du temps pour que, profitant de cette fracture, la vérité puisse faire irruption. Il faut la bêtise d’un lapsus (le petit Hans dit de sa phobie du cheval qu’elle est sa « bêtise ») pour que la vérité fasse son entrée en scène, un faux pas, à l’image de celui que fait le Narrateur sur les pavés mal ajustés de la cour des Guermantes, accident infime, cause légère dont l’effet est considérable puisqu’elle suscite la réminiscence d’un voyage à Venise avec la mère, et fait du temps perdu un temps retrouvé. Le discours commun est plat comme un trottoir de rue mais la vérité dépend d’une infime claudication qui suffit à dévoyer le mouvement loin des sentiers battus. Que l’effet de vérité ait un lien intime avec le temps ne doit pas nous étonner, nous qui savons que la vérité est événement, donc inscription dans la trame temporelle, et non discours, soit un système formel régi par sa seule logique, sans considération d’espace ni de temps. Et cet événement de la vérité ne peut être vécu que sur le mode de l’anticipation, car la rupture, en tranchant soudain le nœud gordien du passé, ouvre brusquement le présent à un avenir jusqu’alors ignoré. Le renversement de la peripeteia (coup de théâtre) dont parle Aristote prend alors la valeur d’une inversion temporelle, un hiatus qui retourne le temps et fait que l’après précède l’avant (27). C’est ainsi que lorsque l’analyste, se saisissant au passage d’un lapsus ou d’un acte manqué, donne à l’analysant le mot qui délivre le sens latent et lance la chasse de la vérité, l’analysant éprouve un saisissement qui résulte de l’emprise soudaine que le passé refoulé exerce sur le présent, découvrant un avenir possible que l'écran du fantasme masquait jusque là. Remarquons à ce propos l’étrangeté de ce mot, le « saisissement », qui exprime le fait d’être saisi par un Autre qui soudain exerce son emprise, et non l’acte de saisir, comme il est ordinaire, sur le modèle par exemple de « prolongement », qui signifie l’acte de prolonger et non la passion d’être prolongé. Ce saisissement, ou « pulsation temporelle », marque dans l’analyse l’équivalent de la bascule tragique, qui inverse le sens de l’action et retourne l’actif en passif et le passif en actif : le passé passe enfin et l’avenir devient présent dans le présent libéré du passé. C’est ainsi qu’Œdipe, fils de Polybe et de Mérope, roi et reine de Corinthe, apprend par l’oracle de Delphes qu’il tuera son père et épousera sa mère. Son destin bascule en cet instant, et c’est pour le fuir qu’il prend la route de Thèbes, se jette dans la gueule du loup et connaît la vérité qui sera son lot. Dans ce renversement, le sujet reste interdit, « interloqué » pourrions-nous dire, non pas au sens ou il est médusé par l’hallucination de l’objet du fantasme, mais en cet autre sens où, placé entre le discours du passé et celui de l’avenir, inter locutiones, il marque la syncope, le contretemps qui annonce la venue de la vérité. C’est en ce sens que Lacan souligne combien la manifestation de la vérité n’est aucunement le résultat d’une simple construction logique, mais l’expérience d’une « pulsation temporelle », d’une « rétroaction » qui provoque soudain une accélération de la durée, un sentiment d’urgence que l’imminence de la vérité motive. C’est ainsi que tout discours est comme suspendu à la profération de son dernier mot. La chasse de la vérité commence nécessairement après coup, nachträglich, puisqu’il faut d’abord l’avoir rencontrée pour se lancer à sa poursuite, tant il est vrai qu’on ne cherche jamais que ce qu’on a déjà trouvé (28).
Que la vérité soit événement et non pure démonstration, qu’elle s’inscrive nécessairement dans la trame temporelle, Lacan avait à cœur de le montrer à propos d’une petite énigme qu’on disait de pure logique et qui rencontrait un certain succès dans la bonne société de l’après-guerre (un peu comme le jeu des allumettes dans L’Année dernière à Marienbad de Resnais). Lacan a même rédigé sur ce thème un article pour les Cahiers d’Art de Christian Zervos, « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée » (mars 1945) (29), dans lequel il fait jouer l’opposition du logique et de l’anticipation, cette « pulsation temporelle » qui marque le temps de l’instant critique, le « bang » qui crève le mur du langage. Soit trois condamnés auxquels on accorde une chance d’échapper à la mort : on leur présente cinq disques, deux noirs et trois blancs, et l’on épingle dans leur dos et à leur insu trois disques blancs, laissant de côté les disques noirs, et chacun ne pouvant voir que les disques que portent les deux autres sans connaître le sien propre. Celui qui le premier saura nommer la couleur de son disque sera sauvé. Ego voit donc deux disques blancs, et raisonne ainsi : si je portais un noir, chacun de mes deux compagnons verrait un disque noir et un disque blanc. L’un ou l’autre pourrait alors, en supposant à son tour qu’il porte un disque noir, en déduire que le troisième prisonnier portant le blanc verrait deux disques noirs, et pourrait ainsi immédiatement en déduire qu’il est blanc (puisqu’il n’y a que deux disques noirs). S’il ne dit rien, c’est donc qu’il voit deux disques blancs. Or, ils se taisent. C’est donc qu’Ego est blanc et non noir. Telle est la solution qu’on proposait dans les salons. Elle ne prend pourtant pas en compte un fait, remarque Lacan : c’est que les trois prisonniers étant dans la même situation (chacun des trois voit deux blancs), chacun doit accorder aux deux autres le délai nécessaire pour achever le raisonnement qu’on vient d’énoncer. Si Ego s’empresse de donner la réponse, il peut se tromper du fait que l’un de ses compagnons a l’esprit particulièrement lent, et qu’il ne lui a pas laissé le temps de la réflexion ; si inversement il laisse trop passer le temps, il donne occasion à l’autre de ses concurrents de le précéder dans sa décision, et donc de perdre la partie. Il y a donc un risque dans la gestion du temps du fait que la certitude du choix doit anticiper sur le choix des deux autres (ce que Lacan nomme « l’assertion de certitude anticipée »). Le problème n’est donc pas simplement logique, il est politique, ou du moins tactique, en ce sens qu’il dépend de la bonne estimation du moment décisif. Ce qui intéresse Lacan, dans cette petite fable, c’est bien entendu non la fable elle-même, mais son analogie avec la stratégie de l’analyse : quand l’analyste doit-il pointer le mot qui fait hiatus, l’acte qu’on ne dit manqué que parce qu’il réussit à être vrai, le lapsus qui convoque la vérité refoulée ? La vérité n’est effective qu’à la condition de saisir l’instant propice, le kairos qui l’actualise. Et plus important que de dire la vérité, ou de se lancer dans des interprétations que la suite de l’analyse révélera hasardeuses, est l’art de connaître le moment de dire, en ce point de « pulsation temporelle », de syncope ou de contretemps, où la bascule tragique fera tout son effet.
Ce saisissement du sujet par l’instant critique qui lui révèle qu’il est un autre que celui qu’il croyait être, qui lui découvre brusquement la possibilité d’une autre identité – fils de Polybe et de Mérope ou de Laïos et de Jocaste ? – Lacan l’illustre d’une métaphore, celle du « point de capiton ». Dans un étrange schéma de son Cours de linguistique générale (30), Saussure représentait le signifiant et le signifié – qui sont les deux éléments qui se combinent dans l’unité problématique du signe linguistique – comme deux masses indéterminées et juxtaposées, qui évoquaient dans la partie supérieure un ciel nuageux et dans l’inférieure une mer ondoyante. Le signe relie ces deux domaines plutôt confus, puisqu’ils n’ont d’autre raison que celle de l’usage, par un lien que Saussure juge arbitraire et purement conventionnel. Pourtant, l’analyse montre bien qu’il est des mots qui touchent, qui blessent ou qui sauvent, et la scène dramatique, et plus particulièrement tragique, sait l’effet du dernier mot d’un personnage acculé à l’aveu, ou résolu à laisser éclater la vérité. Le « dernier mot » ne désigne pas le moment où le locuteur passe la parole à l’interlocuteur, mais au contraire le moment où il n’est plus temps de parler, mais d’agir. Pour dire ce signal nécessaire qui précipite l’action, Lacan ne se satisfait pas de l’arbitraire auquel s’en tient Saussure, et tient à marquer dans le signe l’inscription de la Nécessité. Il imagine donc, se référant à l’art du matelassier, que les deux masses cotonneuses assez étrangement figurées par Saussure, soit le signifiant et le signifié, sont raccordées l’une à l’autre en certains points qui font nœuds, à la façon des points de capiton qui rapprochent les deux côtés d’un matelas par deux boutons fermement attachés l’un à l’autre. Il ne s’agit plus d’un vague arbitraire, mais d’un lien solide qui ne peut être rompu sans que soit compromise la forme de l’ensemble (31). Sans la piqûre du mot juste, la langue n’est qu’une bourre informe. N’est-ce pas ainsi que se distingue, de la parole vide, la parole pleine ? Si la langue manque de ces nœuds qui lui donnent forme et structure, alors tous les mots se valent, et rien ne veut vraiment dire. Pour qu’une langue se tienne, il faut des mots forts, des points de vérité qui maintiennent la cohésion de l’ensemble. Sans le point crucial, nodal qui capitonne l’étoffe du sujet, le dessin de l’identité resterait flottant et indécis, et le caractère chancelant. Seule l’éthique, non le logique, est en mesure de fonder la valeur de vérité. Et le mouvement de l’aiguille du matelassier, qui traverse la masse pour la percer à rebours, nouant étroitement ce qui n’était que lâchement associé, métaphorise la rétroaction, la « suspension temporelle » qui marque le retournement tragique : par cet aller-retour de l’épingle qui fixe ce qui n’était que mouvant, le point de capiton met le sujet à l’épreuve du saisissement, au carrefour des chemins, entre Corinthe et Thèbes, entre le fallacieux et le véritable, et le somme de choisir. C’est ainsi qu’on dit d’un clandestin, ou d’un suspect, qu’il s’est fait « épingler », et « mettre aux arrêts », par les forces de l’ordre. Sur ce schéma en U renversé – le geste du matelassier monte en perçant le matelas, puis le perce à nouveau en revenant vers le bas – Lacan, dont l’ingéniosité créatrice est à peu près illimitée, va élaborer un diagramme fort complexe, auquel il ne cessera d’ajouter des variations ou des compléments, qu’il compare plaisamment – par analogie de forme – à un ouvre-bouteille (32), et qu’il nomme plus sérieusement le « graphe du désir ». Vingt fois sur le métier il remet son ouvrage, le polit et le repolit, malgré la lassitude, ou l’incompréhension, d’un auditoire dont on croit entendre la rumeur à la lecture des Séminaires. Sans entrer dans le détail quelquefois obscur de ce hiéroglyphe, il n’est pourtant pas difficile d’en comprendre le dessin général.
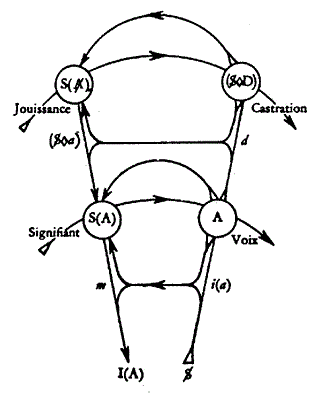
Schéma de « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien »,
dans Lacan, Ecrits II, Seuil, 1999, p. 297
Le mouvement d’aller-retour de la pulsion qui dessine en creux la forme de l’objet du désir (33), raconte l’histoire du petit d’homme, nul par l’effet de sa prématuration, qui ne peut se forger une identité qu’en s’aliénant à la parole de l’Autre. C’est en effet tout l’intérêt de l’apologue des trois prisonniers de montrer comment la connaissance de la vérité de l’un d’entre eux passe nécessairement par la connaissance de la connaissance de chacun des deux autres. Sans cette aliénation, c'est-à-dire sans associer sa décision à la décision de ses compagnons, il n’y a pas de salut possible, et ce n’est pas par hasard si l’énigme met en jeu et la mort et la vie. Tout commence donc avec le saisissement de l’enfant par la sonorité de la voix de l’Autre – mise en présence du grand Autre, « A », posé en absolu, et sans relation avec un autre terme (ce pourquoi il est sur le schéma entouré d'un cercle) ; au point suivant du mouvement ascendant du capitonnage linguistique, le sujet comprend non seulement que l’Autre parle – c'est-à-dire qu’il ne profère pas des bruits insignifiants, mais semble faire signe on ne sait où – mais encore qu’il s’adresse à lui, l’enfant (ce qui désigne précisément le sujet privé de la parole). Le voici mis en demeure de répondre, lui qui ne comprend pourtant pas ce qu’on veut de lui, ou plutôt auquel de ses désirs on lance un appel : non pas « que me veut-il ? », mais, en inversant la question dans l’écho de sa réponse : « que veut-il que je veuille à mon tour ? ». Lacan aime à rapprocher ce moment crucial de l’entrée du petit d’homme dans le Symbolique d’un épisode d’un roman faussement léger ou libertin : Le Diable amoureux de Jacques Cazotte (1772). Un jeune homme en garnison à Naples, désireux de sensations nouvelles, se laisse conduire, par curiosité, à une fantasmagorie diabolique où l’on convoque par magie Belzébuth en personne. Le Diable se montre à lui sous la forme d’une tête de chameau horrible, aux oreilles démesurées, et qui n’ouvre la gueule que pour proférer ces mots : Che vuoi ? Que veux-tu ? Il prendra par la suite une forme plus agréable, sous l’aspect enjôleur de Biondetta, une courtisane experte qui lui promettra de coupables délices et, au moment de passer à l’acte, reprendra son aspect répugnant de chameau monstrueux pour articuler à nouveau, d’une voix de tonnerre, le sépulcral « Che vuoi ? ». Le sujet se trouve ainsi traversé par le point de capiton du désir de l’Autre, qui fait écho à son désir, et le terrifie par cette intime aliénation, non par remords, mais parce qu’il se sait maintenant créature de cet Autre qui détient désormais le secret de sa jouissance comme de son être tout entier. Ainsi s’érige la statue de Commandeur du grand Autre qui m’élève, par l’intensité de sa demande, à la conscience du désir qui est en moi. Ce qui s’écrit en langage lacanien « $◇D » (entouré d'un cercle), soit le sujet évanouissant (le moment de l’aphanisis), anéanti et comme pétrifié par la voix de tonnerre qui interroge son désir, mis en présence de la demande indéchiffrable que tourne vers lui la Voix. L’enfant ne comprend pas encore ce que l’Autre profère, mais il comprend que c’est à lui que ce discours s’adresse, et que c’est son désir qu’on interroge. Nous avons oublié l’effroi de cette scène primitive, mais il suffit d’imaginer l’effet considérable que produirait l’une des sondes que nous envoyons aux confins de notre monde, si elle émettait un jour un message en guise de réponse : Che vuoi ? A ce mouvement ascendant de la progression du désir, répond alors le mouvement descendant du point de capiton qui s’éloigne maintenant de l’idolâtrie muette et pénètre progressivement dans le système des échanges : l’enfant reconnaît bientôt, par les gestes d’affection, par la voix que l’habitude apprivoise et dont l’accent n’est pas sans douceur, que Belzébuth est moins terrible qu’on ne croit, qu’il ne reste pas inaccessible à la séduction. Le premier moment de ce second temps est, dit Lacan, celui de la jouissance, dont la formule en son algèbre, est : « S(Ⱥ) » (entouré d'un cercle) : le sujet s’affirme en prenant plaisir à gazouiller avec l’autre, ou le Grand Autre destitué de la majesté absolue qui fut d’abord la sienne, ce qui s’écrit en algèbre lacanien, « grand A barré ». La jouissance procède donc de la « castration », le moment précédent, celui du sujet pétrifié, anéanti par la violence de la demande originaire, qui est désir de désir (« je désire que tu me livres le secret de ton désir »). Puis, dans un rythme à deux temps, la tension médusante de la demande s’efface pour laisser la place à la jouissance d’être reconnu par la voix aimante qui se penche sur le berceau. Dès lors peut commencer l’introduction dans le langage, ce que symbolise le quatrième et dernier point de capiton sur le graphe du désir, qui s’écrit « S(A) » (entouré d'un cercle), soit le signifiant orienté vers la demande venue de l’Autre, qui suppose désormais l’intelligence de la demande adressée. Elle n’était connue à l’étape précédente que comme demande de reconnaissance, simple jeu d’écho de la musique des voix – elle est maintenant entendue comme demande articulée, au contenu déterminé, qui impose au sujet l’apprentissage des codes et la complexité sans limite de la grammaire des échanges. Ainsi paraît la vérité sur le théâtre du monde, vérité qu’il faut concevoir comme un événement, non encore comme un discours, la précipitation chimique de l’identité du sujet placé dans le champ magnétique du désir de l’Autre. Si l’on suit la courbe fléchée du point de capiton – ce n’est pas une simple ligne, mais un vecteur qui a commencement et fin, le fil d’une histoire – on remarque encore qu’il part du néant, soit le sujet comme n’existant pas encore, non encore éveillé au sentiment de son existence ($), et qu’il se termine en I(A), soit l’image du sujet réfléchie dans le miroir du grand Autre, ou l’Idéal du moi, modèle d’identification par lequel l’enfant apprend le rôle qu’il est appelé à jouer sur la scène de la comédie humaine. On constate donc que le Symbolique ne détruit nullement l’Imaginaire, mais lui est au contraire associé, la symétrie spéculaire réglant le jeu des échanges en raison d’un leurre qui est constitutif de la nature même de l’homme, animal doué de parole. La relation imaginaire du Sujet à son semblable structure et fonde l’articulation des désirs et des reconnaissances : c’est ainsi que l’articulation signifiante qui fait réponse à la voix de l’Autre, terrifiante en son premier surgissement, prend appui sur la relation m ↔ i(a) (barre horizontale inférieure), soit la relation spéculaire qui lie le moi à son image dans le miroir ; l’autre relation, au-delà ou en-deçà du langage, dans l’ambivalence du désir, entre castration et jouissance, s’appuie à son tour sur une symétrie en miroir entre le Sujet barré par le signifiant (puisqu’il se définit maintenant en écho à la demande amoureuse de l’autre), en rapport à son image spéculaire réfléchie dans ce miroir vivant qu’est la demande de l’autre, et ceci par la seule résonance de la reconnaissance des désirs, sans qu’aucun contenu déterminé soit pour autant articulé. Ce qui s’écrit : $◇a, qui est la formule du fantasme, le sujet s’évanouissant amoureusement devant son double spéculaire, mis en relation avec la demande (d), non du grand Autre terrifiant, mais de cet autre moi-même qui me sourit et fait écho à ma voix : $◇a ↔ (d) (barre horizontale supérieure). Ainsi c’est bien la relation imaginaire qui rend possible l’échange symbolique, et je ne pourrais m’entretenir avec l’Autre (A) si je ne reconnaissais aussi en lui mon semblable (a).
Par la couture du point de capiton, par la pointe de la flèche du signifiant qui perce de part en part la chair du sujet et fait de l’enfant un homme de parole, par cet avènement de l’humain à la violence de l’aliénation comme à la reconnaissance des désirs, la vérité n’est plus un vain mot et trouve sa fondation dans l’échange. Certes, il se peut que l’Autre soit trompeur, ou qu’il se trompe, car, comme aime à le répéter Lacan : de même qu’il n’y a pas de métalangage, c'est-à-dire un point de vue en surplomb extérieur au langage et qui nous donnerait l’occasion de poser le langage comme un objet de notre étude (mais avec quels mots pourrions-nous alors le désigner ?), de même il n’y a pas d’Autre de l’Autre, ce qui signifie que la parole de l’Autre ne saurait être garantie par une autorité supérieure. C’est seulement sur la fondation que nous offre la parole de l’Autre qu’il nous est possible à notre tour d’entrer dans l’univers du signifiant. Ce n’est qu’en me risquant à croire que l’Autre n’est pas trompeur que je peux m’aventurer à prendre à mon tour la parole. Rien d’humain ne serait possible sans ce pacte de confiance, sans qu’il soit fait foi en la parole donnée : « C’est pour autant que l’Autre est un sujet comme tel que le sujet s’instaure, et qu’il ne peut s’instituer lui-même comme sujet dans un nouveau rapport à l’Autre, à savoir qu’il a, dans cet Autre, à se faire reconnaître comme sujet – non plus comme demande, non plus comme amour, mais comme sujet […] Quelle garantie toute espèce de fonctionnement de l’Autre dans le réel, comme répondant à la demande, peut-il trouver ? Le comportement, quel qu’il soit, de l’Autre, qu’est-ce qui peut attester de sa vérité ? Qu’est-ce qui est au fond concret de la notion de vérité comme de celle d’intersubjectivité ? Qu’est-ce qui donne son sens plein au terme de truth en anglais, qui exprime simplement la Vérité avec un grand V ? Tout est suspendu à ce que nous appelons en français, dans une décomposition du langage qui se trouve être le fait d’un système langagier, la foi en la parole. En d’autres termes, en quoi peut-on compter sur l’Autre ? C’est de cela qu’il s’agit quand je vous dis qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre » (34). Cette prise de conscience entraîne la déchéance de l’Autre et oriente la quête d’un Maître dont nous ne pourrions plus mettre en doute la véracité. Le problème est ici semblable à celui de Descartes, quand il émet l’hypothèse d’un Malin Génie qui emploierait toute son industrie à me tromper. Si Dieu même est trompeur, où est le chemin du salut ? Le cogito – qui n’a certes rien à voir avec l’aliénation désirante dont Lacan fait le socle de l’entrée dans le monde du langage – m’assure de mon existence ponctuelle, mais dès que je m’aventure au-delà de cet îlot d’évidence, je me perds aussitôt dans la nuit universelle et rien ne peut me convaincre que je ne tombe pas à nouveau sous l’empire du Grand Trompeur. L’hypothèse du Malin Génie n’est autre que le postulat du délire paranoïaque, que je suis la proie d’un complot universel, et qu’il n’y a pas moyen de m’arracher à cette suspicion puisque, si un homme de bonne volonté entreprenait par aventure de m’en dissuader, je le compterais aussitôt parmi les membres du complot : s’il cherche ainsi à me mettre en confiance, c’est qu’il compte par cette ruse faire plus aisément de moi sa victime. Les victimes d’une agression ont un temps de convalescence pendant lequel toute proximité est menace de mort : le passant qui me frôle ne va-t-il pas soudain sortir un poignard, celui qui entre avec moi dans l’ascenseur ne va-t-il pas m’étrangler entre deux étages, celui qui prétend m’instruire ne vise-t-il pas à m’égarer ? Nous comprenons par là que toute vie sociale suppose à son fondement un pacte tacite de confiance mutuelle, une garantie mutuelle de non-agression.
D’où nous vient cette crédulité ? De ce que le rapport à l’Autre, dans le temps de l’introduction de l’enfant dans l’univers du langage, s’est résolu dans la symétrie d’une double reconnaissance, posant ainsi dès l’origine un principe de sécurité qui demeure actif au fondement de tout échange. Et si par malheur cette « pierre d'angle » (35) n’a pas été posée, laissant le sujet sans défense devant le poison de la suspicion, alors il appartient à l’analyse de recommencer le nouement du point de capiton, de rejouer la terreur du sujet épinglé par la voix terrible de l’Autre, de réapprendre à parler en quelque sorte, ce qui signifie recommencer pour notre propre compte le saisissement de la reconnaissance des désirs et la jouissance de la concordance des discours. Cette reconstruction d’un édifice mal construit et chancelant passe par une expérience qui n’est que de langage, puisque tout ici est affaire de mots, de demandes comprises et de réponses assumées. On reconnaîtra sans peine l’expérience analytique. Ce qui nous permet de mieux comprendre quelle relation s’établit, selon Lacan, entre l’analyste et l’analysant. Il ne s’agit nullement de forcer l’interprétation, comme le faisait Freud avec l’innocence du prosélyte, et qui ne devait qu’à son flair exceptionnel de ne pas aggraver le cas qu’on lui soumettait (36), bien que l’interprétation, même fausse, comme Lacan aime à le remarquer, peut avoir des suites bénéfiques (37). Toutefois, ce funambulisme herméneutique n’est plus de mode de nos jours, et c’est heureux. L’analyste, selon Lacan, doit savoir se faire discret : à l’affût du mot qui fait mouche, invisible aux yeux de l’analysant, il se contente de mettre le doigt sur le point de capiton qui fixe le désir, sur ces noyaux de sens qui font se converger les plis du fantasme, provoquant ainsi la libération de la parole, et abandonnant aux soins de l’analysant l’art d’échafauder un nouvel édifice de mots où il fera meilleur vivre. La vérité n’est pas dans l’interprétation, elle réside dans le discernement des points sensibles qui donnent lieu à une parole pleine, qui met en jeu l’identité du sujet et lui permet de se reconstruire. La vérité est cet événement, elle n’est pas dans le contenu du message mais dans le trauma originel où le message prend sa source. Elle gît dans la pulsation temporelle qui fait trembler le Temps lui-même et renverse les situations les mieux acquises. Lacan aime à dire qu’à la partie de bridge analytique où le patient mise sur sa vie même, et la valeur qu’il veut bien lui accorder, l’analyste prend la place du mort (38) : il ne dit rien, ou presque rien, et ne prend la parole que comme le font dans les contes les revenants, pour rappeler aux vivants leur quatre vérités, et les épreuves préhistoriques qui les ont fait ce qu’ils sont. L’analyste ne dit rien, mais il aide, en appuyant sur les points nodaux qui déclenchent le travail de l’interprétation, son partenaire à voir clair dans son jeu, étalé sur la table, et lui abandonnant la gloire de la victoire. Admirable abnégation, distance idéale mais qui n’est guère tenable, car le contre-transfert met à nouveau l’analyste en jeu, quand il avait choisi de se mettre hors-jeu. Le voici donc contraint de sortir de sa réserve, l’autre monde où les morts gardent le silence, et de s’impliquer dans le jeu. Autre façon de démontrer qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre, qu’il n’y a pas de position en surplomb qui puisse se dégager du jeu du langage, et que l’analyste est engagé, qu’il le veuille ou non, dans la recherche de la vérité. Qu’il le soit le moins possible, qu’il se déprenne de la fièvre qui enferme les joueurs dans le cercle du jeu, c’est pour autant souhaitable, et l’analyse didactique travaille en ce sens. Mais l’analyste ne sera jamais tout à fait le maître, et il importe que l’analysant ne lui accorde jamais la confiance que l’idolâtre met en son Dieu.
NOTES
1- Seules les décennies des années 50 et 60 furent exceptionnellement prospères. Les années 70 marquèrent une chute importante de l'évolution du PIB, qui ne cessa de se confirmer et de s’accentuer jusqu’à aujourd’hui. On s'est empressé d'oublier que les tickets de rationnement, qui limitaient la consommation, future idole, furent en vigueur jusqu'en décembre 1949, et que les événements de mai-juin 1968, qui ont galvanisé les délires d'interprétation, n'ont été en vérité que l'avant-courrier de ce qu'on s'obstine aujourd'hui encore, plus d'un demi-siècle plus tard, à nommer « la Crise », alors qu'il s'agit de bien autre chose : la dictature du Capital, de plus en plus sensible quand, après l'ivresse de la croissance, vint le temps du dégrisement. De janvier 1950 à mai 1968, cela fait, si je ne me trompe, dix-huit ans et demi, bien loin de trente ! Encore faut-il ajouter que ces pas même dix-neuf années furent tout moins que « Glorieuses », minées par le refoulement de la Collaboration, par l'exploitation féroce de la main-d’œuvre immigrée, par la vaine résistance aux mouvements de décolonisation comme par la crispation d'un ordre moral devenu étouffant. Pour soulever cette chape de plomb, on ne concédait à une minorité privilégiée – les « gagnants » de ce nouveau monde – qu'un simulacre de liberté : la fête débridée de la consommation, dont l'exubérance de façade dissimulait la rigueur du monde du travail, la résignation à ses normes, à son conformisme, à ses renoncements.
2- « … la question que j’ai posée à M. Lévi-Strauss, l’auteur des Structures élémentaires de la parenté. Que lui ai-je dit ? Vous nous faites la dialectique de l’échange des femmes à travers les lignées. Par une sorte de postulat, de foi, vous postulez que l’on échange les femmes entre générations […] Et si vous faisiez le cercle des échanges en renversant les choses, et en disant que ce sont les lignées féminines qui produisent les hommes et se les échangent ? » A la formule de Lévi-Strauss, celle de l’homme : « Je reçois une femme, je dois un enfant », Lacan oppose alors une formule symétrique et inverse, celle de la femme : « Je donne un garçon, je dois recevoir un homme », fondement selon lui d’un matriarcat ni plus ni moins possible que ne l’est le patriarcat. La réponse de Lévi-Strauss est décevante, et se contente d’affirmer que c’est ainsi parce que c’est ainsi : « Dans tous les cas, même dans les sociétés matriarcales, le pouvoir politique est androcentrique » (Séminaire IV, La Relation d’objet, 1956-57, Seuil, 1994, p. 191). C’est de façon semblable que Lacan articule sa critique à propos de l’interdiction de l’inceste : « Claude Lévi-Strauss confirme sans doute dans son étude magistrale le caractère primordial de la loi comme telle, à savoir l’introduction du signifiant et de sa combinatoire dans la nature humaine par l’intermédiaire des lois du mariage réglé par une organisation des échanges qu’il qualifie de structures élémentaires […] Mais même quand il fait cela, et tourne longuement autour de la question de l’inceste pour nous expliquer ce qui rend son interdiction nécessaire, il ne va pas plus loin qu’à nous indiquer pourquoi le père n’épouse pas la fille – il faut que les filles soient échangées. Mais pourquoi le fils ne couche-t-il pas avec sa mère ? Là, quelque chose reste voilé » (Séminaire VII, L’Ethique de la psychanalyse, 1959-60, Seuil, 1986, p. 82).
3- « Le vrai secret, la vérité de tout ce qu’il [Lévi-Strauss] fait tourner dans la structure autour de l’échange des femmes, c’est que, sous l’échange des femmes, les phallus vont les remplir. Il ne faut pas qu’on voie que c’est le phallus qui est en cause. Si on le voit, angoisse » (Séminaire, L’Angoisse, 1962-63, Seuil, 2004, p. 105-106).
4- « Nous [les analystes] voici donc au pied du mur, du mur du langage. Nous y sommes à notre place, c'est-à-dire du même côté que le patient, et c’est sur ce mur, qui est le même pour lui et pour nous, que nous allons tenter de répondre à l’écho de sa parole. Au-delà de ce mur, il n’y a rien qui ne soit pour nous ténèbres extérieures. Est-ce à dire que nous soyons entièrement maîtres de la situation ? Certainement pas, et Freud là-dessus nous a légué son testament sur la réaction thérapeutique négative » (« Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », 1953, Ecrits I, Seuil, 1999, p. 314).
5- « Ce à quoi la découverte de Freud nous ramène, c’est à l’énormité de cet ordre où nous sommes entrés, à quoi nous sommes, si l’on peut dire, nés une seconde fois, en sortant de l’état justement nommé infans, sans parole : soit l’ordre symbolique constitué par le langage, et le moment du discours universel concret et de tous les sillons par lui ouverts à cette heure, où il nous a fallu nous loger » (La psychanalyse et son enseignement, 1957, dans Ecrits I, Seuil, 1999, p. 442) ; ce pourquoi notre discours ne s’adresse jamais à l’Autre, mais seulement à son ombre projetée, à son écho réfléchi sur le mur du langage : « Nous croyons qu’il y a d’autres sujets que nous, qu’il y a des rapports authentiquement intersubjectifs. Nous n’aurions aucune raison de le penser si nous n’avions pas le témoignage de ce qui caractérise l’intersubjectivité, à savoir que le sujet peut nous mentir. Je ne dis pas que c’est le seul fondement de la réalité de l’autre sujet, c’est sa preuve. En d’autres termes, nous nous adressons de fait à des A1, A2, qui sont ce que nous ne connaissons pas, de véritables Autres, de vrais sujets. Ils sont de l’autre côté du mur du langage, là où en principe je ne les atteins jamais. Fondamentalement, ce sont eux que je vise chaque fois que je prononce une vraie parole, mais j’atteins toujours a′, a″, par réflexion. Je vise toujours les vrais sujets, et il me faut me contenter des ombres. Le sujet est séparé des Autres, les vrais, par le mur du langage » (Séminaire II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-55, Seuil, 1978, p. 285-286).
6- Guez de Balzac, Socrate chrétien, Paris, A. Courbé, 1652, p. 124
7- Séminaire I, Les Ecrits techniques de Freud, 1953-54, Seuil, 1975, p. 288.
8- L’expression « parole pleine », fréquente dans le premier séminaire (1953-54), se rencontre dans les séminaires suivants, mais en se raréfiant progressivement, jusqu’au Séminaire VI (Le désir et son interprétation, 1958-59). Elle disparaît par la suite. On la rencontre également dans une communication de 1953, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse (dans Ecrits I, Seuil, 1999, p. 235-321), dont la première partie s’intitule : « Parole vide et parole pleine dans la réalisation psychanalytique du sujet » (p. 245). On trouve par ailleurs une mention fugitive, mais bien significative, dans le Séminaire XVI, D’un autre à l’autre, 1968-69, Seuil, 2006, p. 19 : « …cette parole pleine dont j’ai parlé dans un temps d’évangélisation… ».
9-Séminaire VIII, Le Transfert, 1960-61, Seuil, 2001, p. 286.
10- « Il est clair que l’erreur n’est définissable qu’en termes de vérité. Mais il ne s’agit pas de dire qu’il n’y aurait pas d’erreur s’il n’y avait pas de vérité, comme il n’y aurait pas de blanc s’il n’y avait pas de noir. Les choses vont plus loin – il n’y a pas d’erreur qui ne se pose et ne s’enseigne comme vérité. Pour tout dire, l’erreur est l’incarnation habituelle de la vérité. Et si nous voulons être tout à fait rigoureux, nous dirons que, tant que la vérité ne sera pas entièrement révélée, c'est-à-dire selon toute probabilité jusqu’à la fin des siècles, il sera de sa nature de se propager sous forme d’erreur » (Séminaire I, Les Ecrits techniques de Freud, 1953-54, Seuil, 1975, p. 289. Pour la question qui nous intéresse ici, la séance du 30 juin 1954, intitulée « La vérité surgit de la méprise » (p. 287-299) est centrale.
11- « Caute » est un vieil adjectif, déjà périmé au XVIIe siècle, qui signifie à la fois « avisé », « précautionneux » et « rusé ». S'il vient ici à l'esprit de Lacan, c'est sans doute parce qu'il a l'avantage de résonner sourdement avec « faute ». Mais Caute est surtout, et bien davantage, la devise latine de Spinoza : « avec prudence », de cautus, participe de caveo, « prendre garde », « veiller à »...
12- La chose freudienne ou Sens du retour à Freud en psychanalyse (1965), Ecrits I, Seuil, 1999, p. 406-407.
13- « Le contenu du rêve nous est donné sous forme d’hiéroglyphes, dont les signes doivent être successivement traduits dans la langue des pensées du rêve […] Supposons que je regarde un rébus […] Je ne jugerai exactement le rébus que lorsque […] je m’efforcerai de remplacer chaque image par une syllabe ou par un mot qui, pour une raison quelconque, peut être représenté par cette image. Ainsi réunis, les mots ne seront plus dépourvus de sens, mais pourront former quelque belle et profonde parole. Le rêve est un rébus, nos prédécesseurs ont commis la faute de vouloir l’interpréter en tant que dessin » (Freud, L’Interprétation des rêves, PUF, 1971, chapitre VI, p. 242).
14- La chose freudienne ou Sens du retour à Freud en psychanalyse (1965), Ecrits I, Seuil, 1999, p. 406. Dans l’analyse, un détail physique fait souvent mouche pour l’interprète. Aussi le nez de Cléopâtre n’est-il pas un nez, mais un signe, comme le confirme Lacan quelques lignes plus loin : « Le nez de Cléopâtre, s’il a changé le cours du monde, c’est d’être entré dans son discours, car pour le changer long ou court, il a suffi, mais il fallait, qu’il fût un nez parlant » (p. 408).
15- « Je me permettrai d’avancer devant vous un mythe [il s’agit du mythe dit « de la lamelle »] […] Cet usage suppose, bien sûr, que nous nous donnions la permission d’utiliser, dans le judo avec la vérité, cet appareil que, devant mon auditoire antérieur, j’ai toujours évité d’utiliser » (Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964, Seuil, 1973, p. 179).
16- L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud (1957), dans Ecrits I, Seuil, 1999, p. 519.
17- « Comme l’a écrit un de ceux-là, princes du verbe, et sous les doigts de qui semblent glisser lui-même les fils du masque de l’Ego, j’ai nommé Max Jacob, poète, saint et romancier, oui, comme il l’a écrit dans son Cornet à dés, si je ne m’abuse : le vrai est toujours neuf » (Propos sur la causalité psychique, 1946, dans Ecrits I, Seuil, 1999, p. 192).
18- « … pour Hegel, la tragédie chrétienne, quand il la situe dans La Phénoménologie de l’Esprit, est liée à la réconciliation, à la Versöhnung, à la rédemption qui, à ses yeux résout l’impasse fondamentale de la tragédie grecque […] … aussi bien après elle renaît cette voix humaine, celle de Kierkegaard, qui lui apporte à nouveau une contradiction. Et aussi bien le témoignage de l’Hamlet de Shakespeare auquel nous nous sommes longtemps arrêté il y a deux ans est là pour nous montrer autre chose, qu’une dimension subsiste, et ne nous permet pas de dire que l’ère chrétienne clôt la dimension de la tragédie » (10 mai 1961, Séminaire VIII, Le Transfert, 1960-61, Seuil, 2001, p. 334).
19- Lacan se réfère souvent à ce texte, et presque toujours aux vers 1225-29 (« Le mieux est de n’être pas né, et s’il nous faut voir le jour, le moindre mal est de mourir au plus vite »), tout particulièrement dans les Séminaires II (1954-55) et VII (1959-60).
20- Séminaire VII, L’Ethique de la psychanalyse, 1959-60, Seuil, 1986, p. 361.
21- Dans La Poétique, Aristote définit par deux fois la trame du muthos tragique comme une liaison systématique, un système des actes qui s’enchaînent : ê sustasis tôn pragmatôn (1450 a 5 et 1450 b 23).
22- Aristote, Poétique, 1455 b 24-29 : « Toute tragédie se compose d’un nouement et d’un dénouement (desis kai lusis) ; le nouement comprend les événements extérieurs à l’histoire et souvent une partie des événements intérieurs. J’appelle nouement ce qui va du début jusqu’à la partie qui précède immédiatement le renversement (metabasis) qui conduit du bonheur au malheur, et dénouement ce qui va du début de ce renversement jusqu’à la fin » (trad. Dupont-Roc et Lallot). La définition du « coup de théâtre » (peripeteia) se trouve en 1452 a 22-23 : « Le coup de théâtre est le renversement qui inverse l’effet des actions » ;
23- Pitié (eleos), Terreur, ou Crainte (phobos) et Purification (katharsis) sont les trois maîtres-mots de la très célèbre définition qu’Aristote, en sa Poétique, donne de la tragédie (1449 b 24-28).
24- Séminaire, Les Ecrits techniques de Freud, 1953-54, Seuil, 1975, p. 206.
25- « … il faudrait, si l’on me permet la métaphore, en agir avec le langage comme on a fait avec le son : aller à sa vitesse pour en franchir le mur. Aussi bien en parlant du bang-bang de l’interprétation vraie, userait-on d’une image assez convenable à la rapidité dont il lui faut devancer la défense du sujet, à la nuit où elle doit le plonger pour qu’il en fasse ressurgir à tâtons les portants de la réalité, sans l’éclairage du décor. L’effet en est rare à obtenir, mais à son défaut vous pouvez vous servir de ce mur même du langage que je ne tiens pas, lui, pour une métaphore, puisque c’est un corollaire de mon propos qu’il tient sa place dans le réel » (« Discours de Rome » 1953, dans Jacques Lacan, Autres Ecrits, Seuil, 2001, p. 161).
26- « Pulsation temporelle » : on trouve cette notion dans Position de l’inconscient, un texte rédigé en mars 1964 d’après une communication faite en novembre 1960 : « Le sujet donc, on ne lui parle pas. Ça parle en lui, et c’est là qu’il s’appréhende, et ce d’autant plus forcément qu’avant que, du seul fait que ça s’adresse à lui, il disparaisse comme sujet sous le signifiant qu’il devient, il n’était absolument rien. Mais ce rien se soutient de son avènement, maintenant produit par l’appel fait dans l’Autre au deuxième signifiant. Effet de langage en ce qu’il naît de cette refente originelle, le sujet traduit une synchronie signifiante en cette primordiale pulsation temporelle qui est le fading constituant de son identification. C’est le premier mouvement » (Ecrits II, Seuil, 1999, p. 309-330). On rencontre ailleurs la même expression, par exemple dans le Séminaire XI, au printemps 1964, aux séances des 15 et 22 avril, et 27 mai 1964. Elle est absente des autres Séminaires.
27- Aristote, Poétique, 52 a 22 : « La péripétie est le renversement (metabolê) qui inverse (eis to enantion) l’effet des actions (tôn prattomenôn) ».
28- « … l’anticipation de la suite signifiante, toute chaîne signifiante ouvrant devant elle l’horizon de son propre achèvement, et, en même temps, sa rétroaction, une fois qu’est venu le terme signifiant qui, si l’on peut dire, boucle la phrase, et qui fait que ce qui se produit au niveau du signifié a toujours une fonction rétroactive. Ici le S2 [deuxième signifiant] se dessine déjà par anticipation au moment où le S1 [premier signifiant] s’amorce et ne s’achève qu’au moment où le S2 rétroagit sur le S1. Un certain décalage existe toujours du signifiant à la signification, et c’est ce qui fait de toute signification […] un facteur essentiellement métonymique, qui se rapporte à ce qui lie en soi la chaîne signifiante et la constitue comme telle » (Séminaire V, Les Formations de l’inconscient, 1957-58, Seuil, 1998, p. 479). Ou bien encore : « …le sésame de l’inconscient est d’avoir effet de parole, d’être structure de langage, mais exige de l’analyste qu’il revienne sur le mode de sa fermeture […] C’est la fermeture de l’inconscient qui donne la clef de son espace, et nommément de l’impropriété qu’il y a à en faire un dedans. Elle démontre aussi le noyau d’un temps réversif, bien nécessaire à introduire en toute efficace du discours ; assez sensible déjà dans la rétroaction, sur laquelle nous insistons depuis longtemps, de l’effet de sens dans la phrase, lequel exige pour se boucler son dernier mot. Le nachträglich (rappelons que nous avons été le premier à l’extraire du texte de Freud), le nachträglich ou après-coup selon lequel le trauma s’implique dans le symptôme, montre une structure temporelle d’un ordre plus élevé » (« Position de l’inconscient », 1960, dans Ecrits II, Seuil, 1999, p. 318-319). Cette notion de rétroaction du signifiant se trouve au fondement de la construction de ce qu’on nomme le « graphe du désir » : voir Séminaire VI, Le désir et son interprétation, 1958-59, La Martinière, 2013, p. 21-30.
29- « Le Temps logique et l’assertion de certitude anticipée. Un nouveau sophisme », dans Ecrits I, Seuil, 1999, p. 195-211.
30- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1974, p. 156.
31- C’est au cours du Séminaire III, Les Psychoses, 1955-56 (Seuil, 1981, p. 303-304) que Lacan introduit la notion de « point de capiton ». Il le fait à l’occasion d’un commentaire de la scène d’ouverture de l’Athalie de Racine : le grand prêtre Joad joue avec Abner, chef des armées, comme le chat avec la souris, lui faisant pressentir la menace d’un châtiment divin. L’épinglant d’un mot qui va convertir Abner à se joindre à la troupe des rebelles, Joad lui déclare « Je crains Dieu, cher Abner… » pour mieux lui faire comprendre combien il aurait tout intérêt, de son côté, à le craindre également : « Qu’il s’agisse d’un texte sacré, d’un roman, d’un drame, d’un monologue ou de n’importe quelle conversation, vous me permettez de vous représenter la fonction du signifiant par un artifice spatialisant, dont nous n’avons aucune raison de nous priver. Ce point autour de quoi doit s’exercer toute analyse concrète du discours, je l’appellerai un point de capiton. Lorsque l’aiguille du matelassier, qui est entrée au moment Dieu fidèle dans toutes ses menaces, ressort, c’est cuit, le gars dit – Je vais me joindre à la troupe fidèle. Si nous analysions cette scène comme une partition musicale, nous verrions que c’est là le point où viennent se nouer le signifié et le signifiant, entre la masse toujours flottante des significations qui circulent réellement entre ces deux personnages, et le texte. C’est à ce texte admirable, et non à la signification, qu’Athalie doit de n’être pas une pièce de boulevard. Le point de capiton est le mot crainte, avec toutes ses connotations trans-significatives. Autour de ce signifiant, tout s’irradie et tout s’organise, à la façon de ces petites lignes de force formées à la surface d’une trame par le point de capiton. C’est le point de convergence qui permet de situer rétroactivement et prospectivement tout ce qui se passe dans le discours. » Pour la mise en relation du « point de capiton » avec le « graphe du désir », voir surtout Séminaire V, Les formations de l’inconscient, 1957-58, Seuil, 1998, p. 14-19.
32- « De quel flacon est-ce là l’ouvre-bouteille ? De quelle réponse le signifiant, clef universelle ? » (« Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », 1960, dans Ecrits II, Seuil, 1999, p. 296).
33- Dans le Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964 (Seuil, 1973, p. 163-164), Lacan représente le mouvement de la pulsion par une flèche montante et descendante, mouvement dont le but n’est pas de s’emparer de l’objet a du désir mais seulement d’en contourner la forme indépendamment de son contenu, finalité sans fin que Lacan rapporte à l’image à laquelle Freud a recours dans son article sur le narcissisme (« Pour introduire le narcissisme », 1914) : une bouche qui se baiserait elle-même. L’objet du désir n’est ainsi appréhendé dans le mouvement de la pulsion que par son absence, et non par sa présence : « … cet objet que nous confondons trop souvent avec ce sur quoi la pulsion se referme – cet objet qui n’est en fait que la présence d’un creux, d’un vide, occupable nous dit Freud, par n’importe quel objet, et dont nous ne connaissons l’instance que sous la forme de l’objet perdu a » (p. 164).
34- Séminaire VI, Le désir et son interprétation, 1958-59, La Martinière, 2013, p. 440-441. C'est là, à ma connaissance, la première mention de la formule lacanienne « Il n'y a pas d'Autre de l'Autre » (elle ne figure pas dans les Ecrits). On la retrouvera plus tard, souvent reprise dans les derniers séminaires de 1972 à 1976.
35- « Car la construction que vous êtes a pour fondations les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur » (Epître aux Ephésiens, 2, 20-21). Paul de Tarse reprend ici une image du psaume 118 (22-23) : « La pierre rejetée des bâtisseurs / est devenue la tête de l'angle ; / c'est là l'œuvre de Yahvé, / ce fut merveille à nos yeux. »
36- « Nous sommes très étonnés par ce qui nous apparaît très souvent comme leur [il s’agit des interprétations de Freud] caractère extraordinairement interventionniste au regard de ce que nous-mêmes nous nous permettons et, je dirais, au regard de ce que nous pouvons et ne pouvons plus nous permettre. On peut même ajouter que ces interprétations nous frappent par leur caractère à côté. Ne vous ai-je pas mille fois fait remarquer […] combien les interprétations de Freud – il le reconnaît lui-même – étaient liées à son incomplète connaissance de la psychologie […] L’insuffisante connaissance que Freud avait à ce moment-là fait que, dans plus d’un cas, ses interprétations se présentent avec un caractère trop directif, presque forcé, et précipité à la fois, qui donne en effet sa pleine valeur au terme d’interprétation à côté » (Séminaire V, Les formations de l’inconscient, 1957-58, Seuil, 1998, p. 322).
37- Lacan souligne à plusieurs reprises l’intérêt d’un article d’Edward Glover qui montre les effets possiblement positifs d’une interprétation erronée au cours d’une analyse (« The therapeutic effect of inexact interpretation », The International Journal of Psycho-Analysis, vol. XII, oct. 1931) : « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », dans Ecrits I, Seuil, 1999, p. 298-299 ; et Séminaire V, Les Formations de l’inconscient, 1957-58, Seuil, 1998, p. 458-459.
38- « Le paradoxe de la partie de bridge analytique, c’est cette abnégation qui fait que, contrairement à ce qui se passe dans une partie de bridge normale, l’analyste doit aider le sujet à trouver ce qu’il y a dans le jeu de son partenaire. Et pour mener ce jeu de qui perd gagne au bridge, l’analyste, lui, ne doit pas avoir en principe à se compliquer la vie avec un partenaire. C’est pour cette raison qu’il est dit que le i(a) [soit l’image du semblable que l’analyste s’efforce de réfléchir dans l’esprit de l’analysant] de l’analyste doit se comporter comme un mort. Cela veut dire que l’analyste doit toujours savoir ce qu’il y a dans la donne [Malheureusement, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, et le témoignage nous en est donné par les analystes eux-mêmes […] Depuis un certain temps, on admet effectivement dans la pratique analytique que l’analyste doit tenir compte, dans son information et dans sa manœuvre, des sentiments, non pas qu’il inspire, mais qu’il éprouve dans l’analyse, à savoir de ce qu’on appelle de son contre-transfert » (Séminaire VIII, Le Transfert, 1960-61, Seuil, 2001, p. 27-28).
Pour lire la suite, cliquer ICI
|
|
